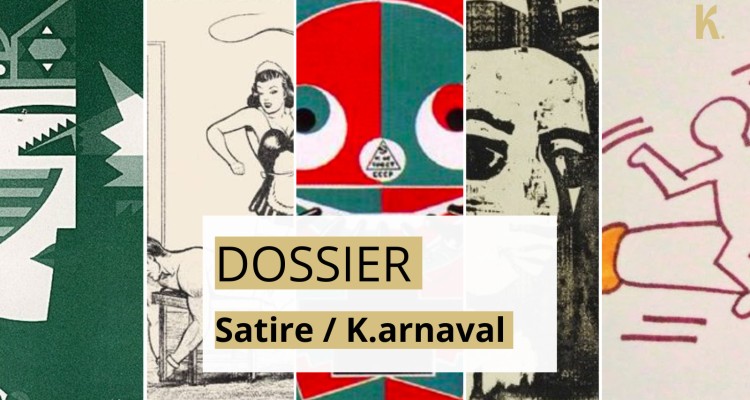Le passé, ennemi de l’avenir

Où l’on voit comment un débat enflamme la République du Peuple juif à propos de ses relations avec la République fédérale d’Allemagne…
La guerre de 1953 s’est soldée par une victoire militaire, mais aucun traité ne reconnaît l’occupation par l’État juif de la bande de sécurité longeant les frontières avec la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Une ligne continue de barbelés sépare les deux pays communistes de la République du Peuple juif. Des canonnières barrent toujours le Danube, interdisant tout accès fluvial à Bratislava. La Tchécoslovaquie et la Hongrie ne délivrent plus de visas aux ressortissants de la République du Peuple juif. Le silence enveloppe le vieux quartier juif de Prague, il n’y a plus de pèlerins sur la tombe du Maharal ni de fleurs devant la maison de Kafka.
La République d’Israël se retrouve entourée de frontières fermées, celles de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Yougoslavie. Une zone militaire la sépare du Tyrol. Il reste bien des passages routiers, ferroviaires et fluviaux avec l’Allemagne, mais l’État juif refuse d’établir des relations diplomatiques avec Bonn. Les marchandises indispensables sont acheminées sous le contrôle de l’armée américaine. Pourtant, la noria de trains et de camions qui passent chaque jour la frontière avec la RFA pour livrer dans l’État juif ne transporte pas exclusivement des produits venus de France, de Belgique, des Pays-Bas ou même des entreprises américaines implantées en Allemagne. De plus, ces trains et camions ne repartent pas à vide. En vérité, il existe bien des échanges commerciaux entre les deux pays voisins, ce qui signifie que des citoyens de l’État juif passent régulièrement la frontière pour faire des affaires avec les Allemands. Force est par ailleurs d’admettre que, parmi les intéressés, figurent aussi de hauts fonctionnaires voyageant en toute discrétion…
Il devient vital de briser le tabou de la reconnaissance mutuelle de la RFA et de la République du Peuple juif. En janvier 1954, le Ha’aretz publie une tribune envoyée de Berlin-Ouest par un jeune cadre du SPD nommé Willy Brandt. Sous le titre « Pourquoi je suis revenu en Allemagne », ce socialiste qui, pour combattre le Troisième Reich, avait choisi l’exil dès 1933, appelle à la construction d’une nouvelle Allemagne, humaniste et démocratique. Le seul fait de publier l’article d’un Allemand, fût-il social-démocrate et clairement antinazi, soulève un tollé à Vienne. Le journal reçoit une pluie de lettres de protestation et nombre de rescapés des camps résilient leur abonnement. Plusieurs manifestations se déroulent devant le siège du journal. Des militants du Hérout, avec leur sens inné de la nuance, scandent des slogans comme « Il n’y a pas d’Allemand innocent ! » et « Ha’aretz = Sturmer ». Les communistes et divers mouvements d’extrême gauche se rassemblent sous les fenêtres du journal aux cris de « Pas de nouvel Anschluss ! » et « Brandt, Adenauer, mêmes nazis ! ».
Selon une rumeur qui court dans les cafés de Vienne, la tribune de Willy Brandt a été envoyée au Ha’aretz à la suite de contacts entre le SPD [Parti socialiste allemand dirigé par Brandt] et le Mapaï. Il se dit aussi, dans les milieux généralement bien informés, que les travaillistes israéliens au pouvoir ont noué des contacts non seulement avec le SPD qui siège alors dans l’opposition, mais aussi avec le gouvernement de Bonn.
Les changements intervenus en URSS après la mort de Staline ne se traduisent pas par une détente sur les frontières de l’État juif. Bien qu’officiellement neutre, la République d’Israël se trouve aux avant-postes de la guerre froide. Pourtant, le gouvernement ne manquera pas d’adresser une protestation aux trois puissances qui occupent l’Allemagne occidentale à l’occasion de la création de la Bundeswehr le 12 novembre 1955. Dix ans après la destruction de la Wehrmacht, les Juifs ne peuvent pas admettre la renaissance d’une armée allemande postée sur ses frontières. Une foule immense se rassemble sur le Ring, pour dire NON au militarisme allemand. Sur le tract appelant à la manifestation, on peut voir une photo du général Hans Speidel, commandant de la Bundeswehr, en compagnie d’Adolf Hitler. La même photo est publiée dans les journaux communistes du monde entier.
Un an plus tard, le 4 novembre 1956, l’Armée rouge boucle la Hongrie pour réprimer dans le sang l’insurrection de Budapest. Pour l’État juif, le danger vient donc bien de ses frontières avec le bloc communiste. Les forces armées sont mises en état d’alerte et on rappelle les réservistes. Le Danube bleu de Vienne se teint de rouge à Budapest. Trop occupés à fusiller 4000 Hongrois, les soldats soviétiques ne s’approchent pas de la frontière, mais des MiG survolent le territoire de la République d’Israël. La Pravda publie des photos aériennes d’une colonne de blindés des forces de défense de l’État juif faisant route vers la frontière hongroise. Les légendes des photos relancent les accusations contre le bellicisme germano-sioniste et reprennent l’antienne du projet de domination juive sur les anciennes possessions des Habsbourg.
Une nouvelle fois, un mystérieux voyage d’Abba Eban alimente les rumeurs. Devenu ambassadeur de la République d’Israël aux Nations Unies, le diplomate n’a pas trouvé de place sur un vol direct pour rentrer de New York après avoir assisté à l’Assemblée Générale où il a une nouvelle fois fait montre de ses talents d’orateur. Il a donc pris place à bord du Super-Constellation DC6 de la Panam reliant New York à Cologne. Or, les avions de la compagnie El Al effectuent trois rotations par semaine entre New York et Vienne, sont rarement pleins à ras bord et considèrent les diplomates comme prioritaires. De surcroît, Abba Eban a pris son temps, puisqu’il s’est écoulé 48 heures entre l’atterrissage du DC8 à Cologne et l’arrivée à Vienne d’un petit avion militaire américain ramenant le diplomate.
Plusieurs députés, qui ne siègent pas tous sur les bancs de l’opposition, demandent qu’Abba Eban soit auditionné par une commission de la Knesset. À la grande surprise de la droite, la majorité vote en faveur de cette audition qui se déroulera en février 1957.
Non seulement Abba Eban reconnaît qu’il s’est rendu à Bonn avec l’accord du gouvernement, mais, pour la première fois, David Ben Gourion plaide en faveur de l’établissement de relations diplomatiques avec l’Allemagne. Et il fait état de contacts directs avec le chancelier Konrad Adenauer.
Menahem Begin proteste violemment, traite Abba Eban de Juif de cour au service des princes allemands et compare Ben Gourion au président du Judenrat de Varsovie. Furieux, il quitte illico l’hémicycle, suivi des députés du Hérout.
Le processus engagé est pourtant irréversible. L’argent allemand vient à point pour les habitants de la République du Peuple juif qui, jusque-là, vivent modestement des fruits de leur travail.
Il faut de longues et douloureuses négociations pour normaliser les relations de la République du Peuple juif et de la République fédérale d’Allemagne. Le passé criminel de l’Allemagne nazie n’est d’ailleurs pas le seul obstacle. Au demeurant, la RFA n’est pas le seul pays à blanchir certains de ses dirigeants. En France, le recyclage des pétainistes a commencé bien avant la Libération, que ce soit à Alger ou même à Londres. Sans parler des compromissions historiques de l’URSS, toujours représentée dans les négociations internationales par Molotov, le même Molotov qui a jadis forgé avec Ribbentrop, sans le moindre état d’âme, l’alliance d’Adolf Hitler et de Joseph Staline.
L’Allemagne fédérale a trouvé une méthode audacieuse pour s’affranchir de son passé. Il suffit de faire entrer les nazis les plus compromis dans la Résistance, à titre rétroactif. Dix ans après la guerre, la quasi-totalité des généraux et officiers supérieurs de la Bundeswehr, Hans Speidel en tête, étaient censés avoir participé au complot du 20 juillet 1944. Devant une telle brochette de conspirateurs, on a du mal à comprendre comment l’attentat a pu échouer. Les soldats alliés tombés en Normandie, dans les Ardennes et sur le Rhin ignoraient qu’ils affrontaient les tirs d’Allemands innocents, pressés de se débarrasser d’Hitler ! La fiction de la Résistance allemande arrange tout le monde. Les nazis ayant échappé au procès de Nuremberg se trouveraient donc tous en Amérique latine, quand ils n’ont pas élu domicile au Tyrol. Le gouvernement juif de Vienne expédie une équipe du Mossad à la recherche des fugitifs au Paraguay et en Argentine. Il infiltre aussi quelques espions à Innsbruck et à Klagenfurt.
Le présent est plus complexe que le passé. L’État juif exige la démilitarisation totale de la poche du Tyrol et se réserve le droit d’y intervenir pour mettre les terroristes hors d’état de nuire. De fait, le Tyrol est enclavé entre les bases américaines d’Allemagne et d’Italie d’une part et les forces de défenses juives de l’ancienne Autriche d’autre part. Le Bundestag adopte une loi octroyant la nationalité allemande à ceux qui quittent les camps de personnes déplacées pour rejoindre la RFA. Ce texte définit le statut « des réfugiés de langue allemande des régions du Danube », une périphrase désignant en fait les Autrichiens, car ce terme est désormais banni du vocabulaire officiel de la République fédérale. L’Autriche n’a jamais existé qu’une vingtaine d’années, de la défaite de 1918 à l’Anschluss. Les nouveaux manuels scolaires érigent donc la RFA en héritière du Saint-Empire romain germanique dont la capitale n’a jamais été Vienne, mais Francfort-sur-le-Main où siégeait la Diète chargée d’élire le Kayser.
Les « Allemands du Danube » désireux de quitter le Tyrol peuvent devenir citoyens de la RFA en renonçant à toute revendication sur leurs biens restés dans l’ancienne Autriche. En échange, ils bénéficient de logements sociaux, de prêts et d’aides à la création d’entreprises. La formidable croissance allemande fait le reste : il suffit de passer la frontière pour trouver un emploi stable.
La population du Tyrol diminue sensiblement et elle semble vouée à une lente extinction, car les jeunes partent en masse. Pour accélérer le processus, les forces de défense juives mènent quelques opérations ciblées, mais spectaculaires. Plusieurs chefs d’organisations armées sont abattus et leurs maisons détruites. Un bombardement vise un dépôt d’explosifs en plein cœur d’Innsbruck, provoquant délibérément la destruction du quartier.
Pour protester, le Front autonome du Tyrol autrichien organise une procession devant l’église Judenstein de Rinn, haut lieu d’un culte antisémite dédié depuis 1671 à une prétendue victime de crime rituel : l’enfant Anderln von Rinn. Cette manifestation dégénère, des groupes de très jeunes gens lancent des pierres sur les forces de sécurité.
Les forces de défense juive répliquent en investissant Rinn et en rasant l’église du village où reposent les restes de l’enfant. Intégré à la zone militaire et aussitôt fortifié, le secteur de Rinn permet de contrôler Innsbruck et surtout de couper la ville de la frontière italienne. Le déploiement militaire sépare définitivement les réfugiés autrichiens du Tyrol de ceux de Carinthie.
Revers de la médaille, l’opération militaire de l’État juif est condamnée en termes sévères par le nouveau maître de l’URSS, Nikita Khrouchtchev, et par le président yougoslave, Joseph Broz Tito. Les deux frères ennemis enfantés par le communisme amorcent une réconciliation, si bien que la République juive se trouve désormais entourée de voisins hostiles, la frontière de la Yougoslavie prolongeant celles des pays membres du Pacte de Varsovie. Certes, la protestation de Khrouchtchev contre la destruction de l’église de Rinn ne manque pas de piquant et nul doute qu’elle va droit au cœur du cardinal Mindszenty, reclus dans l’ambassade des États-Unis à Budapest depuis le massacre des insurgés de 1956. Dans ces circonstances, la normalisation des relations avec l’Allemagne fédérale devient donc vitale pour l’État juif.
Tandis que les diplomates s’activent en coulisse, Konrad Adenauer multiplie les gestes d’apaisement. Il signe un décret réprimant sévèrement les ventes d’armes et de matériel militaire aux réfugiés du Tyrol. La justice fédérale allemande engage des poursuites à l’encontre d’anciens officiers SS réfugiés au Tyrol et en Carinthie. Deux personnages sont particulièrement visés : l’Obersturmführer SS Alois Brunner repéré à Klagenfurt où il assure la formation militaire des commandos du FATA et Kurt Waldheim, porte-parole du Front et ancien officier des Waffen SS. La presse à sensation n’a de cesse de signaler la présence de disparus tristement célèbres. En France, Paris Match publie les photos d’un homme qui ressemble à Martin Bormann en affirmant que l’intéressé se cache dans le camp de réfugiés d’Innsbruck. Plus sérieux, le Spiegel révèle que Tito a discrètement libéré d’anciens officiers musulmans de la Légion SS de Bosnie ainsi que des chefs militaires oustachis de Croatie, lesquels encadreraient les commandos du FATA.
La détente avec la RFA est de plus en plus manifeste dans les rues de Vienne encombrées de Mercédès, Volkswagen, BMW, Opel et autres Ford Taunus. Sans rancune, nombre de Juifs manifestent un goût prononcé pour l’automobile allemande. Il est vrai que de leur côté les nazis avaient jeté leur dévolu sur la Traction, très appréciée par la Gestapo, laquelle ne pouvait ignorer ce qu’elle devait à André Citroën, ce « petit youpin du Quai de Javel » qui faisait enrager Louis Renault.
Avant d’être officialisé au niveau politique, le rapprochement de la RFA et de la République du Peuple juif doit nécessairement s’exprimer par la culture. Or, Juifs et Allemands partagent depuis plusieurs siècles une même passion de la musique.
Le prestigieux orchestre philharmonique de Vienne est officiellement invité à se produire à Bonn, ville natale de Beethoven, où Lorin Maazel dirige la Symphonie pastorale. Le jeune pianiste Daniel Barenboim, quant à lui, fait une tournée de concerts à Berlin-Ouest, Cologne, Bonn et Munich.
Dans la foulée, le Philharmonique de Vienne signe un contrat avec la Deutsche Grammophon. Le Festival de Salzbourg-Kyriat Amadeus concède les droits de retransmission en direct à la toute nouvelle deuxième chaîne de télévision allemande, la ZDF. Or, nul n’ignore que cette chaîne privée à vocation culturelle est née par la volonté de Konrad Adenauer.
Certes, il faut compter à la Knesset avec quelques protestations de députés du Hérout. En France, le philosophe Vladimir Jankélévitch publie une lettre ouverte à David Ben Gourion pour protester contre les choix culturels de l’État juif, lesquels font outrageusement valoir la musique allemande.
La polémique s’amplifie à Vienne lorsque le Ha’aretz publie fort opportunément une enquête sur les musiciens juifs du Philharmonique de Berlin que Wilhelm Furtwängler a réussi à protéger sous le nazisme. La Deutsche Grammophon vient d’éditer la Neuvième Symphonie de Beethoven enregistrée sous la baguette de Furtwängler, lequel a déjà eu l’honneur douteux de l’interpréter en avril 1942 pour l’anniversaire du Führer. L’album de deux disques 33 tours est en tête des ventes chez tous les disquaires de Vienne. Plusieurs personnalités de droite, mais aussi de gauche, s’inquiètent de cet engouement pour la musique allemande. Menahem Begin interpelle le gouvernement à la Knesset en l’accusant de rétablir l’ancienne culture dominante des empires germaniques au lieu de promouvoir la culture plusieurs fois millénaire du peuple juif : « Nos ancêtres écoutaient la lyre du roi David, ils chantaient le Cantique des cantiques, nous profanons leur mémoire en nous soumettant à la baguette du chef d’orchestre préféré d’Adolf Hitler. Par chance, Monsieur Furtwängler n’est plus de ce monde, sinon vous seriez capables de l’inviter à Vienne. ».
Pour répondre à Begin, deux musiciens rescapés du Philharmonique de Berlin se rendent sur la Judenplatz dans le but de déposer à l’Institut Yad Vashem leur témoignage tendant à faire de Furtwängler un Juste parmi les Nations. Le président de l’Institut, Ben Zion, ancien ministre de l’Éducation, refuse de les recevoir. « À ce compte, déclare-t-il, on blanchira bientôt Siegfried Seidl, commandant SS de Terezin, qui a permis à des musiciens juifs de jouer dans l’orchestre du camp ! ». Ledit Seidl appartenait au cercle restreint des Autrichiens de la haute hiérarchie SS. Après la guerre, il sera arrêté, jugé et exécuté à Vienne, en 1947, quelques mois avant la proclamation de la République du Peuple juif.
La polémique sur la relation des Juifs à la culture allemande divise profondément les intellectuels. Les ashkénazes, Max Brod en tête, revendiquent l’héritage judéo-allemand, celui de Mendelssohn et de Johann Strauss, ainsi que de la myriade de grands écrivains juifs de langue allemande, depuis Heinrich Heine jusqu’à Franz Kafka, en passant par Joseph Roth, Stefan Zweig, Alfred Doblin, Lion Feuchtwanger et tant d’autres. Entre également dans cette catégorie le fondateur du sionisme, Theodor Herzl, lui-même. Les oppositions à la culture allemande émanent de plusieurs cercles intellectuels allant de l’extrême gauche où l’on revendique l’héritage de la littérature yiddish à la droite nationaliste qui considère la langue hébraïque comme seule expression de la pensée juive.
Les décideurs ne peuvent pas attendre que les Juifs s’accordent sur leur patrimoine culturel.
David Ben Gourion, qui vient de céder le poste de Premier ministre à Lévi Eshkol pour redevenir libre de ses mouvements, rencontre le chancelier Konrad Adenauer à New York, le 16 mars 1960. Deux jours plus tard, violemment interpellé par Menahem Begin, Eshkol fait approuver le principe de cette rencontre par la Knesset. Le leader de la droite a la dent dure, mais au terme du débat, son réalisme politique a prévalu sur ses principes moraux et la droite s’abstient, si bien que seuls les communistes s’opposent encore au dialogue avec le chancelier allemand.
Une fois la rencontre Ben Gourion-Adenauer approuvée par la Knesset, le gouvernement de Vienne engage officiellement les négociations avec Bonn. Cela ne va pas sans cris, la droite et l’extrême gauche se relayant pour manifester leur hostilité à l’Allemagne. Le pragmatisme prévaut cependant sur le terrible souvenir de la Shoah.
Un événement vient à point pour que l’opinion distingue bien entre l’Allemagne nazie, à jamais impardonnable, et le régime libéral et donc fréquentable de Bonn. Le Mossad, qui a définitivement identifié Adolf Eichmann à Buenos Aires, le capture et l’embarque, drogué et déguisé en steward, sur un vol d’El Al à destination de Vienne. Quoique né en Prusse, Eichmann a passé sa jeunesse en Autriche, si bien que Bonn se garde d’émettre la moindre remarque.
Le Gouvernement juif de Vienne prépare simultanément le procès Eichmann et la rédaction du traité de reconnaissance mutuelle de la RFA et de la République du Peuple juif.
Les deux délégations commencent à se mettre d’accord sur le lieu de la négociation et de la signature. Les représentants de la République du Peuple juif ne peuvent pas résider officiellement pendant plusieurs semaines en Allemagne sans risquer de blesser les rescapés et de donner du grain à moudre aux opposants au traité. Les diplomates allemands étant essentiellement rhénans rechignent à s’installer dans l’ancienne capitale des Habsbourg, dynastie dont ils se sont émancipés grâce à la France de Bonaparte. On songe d’abord à la Suisse, mais un contentieux oppose les Juifs à la Confédération helvétique qui sert de base arrière aux nationalistes autrichiens du Tyrol. Berne a d’ailleurs protesté lorsque l’armée juive s’est déployée entre Innsbruck et les frontières helvètes pour s’assurer le contrôle des points de passage entre les deux pays. Konrad Adenauer, qui a noué des liens avec le général de Gaulle dès le retour au pouvoir de ce dernier en juin 1958, propose de solliciter la France. Encore faudrait-il trouver une ville neutre aux yeux des deux parties. Les Juifs se souviennent de l’échec de la Conférence d’Évian de 1938, qui vit les démocraties refuser d’accueillir les victimes du Troisième Reich. Les Allemands, pour leur part, considèrent toujours que leurs malheurs ont commencé à Versailles. Le Quai d’Orsay se met en quête d’une ville acceptable par les deux parties, facile d’accès depuis Bonn et Vienne. En dépit des facilités de transport et de logement offertes par les villes de Metz et de Strasbourg, on écarte les trois départements annexés par l’Allemagne en 1870 et 1940. Un sous-chef de bureau du Quai d’Orsay propose alors le château de Lunéville en Meurthe-et-Moselle. Le souvenir du brave Stanislas — roi de Pologne déchu qui a vécu dans ces murs — ne gêne personne. Le lieu est même de bon augure pour les diplomates de la République du Peuple juif, car c’est un député du bailliage de Lunéville, l’abbé Grégoire, qui a fait adopter l’émancipation des Juifs de France au début de la Révolution. On aménage en toute hâte le château en vue de longs mois de négociations. Au passage, André Malraux débloque des crédits pour restaurer la synagogue de Lunéville et rétablir sur son fronton l’inscription gravée lors de l’inauguration en 1786 : « Au dieu d’Israël, avec la permission du roi de France ».
Les accords de Lunéville, signés en 1963 sous le portrait de l’abbé Grégoire, donnent à la France le sentiment d’avoir joué un rôle historique sans recevoir la moindre marque de reconnaissance. En vérité, le général de Gaulle a téléphoné à ses amis Adenauer et Ben Gourion pour inviter les deux délégations à Lunéville. Toutefois, les négociations se déroulent à huis clos sans la participation de la France. Les seuls Français présents sont, outre les gendarmes chargés de la sécurité, le chef cuisinier et les femmes de chambre. Juifs et Allemands se réconcilient sur le sol français, mais la France en est réduite à assurer l’intendance. De Gaulle en prend forcément ombrage. Selon une indiscrétion rapportée par Minute, il aurait lancé à Georges Pompidou : « La France risque de finir là où vous avez commencé, au service des Rothschild ! ». Le service de presse de l’Élysée apporte un démenti catégorique à l’hebdomadaire d’extrême droite et les Renseignements généraux font fuiter une note sur le lourd passé de certains journalistes de Minute ayant jadis porté l’uniforme de la Milice quand ce n’était pas celui de la Waffen SS.
Le Gouvernement français s’empresse de saluer l’accord historique dès qu’il est signé et le journal télévisé titre : « Un grand succès de la diplomatie française ». La formule doit tout à Alain Peyrefitte, ministre de l’Information. Moscou qualifie l’accord de pacte d’agression contre les peuples d’Europe centrale et L’Humanité, organe du parti communiste français qui n’en est pas à une outrance près, écrit : « Comme il y a vingt ans, le Gouvernement français a choisi de livrer les juifs aux Allemands. »
Le préambule du traité rappelle la culpabilité de l’Allemagne sans qu’il soit question de pardon. La RFA reconnaît la souveraineté du peuple juif sur la totalité du territoire de la Première République d’Autriche, y compris le Tyrol et la Carinthie. Bonn s’engage à verser des sommes considérables à la République juive, tout en précisant qu’il ne s’agit pas de réparations, le crime contre l’humanité étant par définition irrémédiable et imprescriptible. La circulation des hommes et des marchandises entre les deux pays est sévèrement encadrée. Aucun ressortissant allemand ne peut revendiquer une ancienne propriété foncière ou commerciale sur le territoire de la République du Peuple juif, ni exiger le remboursement ou les intérêts de sommes déposées avant 1945 dans une banque autrichienne. L’entrée des Allemands sur le territoire de la République juive est limitée aux séjours touristiques, aux échanges culturels et aux voyages d’affaires. Tout Allemand né avant 1930, et donc âgé de 15 ans ou plus en 1945, doit obligatoirement demander un visa pour entrer sur le territoire de la République juive. Les autorités de Vienne se réservent le droit de refuser un visa, et même celui d’interpeller tout ressortissant allemand suspect d’avoir personnellement contribué à la Solution finale.
La clause est de pure forme, car sauf pour les cadres du Parti nazi et les officiers de la SS, les services de l’État juif n’ont pas les moyens de vérifier le passé de chaque Allemand.
D’un commun accord, les deux gouvernements décident de signer le traité sans cérémonie et sans apparat. La ratification simultanée par les deux Parlements suffit. À Bonn, le Bundestag l’approuve à l’unanimité, seuls quelques députés de la CSU bavaroise ayant préféré s’absenter le jour du vote. À Vienne, à l’issue d’un débat houleux à la Knesset dont cette assemblée est coutumière, la ratification est approuvée à une très large majorité, grâce au ralliement d’une partie de la droite et à l’abstention du Hérout. Seuls les trois communistes et les deux députés du Bund votent contre.
Le procès d’Adolf Eichmann s’ouvre à Vienne, au lendemain de la ratification de l’accord. Ce calendrier ne doit évidemment rien au hasard.
Les retombées économiques effacent vite les rancœurs. L’Allemagne n’ouvre pas seulement son marché aux entreprises de l’État juif, elle apporte des investissements et partage les retombées du plan Marshall. Les accords internationaux interdisent à la République du Peuple juif de devenir le septième signataire du Traité de Rome, mais le Benelux et la France valident le volet commercial des accords de Lunéville ce qui facilite la circulation des capitaux et des marchandises de l’État juif dans toute la Communauté économique européenne. De Gaulle toutefois presse le chancelier Konrad Adenauer de signer un pacte franco-allemand avant de finaliser son accord avec l’État juif. Le Traité de l’Élysée, signé en janvier 1963, place symboliquement l’accord Bonn-Vienne dans le sillage de l’axe franco-allemand. Le Président de la République française laissera cependant percer son amertume lors d’une conférence de presse : « Il ne faudrait pas qu’après avoir retrouvé les moyens de restaurer son ancienne splendeur, ce petit peuple d’élite se montre sûr de lui-même et dominateur ».
De Gaulle, qui a rencontré Nikita Khrouchtchev à Paris et à Moscou, entend préserver la détente Est-Ouest. Un État juif ouvert à l’Ouest et fermé à l’Est risquerait de relancer la Guerre froide, voire de déclencher un conflit armé au cœur de l’Europe.
Comme il fallait s’y attendre, l’URSS et la Yougoslavie n’apprécient guère le rapprochement judéo-allemand. La Pravda, qui utilise toujours la dénomination « Israël » pour dénoncer la malfaisance de l’État sioniste, écrit : « Jusqu’à présent, la politique impérialiste d’Israël puisait son inspiration dans l’histoire des Habsbourg. L’accord avec les revanchards de Bonn la place désormais dans le droit fil du Troisième Reich et de l’Anschluss. »
Outre cet éditorial, la Pravda publie une déclaration du Présidium du Soviet Suprême ainsi libellée : « L’URSS, qui a sacrifié vingt millions de ses fils pour libérer l’Europe du nazisme et permettre l’installation des Juifs sur les bords du Danube met en garde les dirigeants sionistes. Les forces armées du Pacte de Varsovie riposteront à toute tentative d’agression contre les peuples de Tchécoslovaquie, de Hongrie et de Yougoslavie. »
Le ministre des Affaires étrangères de l’URSS, Anastase Mikoyan, se rend à Belgrade pour s’entretenir avec Tito. Selon le Mossad, les services soviétiques auraient noué des contacts avec le FATA au Tyrol et en Carinthie. La signature du traité judéo-allemand est suivie d’une vague d’attentats, dont l’explosion d’une bombe sur un marché de Vienne qui fera un mort et une dizaine de blessés. Une catastrophe de plus grande ampleur est évitée de justesse : le service de sécurité de la compagnie El Al intercepte un engin explosif, dissimulé dans une valise enregistrée à Orly sur le vol Paris-Vienne.
La paix avec le voisin en amont du Danube aggrave le risque de guerre en aval. Le Pacte de Varsovie a déployé une impressionnante flotte de canonnières fluviales entre Vienne et Bratislava. Des renforts affluent sur toutes les frontières terrestres.
Vous le saurez en lisant le dernier épisode de notre feuilleton !
Guy Konopnicki
Guy Konopnicki est journaliste et écrivain. Parmi ses nombreux livres, il est notamment l’auteur, avec Brice Couturier, de ‘Réflexions sur la question goy’ (Éd. Lieu Commun, 1988) et de ‘La faute des Juifs – Réponse à ceux qui nous écrivent tant’ (Balland, 2002).