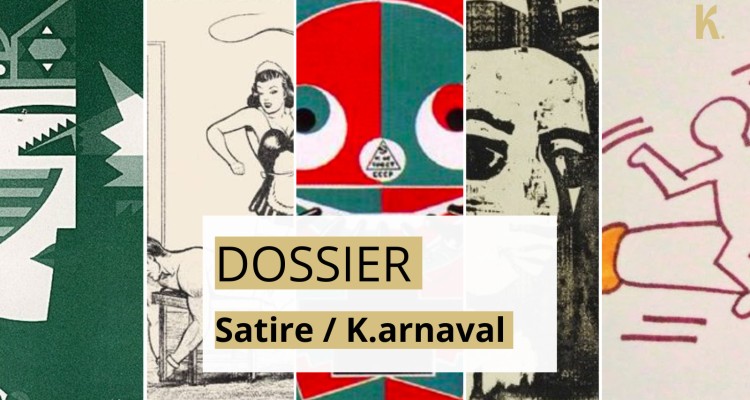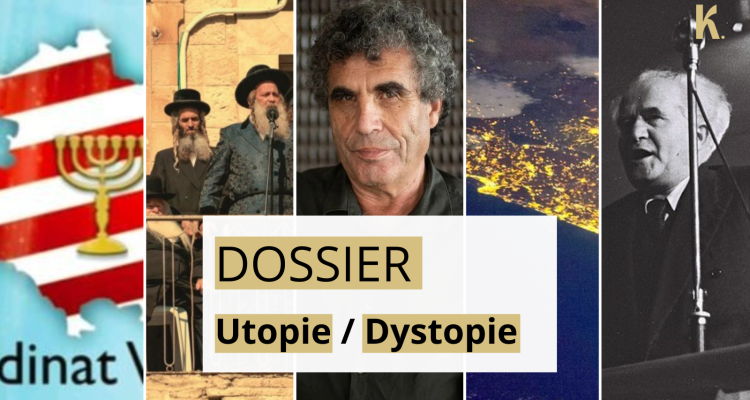La victoire sous le soleil d’Austerlitz

Où l’on voit comment une nouvelle guerre menace d’embraser l’Europe…
Après le discours de Staline et les arrestations de Prague et de Moscou, le gouvernement juif de Vienne place ses forces armées en état d’alerte. Abba Eban, délégué du gouvernement auprès des Alliés, parcourt inlassablement les capitales occidentales pour obtenir des armes et du matériel militaire. La France est la première à répondre à l’appel. Elle livre des chars Renault R35 qui permettent de constituer une force blindée commandée par Moshé Dayan. Mais les États-Unis se montreront réticents jusqu’à la fin du mandat de Harry Truman. À l’époque sévit en effet à Washington un lobby antisémite autour du secrétaire d’État John Foster Dulles, de son frère Allen, directeur de la CIA, du sénateur McCarthy et d’Edgar Hoover, patron du FBI, qui voyait un communiste derrière chaque juif de Hollywood. Groucho Marx avait pourtant envoyé une mise en demeure à l’ambassadeur de l’URSS dans laquelle il reprochait à Moscou d’utiliser la marque Marx sans l’autorisation de Marx Brother’s ltd. Par chance, le général Eisenhower, qui commande les forces américaines en Europe, ferme les yeux sur les ventes de matériels militaires en surplus chargés sur des trains censés transporter des chewing-gums, du Coca-Cola et des cigarettes. Ces convois en provenance d’Allemagne arrivent à Graz et à Linz où l’armée a installé des chaînes de montage qui sortent des jeeps, des camions GMC et des pièces d’artillerie.
L’État juif produit lui-même des armes légères et a mis au point un système de radar dont les performances surprennent les espions américains et soviétiques. Shimon Peres, que Ben Gourion a chargé de l’armement, a même réussi à constituer une flotte fluviale tant il prend au sérieux les menaces des organisations terroristes autrichiennes qui se promettent de jeter les Juifs dans le Danube.
En octobre 1951, Abba Eban se rend à Strasbourg pour rencontrer un grand ami de l’État juif, le général Pierre Kœnig, ancien chef des forces françaises en Allemagne, devenu député RPF du Bas-Rhin. Les journaux de Vienne affichent à la Une la photo du ministre plénipotentiaire donnant l’accolade au héros de Bir-Hakeim, mais restent perplexes sur l’itinéraire adopté par l’intéressé pour regagner la capitale autrichienne.
Parti de Strasbourg en train, Abba Eban a mis en effet 48 heures pour atteindre Vienne. Certes, la Deutsche Bahn peine à réorganiser le réseau ferroviaire, mais le chef de la diplomatie juive est resté plus de 12 heures en gare de Francfort-sur-le-Main. Il s’est ensuite de nouveau arrêté, pendant quatre heures, à Munich. Le cabinet de l’intéressé a beau faire valoir le caractère aléatoire de certaines correspondances en gare, d’aucuns s’interrogent sur les éventuelles rencontres de l’intéressé dans ces villes. A-t-il noué des contacts avec le gouvernement de la jeune République fédérale d’Allemagne ?
Le ministre des Affaires étrangères, Moshé Sharett, se rend à la Hofburg où il a un entretien orageux avec Ben Gourion. Il n’a pas été informé de la mission d’Abba Eban en Allemagne.
— Tu n’es plus le même, David, depuis que tu as posé ton cul sur le fauteuil de Metternich ! lance Moshé Sharett au Premier ministre.
L’ancien cabinet de travail du chancelier d’Autriche est en effet devenu celui du Premier ministre de la République d’Israël, le président de l’État s’étant vu affecter quant à lui les appartements privés du kayser Franz-Joseph.
— Metternich, justement, a négocié avec Napoléon, rétorque froidement Ben Gourion. Il a retourné deux fois les alliances, si bien que l’Autriche, qui n’avait pas un seul soldat à Waterloo, a dicté sa loi à l’Europe en 1815…
Et le Vieux de refuser aussi sec la démission de Moshé Sharett.
Abba Eban, sommé par le Hérout de s’expliquer devant la Knesset, répond de manière très ambiguë. Il jure ne pas avoir rencontré le chancelier Konrad Adenauer et encore moins son chef de cabinet, Hans Globke, qui a jadis mis à profit son expérience de juriste pour rédiger les lois raciales du IIIe Reich. Cependant, Adenauer et Globke ne sont pas les seuls dirigeants de la RFA et l’on murmure qu’Abba Eban n’est pas resté 12 heures d’affilée dans la gare de Francfort. Un mystérieux témoin l’aurait vu monter dans une Mercédès de grosse cylindrée qui aurait fort bien pu le mener à Bonn en moins de deux heures par l’autoroute fraîchement remise en état.
Le ministre fait alors une réponse sibylline devant la Knesset : « Si nous ne tournons pas maintenant vers l’Ouest, nous devrons bientôt nous tourner vers l’Est pour dire le Kaddish ».
Aucune précision n’est communiquée quant à l’emploi du temps d’Abba Eban à Francfort et à Munich. On apprend seulement que la Deutsche Bahn a mis à sa disposition une luxueuse voiture-salon, où il a reçu plusieurs visiteurs. Les officiers français qui l’accompagnaient depuis Strasbourg ont été relayés par des hauts gradés américains. Plusieurs civils sont également montés à bord, mais il était difficile de les identifier. En costume de ville, les Allemands passent inaperçus, ce qui explique leur goût immodéré de l’uniforme. Sans Hugo Boss, les nazis n’auraient jamais réussi à s’imposer.
Toujours est-il que les signes d’une détente des relations avec l’Allemagne de l’Ouest se manifestent après le voyage d’Abba Eban. On voit arriver des pièces détachées pour les nombreux véhicules de marque allemande immobilisés en Autriche. En dépit de l’absence d’accords formels avec les industriels allemands, le gouvernement facilite l’implantation de concessionnaires de constructeurs automobiles à capitaux américains comme Opel-General Motors et Ford-Allemagne. On entend bien des protestations, car nul ne peut ignorer que Ford et GM ont investi d’importants capitaux en Allemagne de 1933 à 1941, contribuant ainsi à la mécanisation de la Wehrmacht. Mais l’armée et la population de la République juive ont tant besoin de véhicules motorisés !
La République du Peuple juif se dote aussi d’une aviation militaire, dont les pilotes sont formés en France. Il semble qu’Abba Eban ait rencontré l’avionneur Marcel Bloch-Dassault qui, pour s’être converti au catholicisme, n’en est pas moins marqué par son histoire et celle de sa famille et, bien sûr, par sa déportation au camp de Buchenwald. Les forces aériennes de défense de l’État juif reçoivent donc des chasseurs bombardiers Dassault. Elles récupérèrent également, on ne sait par quel moyen détourné, une dizaine de B17 d’occasion provenant des bases U.S. d’Allemagne. L’aviation de l’État juif est autorisée à survoler les zones d’occupation américaine et française d’Allemagne lors de ses vols d’entraînement, en dépit des protestations des réfugiés du Tyrol.
À Moscou, le procès du Comité antifasciste des Juifs de l’URSS s’achève le 12 mai 1952 par 17 sentences de mort immédiatement exécutées. Cet événement tragique restera dans l’histoire sous le nom de « Nuit des poètes assassinés ». Outre les écrivains David Bergelson, Peretz Markish, Itzik Fefer et Leib Kvitko, on fusille le médecin-chef de l’Armée rouge, Boris Shimeliovich, et l’ancien vice-ministre des Affaires étrangères Solomon Lossowski. Le général Aaron Katz, directeur de l’académie militaire Joseph Staline, sauve de justesse sa tête grâce à l’intervention du maréchal Joukov en personne.
Staline a également fait arrêter des médecins juifs qu’il accuse de concocter son assassinat après avoir empoisonné son dauphin Andreï Jdanov, emporté en 1949 par les flots de vodka qu’il ingurgite depuis son plus jeune âge.
Le procès des anciens ministres et dirigeants communistes tchécoslovaques se termine le 27 novembre 1952 par 11 pendaisons, dont celles de Rudolf Slansky et Vlado Clementis.
La Pravda donne le ton de la presse communiste mondiale selon laquelle le gouvernement juif de Vienne prépare, avec ses complices locaux, la reconquête de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie et n’a pas renoncé non plus à reprendre la Galicie et la Bucovine rattachées à l’URSS depuis 1945. Les mêmes organes aux ordres reprennent en chœur les propos de Staline accusant les Juifs de préparer l’avènement d’un empire austro-hébreu au cœur de l’Europe.
Le Petit Père des Peuples va jusqu’à adresser officiellement un ultimatum à Vienne le 27 novembre 1952, jour de la condamnation des « sionistes » de Prague. Si Israël ne renonce pas à l’Anschluss des anciennes provinces impériales, l’Union soviétique apportera son aide fraternelle aux peuples agressés par les sionistes. Chaque mot a été soigneusement pesé. Le nom d’Israël, le mot allemand Anschluss…
Le gouvernement de Vienne répond qu’il n’a pas à renoncer à des annexions purement imaginaires.
Une bombe de forte puissance explose sur le Graben où il y a foule en ce jour du Shabbat. Le bilan est lourd : 30 morts, une centaine de blessés. D’autres attentats se produisent. Un individu mitraille les passants au pied de la grande roue du Prater. L’intervention rapide des militaires limite les pertes ; l’homme est abattu, mais on déplore la mort d’une femme et de ses deux enfants. Le terroriste est identifié : il s’agit d’un Hongrois certainement manipulé par les services soviétiques, en dépit ou en raison de son engagement passé dans la Waffen SS.
Les services de sécurité sont informés de la présence d’explosifs sous la scène de l’Opéra de Vienne, le jour de la première du Don Juan de Mozart. L’engin, désamorcé in extremis, aurait pu causer des dégâts considérables, car l’élite culturelle et politique de l’État juif assistait au grand complet, ce soir-là, à la représentation. Les attentats se multiplient dans tout le pays.
La flottille du Danube ouvre le feu sur une péniche chargée d’explosifs, provoquant involontairement le naufrage d’une barge pétrolière.
Le président tchécoslovaque Klement Gottwald accuse aussitôt l’État juif d’empoisonner les eaux du Danube. Le Rude Pravo, organe du Parti communiste de Tchécoslovaquie, affirme qu’une mystérieuse épidémie sévit à Prague et que de nombreux enfants sont contaminés. Le Danube, pourtant, évite la ville de Prague, laquelle est bâtie sur la Vltava, affluent de l’Elbe.
Des vedettes militaires tchécoslovaques forment un barrage sur le Danube à hauteur de Bratislava, interdisant la navigation aux bâtiments battant pavillon bleu-blanc. Ce blocus n’a qu’une valeur symbolique, les échanges de la République du Peuple juif avec les pays situés en aval étant des plus limités.
Plusieurs incidents frontaliers opposent les soldats tchécoslovaques et hongrois aux forces de défense de la République juive. Tito en profite pour mitrailler la ligne Bar Lev. En représailles, l’aviation de l’État juif détruit des cantonnements de l’armée yougoslave dans le nord de la Slovénie. Quelques obus tombent malencontreusement sur un camp de réfugiés autrichiens, dans la banlieue de Klagenfurt. On ne déplore qu’une dizaine de victimes, mais cette bavure soulève une vague de protestations dans ce qu’il est convenu d’appeler à l’époque « le monde libre ».
À la fin février 1953, les armées hongroise et tchécoslovaque franchissent la frontière pour marcher sur Vienne. L’État juif rappelle aussitôt tous ses réservistes. Les chars de Moshé Dayan repoussent les assaillants sans grande difficulté. Les soldats hongrois et tchécoslovaques se rendent en masse, car ceux qui fuient sont arrêtés par les unités spéciales de l’Armée soviétique et aussitôt fusillés pour désertion. Les troupes de l’État juif vont jusqu’à s’emparer des villes de Bratislava et de Brno.
— C’est la revanche du Golem, soupire un général tchèque encerclé par les chars d’Israël.
Comment ce Pragois cultivé n’aurait-il pas songé, en voyant l’étoile de David sur la tourelle des monstres blindés, à la créature conçue par le rav Loew pour protéger les Juifs de la ville ? À la différence du Golem, pourtant, les chars n’échappent pas à leur maître. Rien ne peut les arrêter, du moins tant que l’armée soviétique n’entre pas franchement en action. Pour éviter tout contact direct, le gouvernement de Vienne donne l’ordre à ses généraux de s’arrêter sur les anciennes frontières de l’Autriche. Mais lorsque Dayan reçoit le message, il vient déjà d’atteindre le plateau de Pratzen.
L’état-major soviétique, craignant d’être pris au piège comme jadis les soldats du tsar Alexandre 1er et du maréchal Koutouzov, évacue précipitamment le château d’Austerlitz où il a établi ses quartiers.
Le soir, dans le camp, la radio de l’armée juive diffuse le concerto que Beethoven avait dédié à l’empereur Napoléon 1er.
À Moscou, Lavrenti Beria réunit d’urgence un Conseil de Défense, avec Nikita Khrouchtchev, Gueorgui Malenkov, Viatcheslav Molotov, Kliment Vorochilov le ministre de la Défense, et le maréchal Joukov. L’ambiance est morose.
— Les youpins sont capables de marcher sur Prague, où ils seront accueillis par une foule en liesse, dit Beria. Les soldats tchèques désertent en masse et nous n’avons pas assez de troupes sur place.
— Ils peuvent occuper la Moravie et la Bohème, objecte Khrouchtchev, mais les Slovaques et les Hongrois détestent les Juifs. Sans parler des Polonais ! S’ils avancent, nous les tenons. Ils seront encerclés.
— Je crains, répliqua Beria, que les Hongrois et les Polonais nous détestent au point d’oublier leur haine ancestrale des Juifs. Dayan ne rencontrera pas de résistance digne de ce nom avant d’atteindre les frontières de l’URSS.
Joukov et Vorochilov gardent le silence tout en échangeant un regard entendu. Ils s’attendent à être tenus pour responsables des revers militaires.
— Nous ne pouvons prendre aucune décision en l’absence du camarade Staline, jette Molotov. Je pense qu’il se donne le temps de la réflexion avant de nous rejoindre.
— Vous avez raison, camarade Molotov, répond Beria. Mais vous savez qu’il ne faut jamais déranger notre Guide quand il se retire dans sa datcha pour réfléchir.
Beria lève aussitôt la séance, sans prendre d’autres décisions que celle de garder le silence.
Le monde retient son souffle. La guerre des Juifs menace d’embraser l’Europe. Le nouveau Président des États-Unis, Dwight Eisenhower, adresse à Staline un télégramme lui demandant de faire cesser immédiatement les attaques contre la République du Peuple juif. Les trois alliés occidentaux présents en Allemagne étant liés depuis 1949 par le Traité de l’Atlantique Nord, les forces de l’OTAN sont mises en état d’alerte dans les zones d’occupation correspondantes.
Au Conseil de sécurité des Nations Unies, l’URSS exige une ferme condamnation des agressions sionistes, mais se heurte au veto des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne.
Cependant, Staline s’abstient de répondre au télégramme d’Eisenhower. Selon les services de renseignements américains, il ne se trouve pas au Kremlin et personne ne l’a vu depuis plusieurs jours.
La CIA échafaude plusieurs hypothèses. Staline s’est-il replié à Kouibytchev, comme en 1941, pour préparer une contre-offensive ? La débandade de ses alliés devant les quelques chars de Dayan a en effet mis en lumière la faiblesse du système de défense soviétique.
Le 4 mars, les forces de défense de l’État juif ont totalement repoussé l’envahisseur et occupent la zone de sécurité, le long des frontières tchécoslovaque et hongroise. Ben Gourion adresse un message à Prague, Budapest et Moscou pour proposer un cessez-le-feu et l’ouverture de négociations de paix, lequel demeure sans réponse.
De son côté, Klement Gottwald cherche désespérément à joindre le Kremlin, ne sachant que faire de la proposition ennemie. Les ambassadeurs d’URSS à Prague et à Budapest n’ont reçu aucune consigne à transmettre aux gouvernements des pays frères.
Le monde plonge dans l’angoisse. Staline se prépare-t-il à lancer une bombe atomique sur Vienne ?
Bien que sceptique quant aux risques d’une guerre nucléaire, Dwight Eisenhower s’installe dans la salle de commandement militaire de la Maison-Blanche. Les radars américains implantés en Europe et en Turquie ne détectent aucun mouvement anormal sur les bases aériennes soviétiques : Yak et MiG procèdent uniquement à des missions de routine, d’entraînement et de surveillance de l’espace aérien.
Le 5 mars, le silence observé depuis plusieurs jours par le Kremlin trouve enfin une explication : Staline est mort !
Dès la nouvelle de la mort de Staline parvenue à Vienne, Ben Gourion réunit un Conseil de Défense avec les principaux ministres et chefs militaires. Il ouvre la séance par un bref exposé de la situation.
— Nous pouvons nous attendre au pire comme au meilleur. Si les Russes nous mettent la mort de Staline sur le dos, ce qui serait dans la logique du complot des Blouses Blanches, nous pouvons redouter des représailles sanglantes. Mais ils peuvent aussi proposer une cessation des combats pour cause de deuil…
— En lisant de près le communiqué officiel du comité central du PCUS, observe Golda Meïr, je ne trouve aucune allusion à un éventuel assassinat. Et pour cause : le docteur Vinogradov et les autres médecins juifs de Staline sont en prison. Le texte dit clairement que Staline a succombé à une attaque. En outre, je crois comprendre que les dirigeants sont trop occupés à régler la succession du Guide pour se lancer dans une opération militaire hasardeuse.
— Golda a sans doute raison, mais nous devons rester prudents. Le mieux serait de montrer notre bonne volonté en rendant hommage à Staline pour son rôle éminent dans la guerre contre l’Allemagne nazie. Saluons le vainqueur de Stalingrad et de Berlin sans faire la moindre allusion à la situation actuelle. Naturellement, nous maintenons la mobilisation de nos forces armées, mais nous proclamons simultanément un cessez-le-feu unilatéral pour respecter le deuil des communistes.
— Le feu a déjà cessé, il n’y a plus un seul soldat rouge à portée de tir, lance Dayan. Que faire de plus ?
— Nous pouvons faire un geste public, répond Rabin, libérer les prisonniers… Mais les Tchèques sympathisent déjà avec nos soldats qui les gardent et plus encore avec les cantinières… Et tous les prisonniers se jettent sur la nourriture tant ils crèvent de faim chez eux !
— La libération des prisonniers me semble prématurée, dit Golda. Il faut faire un geste qui ne coûte rien, sans retirer un seul char des frontières.
— Le mieux, dit Ben Gourion en souriant, serait de commémorer le deuil de Staline. Mettons nos drapeaux en berne, bien visibles de l’autre côté de la frontière. Je prononcerai tout à l’heure un discours devant la Knesset et les députés observeront une minute de silence.
— On ne va tout de même pas dire le Kaddish pour l’assassin des écrivains juifs proteste Josef Burg !
— Pourquoi pas ? rétorque Golda.
Le Cabinet adopte la proposition de Ben Gourion. Pour donner l’exemple, les drapeaux de la Hofburg, du Reichstag/Knesset et de l’hôtel de ville de Vienne sont solennellement mis en berne. L’ordre est transmis aux armées d’amener le drapeau à mi-mât. Un incident est à déplorer dans la forteresse de Graz où sont détenus les prisonniers de guerre lesquels, loin d’être affectés par la mort du dictateur, fêtent joyeusement l’événement. Des huées accueillent la mise en berne des drapeaux. Le commandant de la forteresse n’a d’autre choix que de fermer la cantine pour contraindre ses pensionnaires à jeûner en signe de deuil.
Avant la séance extraordinaire de la Knesset, les membres du gouvernement entreprennent de convaincre les opposants pour éviter tout chahut pendant l’hommage à Staline. Josef Burg se charge de Menahem Begin, qu’il sait sensible aux arguments tirés de la Torah. Il lui rappelle que l’Éternel a interdit aux anges de se réjouir de la mort des guerriers égyptiens engloutis en essayant de traverser la mer Rouge et que le roi David a pris le deuil de Saül après l’avoir combattu. Il s’avère nettement plus difficile d’obtenir le silence des députés du Bund moins réceptifs à l’exégèse biblique et qui ont surtout beaucoup de mal à pardonner à Staline d’avoir lui-même ordonné l’exécution d’Ehrlich et d’Alter.
Ben Gourion prend la parole pour saluer l’homme qui a présidé aux destinées de l’Union soviétique tout au long de la guerre contre l’Allemagne nazie. Il rappelle les accords ayant permis la renaissance de la nation juive sur les bords du Danube. « Le peuple d’Israël n’oubliera jamais que, de Stalingrad à Berlin, les armées dont le maréchal Staline était le chef suprême, ont écrasé la bête immonde ayant exterminé six millions de Juifs », lance le Premier ministre. Et de conclure en paraphrasant le premier décret des Soviets : « Israël déclare la paix à tous les peuples de l’URSS et à ses alliés. Les canons se taisent aujourd’hui pour saluer la mémoire de Staline. ».
Les députés se lèvent pour observer une minute de silence. Seuls les représentants du Bund restent assis tout en respectant la minute de silence.
Les nouveaux maîtres du Kremlin donnent des signes de détente. Partageant le pouvoir avec Malenkov et Khrouchtchev, Beria ordonna la libération des « Blouses blanches ». La femme juive de Molotov, Polina Jemtchoujina, que Staline a exilée au Kazakhstan quatre ans plus tôt, fait sa réapparition à Moscou. Molotov, qui avait été contraint au divorce sur ordre du Petit Père des Peuples, s’empresse de la reprendre comme épouse.
Golda Meïr adresse au couple un message de félicitations qui contient un appel à peine voilé à la négociation.
Polina Jemtchoujina expédie à Golda Meïr un message de remerciement posté depuis la ville thermale de Karlovy Vary, en Bohême, où elle se repose.
Golda se rend illico, à bord d’une Cadillac portant la plaque d’immatriculation des forces américaines en Allemagne, dans l’ancienne Karlsbad. Le chauffeur et les deux gardes du corps qui l’accompagnent ont des passeports diplomatiques américains, mais travaillent pour le Mossad. La voiture effectue un détour pour ne pas avoir à franchir les lignes de front et passe le rideau de fer au point de contrôle utilisé par les officiers U.S. pour rencontrer leurs homologues soviétiques en RDA. Les soldats soviétiques ont reçu l’ordre de les laisser passer. Deux véhicules de l’Armée rouge escortent Golda jusqu’à Karlovy Vary. Celle-ci découvre avec stupéfaction que ce n’est pas Polina, mais Molotov lui-même qui l’attend dans un salon privé du Grand Hôtel.
Il fait montre d’une amabilité dont il n’est guère coutumier. Officiellement, il s’est rendu en Tchécoslovaquie pour assister aux obsèques du président Gottwald qui n’a pas pu surmonter son immense chagrin après la mort de Staline et s’est effondré à son retour de Moscou. Molotov a ensuite rejoint son épouse, qui prend vraiment les eaux à Karlovy Vary.
La négociation est extrêmement rapide.
— L’URSS n’ayant jamais officiellement déclaré la guerre à la République d’Israël, déclare d’emblée Molotov, nous ne saurions signer un traité de paix. Par contre, nous retirons dès aujourd’hui nos régiments stationnés à proximité de vos frontières, lesquelles seront désormais exclusivement gardées par les forces tchécoslovaques et hongroises.
— Cela nous convient, à la condition que des observateurs de l’ONU puissent vérifier le retrait de vos troupes.
— C’est une demande raisonnable. Nous l’examinerons ce soir même, dès mon retour à Moscou.
— Dans ces conditions, si vous n’avez rien à ajouter, je dois également faire valider l’accord par notre gouvernement.
— Tout est dit, répond Molotov. Transmettez à Monsieur le Premier Ministre mes remerciements pour l’hommage qu’il a rendu à notre bien aimé Père des Peuples.
La guerre est terminée. Molotov n’a pas osé demander le retrait des armées juives de la zone de sécurité frontalière. Il ne s’est même pas préoccupé du sort des prisonniers hongrois et tchécoslovaques. Golda regagne Vienne. Le soir même, un télégramme officiel du gouvernement soviétique confirme les termes de l’accord de Karlovy Vary.
Moshé Dayan informe le gouvernement de la demande formulée par un nombre non négligeable de prisonniers tchèques, lesquels revendiquent une origine juive pour rester sur le territoire. Ils se disent disposés à travailler en usine et même dans une mine plutôt que d’être renvoyés à Prague. Plusieurs centaines de ressortissants tchèques se massent par ailleurs dans la zone frontalière et supplient les soldats juifs de les laisser passer. Selon le Mossad, il y aurait également un nombre anormal de Polonais dans les trains à destination de Brno.
— Tous les Juifs sont bienvenus sur leur terre, répond Ben Gourion ! Après vérification des identités, ils seront pris en charge par l’Agence Juive.
— Même les prisonniers, demande Dayan ?
— Une fois libérés, ce sont des Juifs comme les autres, répond Golda. Nous renverrons les soldats non juifs chez eux et nous accueillerons dignement nos frères.
Les nombreux Goldstein, Kramer et autres Kaplan détenus en qualité de prisonniers de guerre tchèques sont admis en terre juive, de même que la cohorte de civils qui se présentent par familles entières à la frontière. De surcroît, quelques centaines d’Abramowicz, Warchawski, Kalisher et consorts arrivent par train de Pologne. Les gardes-frontières sont vite débordés, tant il est difficile de vérifier l’authenticité des origines juives des candidats à l’immigration. Les autorités religieuses s’inquiètent d’un possible afflux d’imposteurs, car l’attrait de l’État juif est tel que, après avoir assidûment pratiqué l’art du pogrom pendant un millénaire, tous les Polonais seraient prêts à se convertir pour être admis sur la terre d’Israël.
Cet exode ne dure guère. Le Gouvernement polonais cesse immédiatement de délivrer des passeports aux Juifs. En Tchécoslovaquie, après quelques jours de flottement dus à la débandade de l’armée et au retrait des Soviétiques, la police reprend le contrôle des routes menant à la frontière.
Pour l’État juif, le bilan de la guerre est excellent. Il a remporté une victoire militaire, récupérant au passage les armes individuelles remises par les prisonniers ou abandonnées par les fuyards. Une cinquantaine de chars en état de fonctionnement ont été capturés. Mais surtout, la brèche ouverte pendant quelques jours dans le rideau de fer a révélé la force d’attraction de l’État juif du Danube.
Vous le saurez en lisant le sixième épisode de notre feuilleton !
Guy Konopnicki
Guy Konopnicki est journaliste et écrivain. Parmi ses nombreux livres, il est notamment l’auteur, avec Brice Couturier, de ‘Réflexions sur la question goy’ (Éd. Lieu Commun, 1988) et de ‘La faute des Juifs – Réponse à ceux qui nous écrivent tant’ (Balland, 2002).