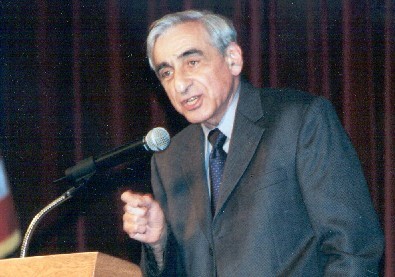Comment parler de Gaza ? Face aux attaques du 7 octobre, la guerre devait être menée, avec son double but : la libération des otages et le rétablissement durable de la sécurité d’Israël, c’est-à-dire l’éradication du Hamas. Cela dans les conditions inextricables d’un combat où l’adversaire souhaite le martyre de son peuple et où Israël en tant qu’État juif et démocratique doit veiller à ce qu’il n’arrive à aucune de ses fins, y compris celle-là. Or ce n’est pas ce qui est en train de se produire et il nous faut redécrire la situation en fonction de cet état de fait. Reprise d’un article du 13 mars 2024.

Lecture du texte par Roxane Kasperski :
Le piège tendu par le Hamas le 7 octobre est sur le point de se refermer complètement sur Israël. C’est ce qui est en train de s’attester à ce moment de la guerre : l’incapacité avérée d’Israël à libérer les otages et à mener un combat qui n’entraine pas des destructions inacceptables dans la population civile et les conditions de vie de Gaza. Cette course meurtrière, on le sait, a été dès le départ voulue par le Hamas. Ses actes génocidaires du 7 octobre ouvraient une séquence orientée dans cette direction. Il l’a encore prouvé en rejetant l’accord de trêve pour le Ramadan, refusant la demande d’Israël que soit fournie la liste des otages encore vivants. Son but est et a toujours été que la guerre fasse le plus de victimes possibles, dans son propre camp comme dans celui de l’adversaire. Cela afin que le conflit s’étende, que la Cisjordanie et la frontière libanaise s’embrasent, et que les soutiens d’Israël se raréfient jusqu’à sa mise au ban des nations, le laissant seul s’occuper de son sort. Les Palestiniens doivent être un peuple-martyre, tel est le credo déclaré, sans la moindre ambiguïté. Et les juifs doivent être bannis, physiquement et moralement, condamnés à la mort ou au statut de paria qui leur correspond.
Ce cycle infernal, Israël n’a pas su le briser depuis cinq mois. L’exclusion du cabinet de guerre des membres d’extrême droite du gouvernement n’a pas suffi à leur retirer toute latitude d’action. Toujours à leurs postes dans le gouvernement, les sionistes religieux – dont la volonté de soumettre les Palestiniens est telle qu’ils puissent envisager leur expulsion de l’ensemble des territoires, et donc une politique d’épuration ethnique – ont continué à entretenir la haine et dresser des entraves à la fois à la politique humanitaire indispensable qui devait accompagner la riposte réassurant la sécurité, et à la pacification de la situation sur les autres fronts où cette sécurité est tout aussi précaire. Si Israël vit actuellement une menace existentielle, une part importante de la responsabilité leur revient de l’intérieur de l’État. La première responsabilité est celle de Netanyahou, résolu à souffler sur les braises à chaque occasion, et incapable de donner à l’engagement dans le conflit un axe qui serait authentiquement sioniste : préserver chaque vie juive, y compris celle des captifs, et viser dans la guerre un au-delà de la guerre où d’une part se recompose une unité nationale dans un État de droit démocratique (unité qui comprend évidemment la minorité palestinienne du pays) et où d’autre part s’établissent les conditions d’une paix durable dans un environnement où puisse exister un État palestinien.
Netanyahou n’a jamais été un politique à la hauteur de ce double enjeu. Cela, le mouvement démocratique des neuf mois précédant le 7 octobre le clamait chaque semaine, et faisait monter une prise de conscience sur l’enjeu essentiel : l’inscription de la question palestinienne dans l’intention même de faire vivre, pour soi-même et aux yeux du monde, un État juif et démocratique. Ou encore : l’implication de la question palestinienne dans la réponse que le sionisme est parvenu à apporter à la traditionnelle question juive dans l’histoire contemporaine.
Le constat, désormais, ne peut pas être contourné : sous le coup de l’une des attaques les plus meurtrières depuis sa création, Israël a riposté avec courage, unité et fermeté. Mais il n’a pas su le faire dans la continuité du mouvement de renaissance et d’autocritique qui était en plein essor lorsque l’attaque l’a frappé. Quelles qu’en soient les causes, une politique autre que celle purement réactionnaire n’est pas parvenue à percer, c’est-à-dire à imprimer sa marque dans la façon de conduire la guerre, assumée dans sa nécessité réelle, mais aussi dans l’horizon qu’elle doit forcément viser. Si l’opinion ne donne aucun signe que l’extrême droite se soit renforcée durant la période, il n’en reste pas moins que son exclusion des positions dirigeantes et la rupture de la coalition sur laquelle repose le gouvernement actuel n’ont pas eu lieu. Les conséquences en sont désastreuses. Désastre qui se compte en vies civiles palestiniennes que nulle politique sécuritaire ne peut justifier.
L’issue passe alors par la mise en œuvre de nouvelles médiations de type diplomatique. On les attend surtout des négociations qui se déroulent tant bien que mal entre une pluralité d’acteurs régionaux et occidentaux, et des conditions aménagées, par-delà les blocages venant des extrémistes des deux camps, à l’émergence d’une voix palestinienne crédible et responsable, en même temps que d’une voix israélienne porteuse d’une vision d’avenir.
Et cependant, l’instauration d’un tel dialogue ne se résume pas aux efforts déployés dans le registre diplomatique. Il ne s’agit pas seulement d’approcher le compromis où chaque position s’amenderait autant qu’elle le peut, sous les pressions plus ou moins bienveillantes d’États tiers et d’institutions internationales, pour rejoindre une zone d’accord où les volontés se vident de ce qui les meut réellement, et dont elles ne peuvent pas se défaire sans se dénaturer. A un autre niveau que diplomatique, qu’on dira simplement politique, il faut affronter ce qui demeure constamment comme une absence béante au beau milieu du conflit israélo-palestinien : l’acceptation réciproque de ce qui légitime en profondeur chacun des deux camps, la reconnaissance, non seulement de leur existence respective, mais de la raison qui anime leur volonté d’exister sous la forme politique particulière qu’ils entendent se donner.
Dans le cas des juifs, il s’agit du sionisme lui-même, en tant que politique réalisée : c’est-à-dire de l’acte qui consiste à avoir construit un État, sur la terre historique où s’est toujours maintenue une présence juive en filigrane de la dispersion exilique, qui offre un appui indispensable à ce que le peuple dispersé ne soit plus une proie politiquement démunie, surexposée à un antisémitisme dont l’époque moderne a montré dans quoi il pouvait culminer, et aussi combien il était inextirpable des formes nationales non-juives d’intégration, si égalitaires fussent-elles. Pour les Palestiniens, il s’agit de leur capacité à se vivre sur leur terre là encore historique, comme un peuple autonome disposant d’une souveraineté qu’ils n’ont jamais eue, en dépassant ce qui demeure actuellement pour une part une dispersion régionale dans plusieurs pays (principalement Israël, la Jordanie, le Liban, l’Égypte et la Syrie, avec des conditions d’existence très inégales pour ces différentes minorités, celles en Israël étant les plus favorables, puisque les seules à conférer aux individus la citoyenneté égalitaire et des droits collectifs dans un État de droit), et pour une autre part la condition transitoire de résidents d’un proto-État, dans des territoires en guerre ou sous occupation étrangère.
La passion criminelle du Hamas est la négation sans appel de ces deux légitimités, israélienne, mais aussi palestinienne. Elle est l’illégitimité même, mise en acte le 7 octobre. Or, c’est dans la séquence qui s’est ouverte depuis lors que se révèlent aussi, comme par une image inversée, les termes exacts du conflit et le stade où l’on est aujourd’hui de son développement tragique.
Usons donc du révélateur, à la manière d’un négatif photographique. Ce qu’a montré avec évidence la séquence, c’est que l’antisémitisme à visée exterminatrice est bien représenté et actif du côté palestinien – et donc qu’Israël est fondé, non seulement à se défendre, mais à défendre précisément ce qu’il défend, à savoir la survie des juifs et leur préservation des pogroms. Que celui du 7 octobre ait entraîné une jubilation dans des franges de l’opinion mondiale et une croissance subite de l’antisémitisme – l’Europe n’en étant nullement exempte – vient renforcer cette vérité tirée du révélateur. En somme, dans l’époque que nous vivons, Israël est chaque jour plus indispensable au défi posé par la question juive, à l’échelle mondiale. Et la haine qu’il suscite s’en trouve aussi mieux éclairée. Car nous vivons une époque où l’antisionisme et l’antisémitisme sont parvenus à leur point de recouvrement le plus complet, leur synthèse assurant la jonction entre une partie majoritaire de l’opinion non-occidentale et une partie significative de la conscience prétendument progressiste occidentale – le 7 octobre, dans son irruption et les réactions réflexes qui l’ont suivi, ayant révélé soit l’enthousiasme, soit le consentement satisfait auxquels cette synthèse donne aujourd’hui lieu.
Puis, la guerre dans Gaza a porté à son point culminant, que nous touchons en ce moment, l’illégitimité de la politique israélienne d’occupation et d’oppression des Palestiniens des territoires depuis deux décennies, laquelle repose sur le refus de considérer l’identité nationale et politique consistante du peuple palestinien tout entier. Si une minorité de ce peuple est israélienne, il n’en est pas moins un peuple un, en droit de disposer de la souveraineté sur le territoire qui lui revient. Politique israélienne coupable au point de pouvoir envisager maintenant qu’une partie de ce peuple nié meure de faim, ou qu’il périsse sous le feu d’une armée qui, certes, ne le vise pas comme tel, mais l’atteint quoi qu’elle fasse dans des proportions qu’un État juif et démocratique ne peut accepter.
Les juifs n’ont pas droit à l’illégitimité, c’est-à-dire à ignorer ce qui dans la fondation de l’État juif, relève précisément du droit international qui exige que le droit des peuples soit respecté. Mais les Palestiniens n’ont pas droit à l’antisémitisme dont la réalité fait effectivement toute la légitimité d’Israël en dernier ressort. Or les Palestiniens, représentés par le Hamas, ont porté atteinte à cette légitimité-là – en consonnance et avec l’approbation, parfois déniée, parfois pas, de nombreux autres acteurs disséminés dans le monde. Sans un retour sur soi de ce camp-là, focalisé sur ce point précis, il n’y aura pas d’avancée possible. Inversement, sans que soit abolie la légitimité du gouvernement israélien actuel à faire la guerre comme il la fait, et à effacer la question nationale palestinienne de l’agenda politique de l’État juif, et donc sans que soit relancée la critique démocratique et juive de l’Israël actuel comme ce qui guide le conflit vers sa fin, nulle issue ne se dessinera non plus.
Tout, actuellement, empêche que ces légitimités croisées, et les gestes de transformations qu’elles impliquent de chaque côté, puissent accéder à la reconnaissance. Pourquoi cela, si la séquence 7 octobre-Gaza a bien cette fonction de révélateur qu’on vient de voir ? Pourquoi, du négatif, est-il actuellement impossible de tirer la vraie photographie, celle qui permettrait de distinguer les traits de la situation, dans ses nuances, ses lumières et ses profondeurs qui font toute sa vérité ?
Parce que la séquence 7 octobre-Gaza est venue s’inscrire dans un régime de conscience, dans l’opinion occidentale particulièrement, qui la découpe en deux et redéfinit chaque pôle en le déformant. Un glissement s’est produit à cet égard, qui ne date pas d’hier mais qui délivre aujourd’hui tous ses effets idéologiques. Le 7 octobre est une attaque qui a certes jeté le trouble. N’y aurait-il pas là de l’antisémitisme ? « Contextualisons » fut le balancement des plus prudents dans la dénégation, quand d’autres n’hésitaient pas à célébrer un «acte de résistance », quitte à assortir l’hommage, comme vient de le faire Judith Butler, d’une réserve d’ordre esthétique. C’est qu’il y a urgence à occulter dans l’événement, non seulement le crime, mais l’acte où se joue précisément la légitimité de l’État d’Israël, dont on ne veut à aucun prix et qu’on a par avance requalifié en État colonial. Mais État colonial de quoi, ou encore face à qui ? C’est ce qu’on ne sait plus définir non plus, puisqu’on a systématiquement effacé les composantes du peuple palestinien, sa différenciation interne, et du même coup les conditions lui permettant de se constituer en entité nationale se donnant un État. Le Hamas, mouvement islamiste régissant Gaza comme une citadelle militaire, a prospéré sur cette inconscience généralisée.
Et symétriquement, l’extrême droite israélienne s’est nourrie tout autant du même travestissement. Elle aussi est en consonnance avec le déni occidental d’un conflit entre deux prétentions nationales différemment, mais également légitimes. Elle aussi, alors qu’elle prétend le contraire, tourne le dos au 7 octobre, qui est l’ouverture d’une séquence où les deux légitimités se disposent en regard l’une de l’autre et doivent nécessairement se mesurer dans ce qu’elles disent vraiment. Elle aussi démembre les deux pôles de la séquence qui se prolonge par la guerre dans Gaza, pour empêcher qu’elle dégage l’entièreté de sa signification, qui est de remettre sur le métier la solution à deux États, sur la base d’une prise de conscience de l’antisémitisme d’un côté – qui a évidemment sa version arabe islamiste, suffisamment virulente pour motiver les actes qu’on vient de connaître – et d’une intégration de la question nationale palestinienne à la politique intérieure et extérieure d’Israël de l’autre.
Ce qui suppose d’abord de cesser la guerre telle qu’elle est actuellement menée.