Le livre de David Nirenberg — Anti-Judaism. The Western Tradition, paru en 2009 (et disponible en traduction française chez Labor et Fides) — marque un tournant dans le domaine des études juives. Son objet n’est pas tant l’étude des Juifs eux-mêmes, ou même de l’antisémitisme, que celle d’une structure qui, à travers les siècles, construit le judaïsme comme une sorte de repoussoir. Pour Nirenberg, c’est toute la pensée occidentale qui est ainsi structurée. Si les Juifs ne sont pas si nombreux (ni si puissants), l’antijudaïsme, lui, est bien partout : il est au cœur de la tradition occidentale, de même qu’il trouve sa place dans l’islam.
David Nirenberg était un des intervenants du documentaire de Jonathan Hayoun — Histoire de l’antisémitisme — diffusé sur Arte en avril 2022. Quelques unes de ses interventions dans ce film ponctuent l’entretien inédit de K.
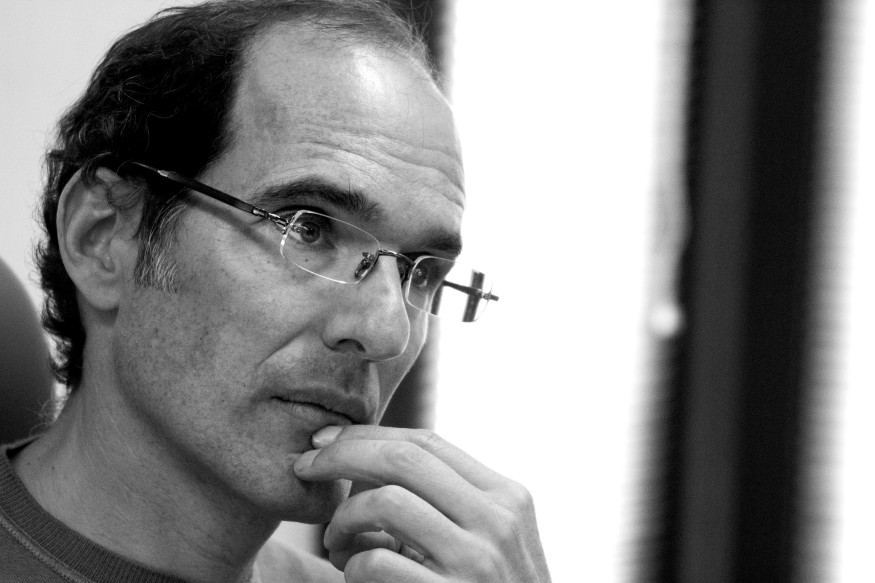
David Haziza : Votre livre Anti-Judaism – The Western Tradition, paru en 2013 et salué à l’époque comme l’une des œuvres les plus marquantes dans ce domaine, va être publié à l’automne en français, chez Labor et Fides. Pour commencer, qu’est-ce que l’antijudaïsme dont vous parlez et en quoi se différencie-t-il, par exemple, de l’antisémitisme ?
David Nirenberg : L’antisémitisme est généralement compris comme un genre de haine dirigé contre un groupe spécifique de gens, les Juifs. Par « antijudaïsme », j’entends pour ma part une manière de penser qui voit le monde comme menacé par le « judaïsme », lequel est alors compris non comme un peuple ou une religion spécifique, mais comme une autre manière de penser, d’interpréter le réel, fausse, corrompue, et même mortifère. L’antijudaïsme ne nécessite pas la présence de Juifs réels, et il va, par exemple, attaquer comme « juifs » les médias ou l’argent, le marxisme ou le capitalisme sans se préoccuper de ce que des Juifs de chair et d’os y soient en effet impliqués. Pour aller plus loin, je dirais que l’antisémitisme, lui, n’est qu’une sous-catégorie d’antijudaïsme : il y a, après tout, assez peu de Juifs dans le monde, même si l’antijudaïsme est très répandu !
D.H. : Mais alors que dit l’antijudaïsme ?
D.N. : Il consiste en une sorte de démasquage : à ses yeux, il existe, dans les discours, les lois, les traditions, les signifiants qui nous entourent, l’argent et les médias comme signifiants, une couche qu’il s’agirait d’ôter. Le « judaïsme », lui, c’est le désir d’en rester à cette couche. L’antijudaïsme tel que je le définis est une manière de penser que j’estime fondatrice pour la tradition occidentale. En effet, comme vous le suggérez, elle se distingue de l’antisémitisme et même de l’antijudaïsme dont parlent d’ordinaire les historiens quand ils évoquent l’animosité de l’Eglise vis-à-vis de la religion juive. « Mon » antijudaïsme est une façon de se positionner par rapport à une autre manière de penser, imaginée comme « judaïsme » mais qui n’a pas beaucoup à voir avec le judaïsme véritable. Contre ce « judaïsme » qui est vu comme le contraire même de la pensée vraie va donc s’organiser un antijudaïsme : ce que j’ai essayé de montrer dans mon livre, c’est que cet antijudaïsme est au fondement de ce que l’Occident appelle « pensée ».
D.H. : Ce qui implique que l’antijudaïsme tel que vous le définissez ne se limite pas à la théologie chrétienne, mais il y a donc tout de même un rapport avec le christianisme ?
D.N. : Historiquement, le christianisme a peut-être bien jeté les bases de l’antijudaïsme. « La lettre tue mais l’esprit vivifie », proclame la Seconde Epître aux Corinthiens. Le christianisme va se constituer autour d’une quête de l’esprit compris comme l’antonyme de la lettre, de la surface, de la loi, du rite, de la chair, etc. La lettre étant à l’esprit ce qu’Israël selon la chair est au verus Israel, à l’Israël selon l’esprit – soit l’Eglise. C’est le thème du pharisien, de l’hypocrite qui se fait un masque de la Loi et de ses rituels.
D.H. : On est pourtant beaucoup revenu, ces dernières décennies, sur la dimension juive de Paul et des apôtres, voire de Jésus lui-même…
D.N. : Je ne sais pas ce que Paul croyait lui-même, ni qui il était. En fait, tel n’est pas mon objet. Si l’on s’en tient à ses textes, il est d’une part évident que la critique du sens littéral de la Loi et des Ecritures va plus loin que ce que serait justement une simple critique : le sens littéral est dangereux, et donc le Juif est dangereux ; d’autre part il est très clair que « judaïser » est une grave accusation, et que tout ce que le christianisme doit être est l’inverse de cette attitude, que Paul reproche par exemple à Pierre.
D.H. : Est-ce que vous ne lisez pas Paul un peu trop comme Marcion[1] ?
D.N. : Marcion est allé plus loin et a permis à l’Eglise naissante de se structurer autour d’un antijudaïsme plus nuancé et complexe lorsqu’elle a essayé de lui répondre et de le contrer. Il a poussé jusqu’au bout l’opposition entre chair et esprit, refusant l’idée que le vrai Dieu, forcément étranger au monde, ait pu créer la chair… et la Torah. Les attaques de Marcion, un paulinien radical donc, contre le canon biblique, ont façonné le premier âge du christianisme, qui a dû se distinguer de cet extrémisme menaçant tout l’édifice de la foi. En vérité, le premier à avoir tenté (sans succès) de fixer un canon chrétien, c’est Marcion lui-même – en en éliminant tout ce qui sentait trop le judaïsme ! La réponse des théologiens orthodoxes fut que la Loi devait être lue d’une manière non-charnelle, ce qui impliquait que Marcion avait raison d’y voir une désagréable carnalité, mais tort de faire comme les Juifs eux-mêmes et de s’y arrêter. Renversement de l’accusation : accusés de judaïser, ils vont faire de Marcion un Juif incapable de lire correctement – soit non charnellement – les Écritures.
D.H. : On est donc toujours le Juif de quelqu’un…
D.N. : C’est très clair pendant l’Antiquité tardive. Saint Jérôme accuse les chrétiens épris de représentations artistiques de judaïser : la position « orthodoxe » de l’Eglise primitive est aniconique et aux yeux de Jérôme, l’attitude de certains chrétiens, qui veulent orner leurs lieux de culte de représentations, est une forme grossière de judaïsme, d’attachement immature à l’enveloppe extérieure et charnelle, au matériel et visible[2]. Mais le même Jérôme a été accusé de judaïser à cause de ses affinités avec le texte hébraïque (contre la Septante) et donc sa tendance à accepter l’autorité de la lettre juive.
D.H. : Y a-t-il de l’antijudaïsme, au sens où vous l’entendez, avant le christianisme ?
D.N. : Oui, je commence mon enquête dans l’Alexandrie hellénistique. C’est là que se structure un discours égyptien visant les Juifs, repris ensuite par les auteurs latins. Les Juifs sont désignés comme alliés ou agents du pouvoir et réciproquement : Néron, par exemple, sera vu comme un ami des Juifs. En outre, l’opposition entre chair et esprit, entre lettre et esprit, a évidemment des connotations platoniciennes.
D.H. : L’antijudaïsme est donc une idée qui s’incarne dès l’origine sur le plan politique ?
D.N. : Oui. Les Alexandrins formulent déjà leur antijudaïsme comme un discours visant le pouvoir colonial, romain. Le signifiant juif représente à leurs yeux ce pouvoir. De même, à Rome, la dénonciation des empereurs s’opère sur un mode antijuif : Claude ou Poppée, la femme de Néron, sont désignés comme juifs, et peu importe qu’ils ne l’aient pas été réellement, ce qui compte, c’est le signifiant juif qui permet de les mettre en accusation[3]. Chez les Pères de l’Église, le pouvoir temporel est fréquemment décrit comme « juif » puisque du côté de la chair, du lieu, de la terre. Quand les chrétiens prennent le pouvoir, sous Constantin, la politique chrétienne se voit décrite (par Eusèbe de Césarée) comme un constant combat contre la politique juive. Pour Ambroise de Milan par exemple, l’empereur Valentinien « est devenu juif ». Encore une fois, le Juif peut tout à fait être un chrétien et n’avoir pas grand-chose de réellement juif. L’antijudaïsme est une manière de penser, de voir et de décrire le monde, une typologie. Pourquoi, par exemple, les attaques demeurées célèbres, en 386, de Jean Chrysostome contre les Juifs ?
D.H. : Est-ce que le consensus académique n’affirme pas que les Juifs constituaient encore à l’époque une menace sévère contre le christianisme, que les chrétiens restaient attirés par les rites juifs, notamment dans l’environnement de Jean Chrysostome ?
D.N. : Certes, mais il y a autre chose. Sa théologie lui avait appris à lire en termes juifs des dangers internes au christianisme. La cible initiale, ce sont les ariens, des hérétiques à ses yeux. En s’en prenant aux Juifs, il ne change pas tant de cible que de munition. Le Juif, c’est la figure d’un problème épistémologique et politique plus général, le problème de l’hypocrisie, mais aussi du pouvoir : c’est comme Juif que Jean Chrysostome décrit Julien l’Apostat. Que ce dernier ait voulu en effet aider les Juifs à reconstruire leur temple a dû y aider, mais c’est avant tout que le Juif n’a pas besoin de l’être réellement. Julien n’était « juif » qu’en tant qu’il avait perçu que le christianisme se voyait comme un dépassement du judaïsme, et que toute preuve que le judaïsme n’était en rien dépassé était une réfutation du christianisme. En ce sens, Julien semble avoir très bien compris la place de l’antijudaïsme dans la constitution de l’autorité et de l’identité chrétiennes.
D.H. : De quelle manière le Moyen Age va-t-il déployer ces fantasmes patristiques ?
Au Moyen Age, l’antijudaïsme sert de même à critiquer le pouvoir des princes, décrits comme amis des Juifs, voire comme amants des Juives ! C’est le cas d’Alphonse VIII de Castille au début du XIIIe siècle. Nous ne savons pas si la Juive qu’il est censé avoir aimée a existé, mais ce symbole a beaucoup compté et a engendré toute une littérature, de l’amante juive du comte de Soissons au personnage d’Esterka, favorite supposée du roi Casimir III de Pologne au XIVe siècle. Les Juifs appartenaient alors au prince, ils en étaient les servi, esclaves ou serviteurs. Cette idée est codifiée d’une manière qui fait écho à une autre idée, augustinienne, celle du Juif comme « lettre vivante » elle-même illettrée mais destinée à être lue, et interprétée, par le chrétien – du Juif, en somme, comme esclave du sens que lui donne le chrétien. De même, dans le champ politique, le Juif ne s’appartient pas, il est la chose, la propriété du souverain. Lettre vivante et donc à moitié morte, chair sans esprit… Or il se trouve qu’une relation privilégiée a découlé de cette équivalence théologico-politique, qui a grandement servi les monarchies européennes et a contribué à leur développement en investissant les Juifs de privilèges bureaucratiques et fiscaux. Cela dit, en tant que sujets dépourvus de droits de propriété et ne pouvant résister aux levées de taxes, les gains de ces derniers, quelle que fût leur activité – et cela inclut l’usure – profitait ultimement aux rois.
D.H. : C’est là que l’antijudaïsme va se faire à nouveau critique du pouvoir ?
D.N. : Ou l’inverse. Mais il y a en tout cas un lien entre antijudaïsme et résistance antimonarchique. Les Juifs sont attaqués, et les rois sont décrits comme Juifs, parfois leurs sujets eux-mêmes comme « enjuivés ». La première caricature antisémite que nous connaissions date de 1233 et vient d’Angleterre. On y voit une cité dominée par une armée de démons et au centre un démon tenant par le nez un Juif et une Juive. Au-dessus d’eux, l’Antéchrist à trois têtes, couronné à l’image du roi d’Angleterre (recevant les taxes de la cité opprimée par son armée démoniaque ou fiscale). Or son nom n’est pas celui d’Henri III, qui règne alors, mais du puissant banquier juif Isaac de Norwich !
D.H. : Vous faites d’ailleurs le lien entre cet antijudaïsme politique et les accusation de crime rituel.
D.N. : Oui, on passe progressivement d’une critique des rites supposés mortifères à la dénonciation de rites fantasmés comme meurtriers, d’imaginaires crimes rituels, l’antijudaïsme utilisant ce motif superstitieux – mais aussi théologiquement très riche – pour dénoncer le pouvoir monarchique protecteur des Juifs. L’antijudaïsme, processus de dévoilement, se veut le dévoilement du pouvoir auquel est reproché son manque d’authenticité chrétienne et sa protection injuste des Juifs infidèles, perfides et criminels. Cela a évidemment des échos contemporains : qu’on pense au complotisme, qui est une forme paroxystique d’antijudaïsme, même quand il ne vise pas directement les Juifs de chair et de sang.
D.H. : On s’imagine généralement une Réforme « pro-juive » mais à vous lire il semble qu’il ait bien existé un antijudaïsme typiquement protestant.
D.N. : Érasme (qui n’est pas protestant) et Luther accusent leurs adversaires de judaïser, et comme on le voit, ils ne sont pas les premiers. Erasme dit d’ailleurs à ce propos que « si haïr les Juifs suffisait à faire de nous des chrétiens, il n’y aurait que de bons chrétiens partout », reconnaissant ce faisant que l’antijudaïsme est une étape constitutive du christianisme, mais en même temps et non sans ironie, qu’elle ne suffit pas. Cela signifie que leurs visions différemment réformatrices vont se constituer comme antijudaïsmes, comme des formes d’opposition à une manière de penser identifiée comme juive, mais qui est en l’espèce celle de bons chrétiens – et, soit dit en passant, d’ennemis du judaïsme, du « vrai » judaïsme. L’antisémitisme de Luther est bien connu, mais je vais plus loin. Dans le projet protestant lui-même, il y a une forme d’antijudaïsme. Pour Luther, la découverte de la justification par la foi constitue la rupture définitive, prêchée par Paul en son temps, avec le judaïsme. L’Église catholique, par son attachement aux rites et sa compréhension légaliste de la justice divine, est « plus juive que les Juifs » de sorte, ironise Luther, qu’« il faudrait presque se faire juif pour devenir un bon chrétien »[4]. Cette phrase précède de vingt ans le texte sur les Juifs et leurs mensonges (1543). Elle n’est pas du tout chargée de la même hostilité, mais elle témoigne déjà de l’antijudaïsme comme manière de penser de Luther, et de son lien intrinsèque avec le projet protestant, lequel semble s’être parfois compris comme une déjudaïsation plus complète, une supercession plus totale que celles des Pères de l’Église.
D.H. : Mais l’antijudaïsme, pris au sens que vous lui donnez, ne se limite aucunement à la théologie chrétienne. Pourriez-vous revenir sur ses liens avec la modernité ?
D.N. : Les Lumières peuvent se comprendre comme un vaste mouvement de révolte contre le judaïsme. Spinoza s’en prend à toutes les Églises, mais il use, comme ses prédécesseurs chrétiens de l’accusation de judaïser. Il n’est d’ailleurs pas loin de se voir comme un nouveau Jésus prêt à purifier le Temple… Chez lui, le « judaïsme », qui peut aussi bien être chrétien, consistera à voir l’Ecriture comme intégralement inspirée et divine et, par là, à ravaler et Dieu et l’homme au rang des bêtes, puisque l’idée que s’en formaient les auteurs de la Bible était inadéquate et bestiale, grossièrement matérielle. L’antijudaïsme, ici, c’est donc d’abord la critique biblique. On doit rappeler quand même que Spinoza reprend à son compte les thèmes supercessionnistes en les radicalisant d’une façon qui aurait été, en fait, impossible à un chrétien – par exemple en ravalant systématiquement la prophétie mosaïque au profit de la prédication du Christ qui, lui, aurait employé le langage de la raison. Il est à noter que des traductions françaises clandestines du Traité théologico-politique circulaient sous le titre évocateur de Traité des cérémonies superstitieuses des Juifs tant anciens que modernes. On sait ce qu’il en est de l’antijudaïsme chez les « philosophes », chez Voltaire en particulier. L’intolérance, c’est le judaïsme ! Un exemple peut-être encore plus paroxystique que Voltaire est Kant. Celui-ci, à la différence de Voltaire, se dit chrétien, mais son christianisme se veut éclairé en ceci, justement, qu’il aurait complètement rompu avec le judaïsme compris comme esclavage à l’égard de la loi, des formes, des rites. L’Aufklärung serait alors, dans les termes de Kant, « l’euthanasie du judaïsme ». C’est la même intuition, encore plus radicalisée, qui guide Marx lorsqu’il affirme que l’Occident, s’il le devait, engendrerait le judaïsme « de ses propres entrailles » et que l’émancipation des Juifs ne peut qu’être l’émancipation de la société par rapport au judaïsme. Les Lumières, puis la Révolution, se pensent bel et bien comme des projets antijuifs.
D.H. : La Révolution française aussi ?
D.N. : Il y a de ça, oui, même si c’est elle qui a émancipé les Juifs « réels ». Je cite par exemple le discours prononcé par l’évêque constitutionnel Sermet pendant la Fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. Dans ce discours, Sermet décrit la Révolution comme un moment paulinien, la nouvelle France étant à l’ancienne ce que le christianisme est au judaïsme. D’ailleurs, le thème paulinien de la régénération, comme l’a montré Mona Ozouf, était alors partout. On retrouve, chez les jacobins, un autre thème, celui de la conversion hypocrite, pharisienne… Cela dit, les jacobins s’en sont rarement pris aux Juifs de chair et de sang, du moins en tant que Juifs. Là encore, l’antijudaïsme est bien une manière de penser, une typologie intellectuelle. Du reste, s’est développé à la même époque un antijudaïsme contre-révolutionnaire. Burke décrit les révolutionnaires français comme la « vieille Juiverie » (Old Jewry), des hypocrites prêts à détruire le monde au nom de leurs intérêts égoïstes, de mesquins légistes, comptables et commerçants.
D.H. : On retrouve là les deux pôles – gauche et droite – de l’antisémitisme contemporain… Votre réflexion rejoint en tout cas celle de Jean-Claude Milner dans Les penchants criminels de l’Europe démocratique. Est-ce qu’il y aurait dans cette modernité antijuive que vous décrivez une forme de marcionisme moderne ?
D.N. : En un sens oui, mais par définition sans la quête métaphysique de Marcion. Pour en revenir à Kant, son essai sur La Religion dans les limites de la simple raison sonne comme du Luther mais Kant va beaucoup plus loin. Le Christ, à l’en croire, ne doit rien au judaïsme ! Et le christianisme ne saurait s’atteindre réellement, devenir ce qu’il doit être depuis toujours – une religion universelle d’amour et de raison – qu’en rompant définitivement avec ses origines, ou plutôt son masque juif.
D.H. : Pourtant, le Juif a été décrit comme vecteur de la modernité. Il y a un lien, par exemple, entre antijudaïsme et haine de la presse moderne, de l’imprimerie déjà…
D.N. : Les vieux stéréotypes associant les Juifs au commerce, à la ruse mercantile peuvent se comprendre dans les termes de l’antijudaïsme – tel que je le définis – comme une critique de la raison instrumentale, dont les Juifs seraient les esclaves et les vecteurs. Et de là, de la modernité rationnelle, « cartésienne ». Pour la presse, c’est autre chose. Le Juif, c’est la lettre, donc les médias. L’imprimerie est vue comme juive pour cette raison, et la presse, de même, au XIXe siècle, internet aujourd’hui. De là naît une dialectique et un renversement permanent. L’imprimerie est juive et en même temps, c’est elle qui va soulever les masses contre les Juifs et le judaïsme, en usant du rapport nouveau, plus fluide, à la lettre, que sa technique permet. Il se passe la même chose de nos jours avec internet. Chaque nouvel avatar de la « lettre qui tue » est juif et est en même temps pensé comme tremplin de l’antijudaïsme.
D.H. : Vous avez mentionné Spinoza. Pensez-vous que la critique biblique, dont il est en quelque sorte le père, est restée une forme d’antijudaïsme ?
D.N. : Certainement pas la critique biblique en général, mais il est évident que l’hypothèse documentaire classique, celle de Wellhausen, s’inscrit dans une double démarche, chrétienne (protestante) et moderne, de démasquage du judaïsme – identifié en l’occurrence à une source spécifique du Pentateuque, la source sacerdotale, dont Wellhausen dit qu’elle bloque l’accès au ciel, contre d’autres, en particulier le Deutéronome. Il existe cependant d’autres formes de critique biblique, voire d’hypothèse documentaire. Benjamin Sommer, dans Revelation and Authority, retourne le problème en retournant Wellhausen contre lui-même et en montrant que dans le judaïsme, le vrai cette fois, la lettre ne compte pas tant que son substrat oral : la Torah est orale, et donc mouvante, avant d’être écrite, et l’hypothèse documentaire permettrait justement de retrouver cette dimension orale figée par l’Ecriture.
D.H. : Certains, à l’époque de Wellhausen, je pense au philosophe kantien Hermann Cohen, ont décrit le judaïsme comme une rupture avec le monde du mythe. J’ai l’impression, à vous lire, que l’antijudaïsme serait justement une forme de réenchantement du monde : aller chercher derrière la lettre, derrière le signifiant, derrière la surface, on ne sait quel secret…
D.N. : Pas tout à fait, non. A mon avis, c’est l’antijudaïsme qui serait plutôt une forme de démythologisation. L’antijudaïsme voit la lettre comme étant du côté du mythe. La superstition « judaïque » et dénoncée comme telle, c’est le monde du mythe. Et la modernité antijuive reprend tout à fait cette idée comme on le voit avec Kant qui veut débarrasser complètement la pensée occidentale de ses restes de judaïsme. Je dois ajouter que je ne suis pas moi-même un grand avocat des démythologisations : plus d’un domaine de l’expérience humaine ne s’approche que par le mythe !
D.H. : L’islam a aussi une tradition d’antijudaïsme, qui a des implications contemporaines évidentes, dont vous détaillez l’origine. Pourriez-vous revenir là-dessus ?
D.N. : C’est une tradition puissamment enracinée dans l’islam en effet, présente dès le Coran et développée au moyen de références dans la Sirat Rasul Allah, la première biographie de Mahomet, où il est rapporté qu’enfant, l’oncle de ce dernier fut mis en garde contre les Juifs par un moine. Dans la Sirat, les Juifs sont systématiquement utilisés afin de construire une certaine narration de la vie du prophète, où ils jouent le rôle d’ennemis. C’est cette inimitié qui va propulser l’édification de la tradition islamique. Le Juif est décrit comme un insoumis et un corrupteur. Le « vrai » judaïsme est au cœur de la tradition prophétique que le Coran s’approprie, mais il l’oppose au judaïsme des Juifs « réels », qui sont des hypocrites et des falsificateurs. Ce qui domine, c’est le thème du judaïsme comme hypocrisie, thème emprunté à la critique chrétienne du pharisaïsme – du « judaïsme ». Judaïser, c’est être hypocrite, et être hypocrite, c’est judaïser. Le musulman insincère se met du côté des « Gens du Livre », il a comme attrapé leur maladie. La duplicité juive est ainsi érigée en axiome de l’ontologie coranique. Il reste intéressant de voir que cet axiome se raconte d’abord comme une leçon des chrétiens : tout commence avec ce moine. Il n’y a nul moyen de savoir si ce fait en est un mais ma méthode s’en préoccupe peu : se non è vero, è ben trovato[5]!
D.H. : De chrétiens qui étaient des Juifs… Il y aurait à l’origine un antijudaïsme juif ?
D.N. : En y réfléchissant, je me dis que j’aurais pu commencer là, oui. Les premières traces de cette opposition entre lettre et esprit, et donc d’antijudaïsme, se trouvent chez les prophètes de la Bible, chez Jérémie par exemple, et dans certains psaumes : on peut songer au psaume 40, avec sa critique des sacrifices. Toute la thématique des sacrifices, de la religion purement extérieure, des mots qui cacheraient la vérité du cœur existe dans la Bible hébraïque avant de devenir si essentielle à la constitution du christianisme.
D.H. : L’antijudaïsme serait donc carrément une invention juive ?
D.N. : Non, bien sûr. Pour qu’un discours devienne si dominant, il a fallu qu’il soit surdéterminé. Mais il est certain que les communautés sectaires qui allaient être à l’origine du christianisme et de l’islam ont puisé leur logique dans ces éléments bibliques, qui eux-mêmes devaient probablement à l’influence d’autres peuples. L’antijudaïsme, ne l’oubliez pas, ne fait qu’utiliser le signifiant juif pour penser le monde – indépendamment de l’existence des Juifs.
Propos recueillis par David Haziza
David Nirenberg est né en Argentine en 1964. Il a enseigné à l’Université de Chicago, où il a été membre du ‘Committee on Social Thought’. Il dirige aujourd’hui l’’Institute for Advanced Study’ à Princeton, l’un des centres de recherche les plus prestigieux au monde. Il a travaillé sur les minorités au Moyen Age [‘Violence et minorités au Moyen Age’, Presses Universitaires de France (2001)]. Son livre ‘Anti-Judaism – The Western Tradition’, paru en 2013 — et disponible en traduction française dans quelques mois chez Labor et Fides – marque un tournant dans le domaine des études juives.
Notes
| 1 | Contemporain des origines de l’Église, Marcion, au premier siècle, développe une doctrine qui entend rompre radicalement avec la tradition juive. |
| 2 | Durant l’Antiquité tardive, les synagogues sont très ornées, y compris de représentations humaines, tandis que les églises mettent du temps à le devenir. On peut citer le cas exemplaire de la synagogue de Doura-Europos (ndlr). |
| 3 | La légende de Poppée « judaïsant » trouve un écho chez Flavius Josèphe, qui la décrit comme amie des Juifs (ndlr). |
| 4 | Dans « Das Jesus Christus ain geborner Jude sey » de 1523. |
| 5 | « Si ce n’est pas vrai, c’est bien trouvé » (ndlr). |










