Shulim Vogelmann est né à Florence en 1978, deux ans avant la maison d’édition Giuntina fondée par son père Daniel. Après une expérience en Israël, racontée dans son livre ‘Mentre la città bruciava’, Shulim a repris l’entreprise d’édition de son père, la restructurant et la développant. Tous ses livres sont liés, d’une manière ou d’une autre à la tradition, la culture, l’histoire et la littérature juives. Giuntina représente aujourd’hui le cas unique en Italie d’un petit éditeur spécialisé dans le judaïsme qui s’insère pleinement dans le débat culturel et les idées.

Giorgio Berruto : La Giuntina est née à Florence en 1980. Mais peut-être est-elle née plus tôt, beaucoup plus tôt, avec votre père Daniel ou peut-être même avec votre grand-père dont vous portez le prénom. Quelles sont les origines de votre maison d’édition et dans quelle mesure sont-elles liées aux événements survenus dans votre famille ?
Shulim Vogelmann : Mon grand-père Shulim Vogelmann venait de Galicie. Pendant la Première Guerre mondiale, la famille a déménagé à Vienne puis mon grand-père est parti en Palestine à l’âge de seize ans. À la gare de Vienne, ses parents lui ont dit : « Nous ne te demandons pas de manger tous les jours avec un couteau et une fourchette, mais au moins d’être honnête ». Il est parti et ne les a plus jamais revus. Il a vécu pendant trois ans en Palestine, il aurait voulu rester avec les pionniers, mais il n’a pas trouvé de travail. Il s’est engagé dans l’armée britannique, mais il n’y était pas à l’aise. Son frère Mordechai Vogelmann, qui était rabbin et enseignait à l’époque au collège rabbinique de Florence, l’a invité à venir en Italie. Shulim est arrivé à Florence, où il a cherché un emploi qui lui permettrait d’observer le shabbat. Il y avait là l’imprimerie d’un juif, Olschki, où il a commencé à travailler, d’abord comme ouvrier, puis comme directeur de l’imprimerie. Entre-temps, il a épousé la fille du rabbin de Turin, Dario Disegni. Cas plutôt rare pour un juif, à l’époque des lois raciales et au moment où les Juifs vendaient et liquidaient les entreprises qu’ils possédaient, il a pu reprendre l’imprimerie avec un associé.
Après le 8 septembre 1943[1], Shulim et sa famille ont tenté de se réfugier en Suisse, mais ils ont été arrêtés par les fascistes à la frontière et déportés à Auschwitz, où la femme et la fille de mon grand-père ont été immédiatement tuées. Il a, lui, été sauvé, le seul Italien à être inclus dans la liste de Schindler. À son retour de déportation, il est retourné travailler à l’imprimerie Giuntina et a trouvé la force de commencer une nouvelle vie. Il a rencontré une veuve lors d’une fête de Hanukkah dans la communauté juive, s’est remarié avec elle et mon père Daniel est né. En grandissant, mon père a souffert de tous les problèmes typiques de la deuxième génération, c’est-à-dire des enfants de survivants dont les pères ne disaient rien. L’imprimerie ne l’intéressait pas, mais un jour, il est entré dans la librairie Feltrinelli et, dans une boîte de livres en langues étrangères, son regard est tombé sur un petit volume d’Élie Wiesel, La Nuit. Il l’a lu et a découvert ce que son père ne lui avait jamais dit. Il a décidé qu’il devait absolument traduire et publier le livre de Wiesel. Comme il était encore lié à l’imprimerie Giuntina, il l’a imprimé et c’est alors que son aventure dans l’édition a commencé. D’abord, un ou deux livres sortaient par an, presque tous des essais ou des témoignages sur la Shoah, mais en 1987, Wiesel a obtenu le prix Nobel de la paix et cela a fait grimper les ventes de La Nuit. Mon père a continué vaille que vaille, mais en 2007, l’imprimerie a fermé ses portes pour diverses raisons, dont la crise économique et l’avènement de la technologie numérique ; moi, qui venais de rentrer en Italie après six ans passés en Israël, j’ai décidé de reprendre l’entreprise pour qu’elle ne ferme pas, en renonçant à la charge de l’imprimerie et en remodelant la maison d’édition avec une structure plus légère et plus indépendante.

GB : La Nuit d’Élie Wiesel a donc été décisive à l’origine de la Giuntina. Je vous ai entendu un jour reprocher gentiment à votre père de ne pas avoir acheté les droits de toutes les œuvres de Wiesel au début des années 80, avant qu’il obtienne le prix Nobel et alors qu’il était pratiquement inconnu en Italie.
Au début, mon père a publié de nombreux livres d’Élie Wiesel, mais c’était un puriste : pour lui, publier un livre signifiait trouver quelque chose de vraiment très spécial. Il n’avait pas une vision commerciale, ni une vision éditoriale au sens industriel du terme, avec un projet capable de se tourner vers l’avenir, il n’a donc choisi que quelques textes de Wiesel. L’édition de livres était à la croisée des chemins entre une passion, une nécessité existentielle et l’heureuse circonstance de pouvoir compter sur la presse à imprimer. L’effort de production à maintenir était bien moins central qu’aujourd’hui.
GB : Depuis le début, avec Wiesel et d’autres auteurs, témoins ou savants, mais aussi romanciers, la Giuntina a porté une grande attention à la Shoah. C’était avant le documentaire de Lanzmann et la grande vague de films sur le sujet, avant l’institution de la Journée du souvenir, introduite en Italie par une loi d’État en 2000…
La Giuntina a commencé à s’intéresser à la Shoah bien plus tôt que les autres éditeurs italiens. Lorsque nous établissons le programme d’édition chaque année, nous nous disons que la Shoah a été suffisamment décrite, mais il arrive toujours que nous publiions un ou deux livres parce que la profondeur du thème touche à la racine des problèmes humains les plus fondamentaux tels que le mal, la survie, la transmission de la douleur, la mémoire et la narration. En tout cas, sur le marché de l’édition – en janvier autour du jour du Souvenir, mais pas seulement – cela reste central pour tout le monde. Une quantité folle de livres sur la Shoah sortent, même si beaucoup sont mineurs et répondent exclusivement à des fins commerciales. Il est parfois frustrant de publier un livre important et de le voir absorbé dans cet océan de nouveautés. Nous décidions volontairement de sortir des livres sur la Shoah à une autre période que le mois de janvier. Par exemple, nous avons publié six livres de l’écrivain israélien Lizzie Doron sur le thème de la deuxième génération en Israël. Nous venons de publier un livre très singulier de Piero Stefani, Le parole a loro (Les mots pour eux), avec un montage de textes dans lesquels s’expriment à la fois des élèves, des enseignants et des témoins. Nous ne nous fixons pas de limites de genre ou de style. Lorsqu’un livre fait entendre une voix originale, nous décidons de lui donner un souffle et nous le publions. L’année prochaine, nous lancerons une nouvelle série pour jeunes adultes avec un livre de l’écrivain anglais Keren David, What we’re scared of, qui ne raconte pas l’histoire de la Shoah, mais celle de jumeaux confrontés à l’antisémitisme contemporain. Il se lit d’une traite, je suis très curieux de voir comment il va être reçu.
GB : La collection qui porte le nom de votre grand-père et le vôtre, « Shulim Vogelmann », est la plus importante de votre maison et s’enrichit encore de nouveaux titres. Est-ce la collection qui résume le mieux l’identité et les objectifs de la Giuntina ?
Il y a quelques années, c’était certainement le cas, notamment parce que c’était notre seule vraie collection et que tous les genres y passaient : fiction, poésie, théâtre, témoignages, essais. J’ai introduit une nouveauté en distinguant la non-fiction de la fiction à travers deux nouvelles collections, « Israeli » pour la littérature israélienne et « Diaspora » pour le reste du monde. Mais aujourd’hui encore, la collection qui porte le nom de mon grand-père est celle qui rend la maison d’édition la plus reconnaissable. La plupart des titres les plus vendus du catalogue y figurent et nos lecteurs fidèles, indépendamment du contenu spécifique, puise principalement dans celle-ci.
GB : Vous êtes également l’auteur d’un livre qui m’est cher, Mentre la città bruciava[2]. Je me souviens l’avoir reçu en cadeau de mes parents en 2004, à leur retour de la Foire du livre de Turin.
Il s’agissait d’une expérience unique dictée par le besoin de raconter l’expérience que j’ai vécue, et non d’un livre imaginé par quelqu’un ayant l’ambition d’être écrivain. Le livre a eu beaucoup de succès, mais juste après sa publication, j’ai su que je ne ressentais pas l’urgence, l’impulsion, le désir de raconter d’autres histoires, ce qui, je pense, définit un écrivain. Peut-être que j’écrirai quelque chose à l’avenir, mais ce n’est pas ma voie, qui est au contraire celle de l’édition.
Pour faire son alya, il faut une force idéologique, ressentir un élan capable de faire de cet endroit le seul au monde pour soi et que l’on n’abandonnera sous aucun prétexte. Tout bien considéré, cette force n’était pas en moi.
GB : C’est à votre retour d’Israël que vous avez choisi de devenir éditeur. Était-ce l’évolution naturelle d’une décision déjà prise ou y a-t-il eu un véritable tournant ?
J’étais devenu israélien et j’avais fait mon service militaire, je pensais que j’allais construire ma vie en Israël. Mais ensuite, j’ai lu un livre en hébreu et je l’ai traduit, The Rosendorf Quartet, qui est devenu le premier volume de la série « Israeli ». Pour moi, c’était le premier pas dans le monde de l’édition. Non moins important, j’ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, qui étudiait à Barcelone à l’époque, et cela m’a ramené en Europe. Lorsqu’il est devenu évident que la maison d’édition allait tomber avec la fermeture de l’imprimerie, il ne s’agissait pas seulement de lancer un projet, mais aussi d’en sauver un autre. Je suis revenu d’Israël et j’ai commencé à travailler chez Giuntina. Je ne me suis jamais demandé si la reprise de la maison d’édition était une question de choix ou de destin, mais je me suis souvent demandé si mon départ en Israël avait été une réussite ou non et pour quelle raison. Pour moi, c’était une expérience qu’il était important de commencer, mais aussi d’achever. Peut-être que pour faire son alya, il faut une force idéologique, ressentir un élan capable de faire de cet endroit le seul au monde pour soi et que l’on n’abandonnera sous aucun prétexte. Tout bien considéré, cette force n’était pas en moi, et les circonstances ont creusé une faille.

GB : En 2004, vous avez lancé la série « Israeli », qui a contribué au succès en Italie de la fiction en provenance d’Israël. Comment expliquez-vous ce succès ?
C’est un mystère. Je crois qu’il n’y a qu’un seul autre pays dans lequel la littérature israélienne a un succès comparable à celui qu’elle a en Italie, c’est l’Allemagne. Cela fait réfléchir… Qui sait s’il n’y a pas un aspect psychologique de réparation chez les lecteurs italiens et allemands par rapport à ceux du reste du monde. Dans d’autres pays, certains romans israéliens ont du succès, mais on ne peut pas parler d’un véritable mouvement littéraire établi. En Italie, ce sont Oz, Yehoshua et Grossman qui ont ouvert la voie, Yehoshua restant le mystère des mystères, car il n’est vraiment apprécié qu’en Italie. Avant l’arrivée de la grande distribution en Israël, je recevais des livres plus ou moins beaux et réussis, mais jamais inutiles ou stupides. À mon avis, le contenu des textes israéliens s’impose grâce au contexte, celui d’un pays composé d’immigrants, de jeunes, avec une histoire de guerres et la Shoah derrière lui, où les carrefours sociaux et culturels entre différents mondes sont nombreux. Avec une telle société, la littérature a un avantage : elle a quelque chose à dire. À cela s’ajoute le pragmatisme typiquement israélien, avec des auteurs qui parlent rarement des détails et des futilités de la vie quotidienne et tentent plutôt d’aborder de grands thèmes. Même lorsqu’ils décrivent la vie à petite échelle dans un kibboutz, par exemple, ils parviennent à atteindre l’universalité de manière évidente et directe. Le lecteur le ressent et il est fasciné.
La société israélienne s’uniformise, les aspects traumatisants de la première période de l’histoire de l’État semblant s’estomper. La question que je me pose est de savoir si la littérature israélienne continuera à être une littérature forte à l’avenir.
GB : Selon vous, quel est le rapport entre la littérature juive et la littérature israélienne aujourd’hui ?
Il y a un lien, mais aussi un découplement, car la littérature israélienne fait partie de la littérature juive, tandis que la littérature hébraïque ne fait pas nécessairement partie de la littérature israélienne. Le rôle de la langue, à savoir l’hébreu, est fondamental au point qu’en Israël, la littérature locale est appelée sifrut ivrit, « littérature en hébreu ». Cependant, plus le temps passe, plus l’hébreu devient une langue familière avec de moins en moins de citations bibliques et finalement plus pauvre. Le fait que l’hébreu soit de moins en moins lié à ses racines bibliques et à la langue cultivée coïncide à mon avis avec le détachement progressif de la judéité dans les textes. Cela m’inquiète, les grands distributeurs poussant à la publication de plus en plus de livres de mauvaise qualité. Dans le même temps, la société israélienne s’uniformise, les aspects traumatisants de la première période de l’histoire de l’État semblant s’estomper. La question que je me pose est de savoir si la littérature israélienne continuera à être une littérature forte à l’avenir. Si je regarde la qualité des textes au cours des trente dernières années, je vois une ligne qui descend lentement.
GB : Qu’en est-il de la relation entre la littérature juive et la littérature européenne ? Dans le catalogue de Giuntina, on trouve des auteurs tels que Zweig, Benjamin, Arendt, Scholem… Existe-t-il aujourd’hui encore quelque chose comme une littérature juive européenne?
Il faut dire que le vingtième siècle a été le siècle juif en ce qui concerne la production intellectuelle et il y aurait bien d’autres noms que ceux que vous avez cités. À mon avis, le XXIe siècle n’est plus dans la même situation, en partie parce que tout s’épuise, en partie à cause de la mondialisation, en partie parce que la recherche de l’identité juive semble se fossiliser dans l’appartenance à Israël ou à une diaspora beaucoup moins vivante et indépendante que par le passé. Cela conduit à une sorte de stagnation culturelle. Il y a et il y aura toujours des intellectuels et des écrivains juifs, mais aujourd’hui le judaïsme est une minorité qui se mélange à de nombreuses autres minorités, à de multiples expressions culturelles du monde entier, chacune ayant quelque chose à dire. Souvent, au vingtième siècle, les Juifs, grâce à leur capacité à créer des réseaux, ont pu devenir un véhicule de propagation des idées et de la culture et ils avaient une vision européiste et universaliste innée quand d’autres poursuivaient des objectifs particularistes et nationalistes. Dans le volume que nous avons récemment publié avec les lettres de Stefan Zweig à un étudiant appelé Rosenkrantz, il y a un passage dans lequel Zweig reproche au jeune homme, qui édite un livre, de trop se concentrer sur l’Allemagne et de ne pas rendre le livre assez européen. C’est le début des années 30. À cette époque cette vision était typique du monde juif. Aujourd’hui, ce rôle n’est plus l’apanage du monde juif, qui risque au contraire d’abandonner son élan universaliste pour se limiter à la dichotomie Israël/diaspora, avec des effets délétères sur la production culturelle et littéraire.
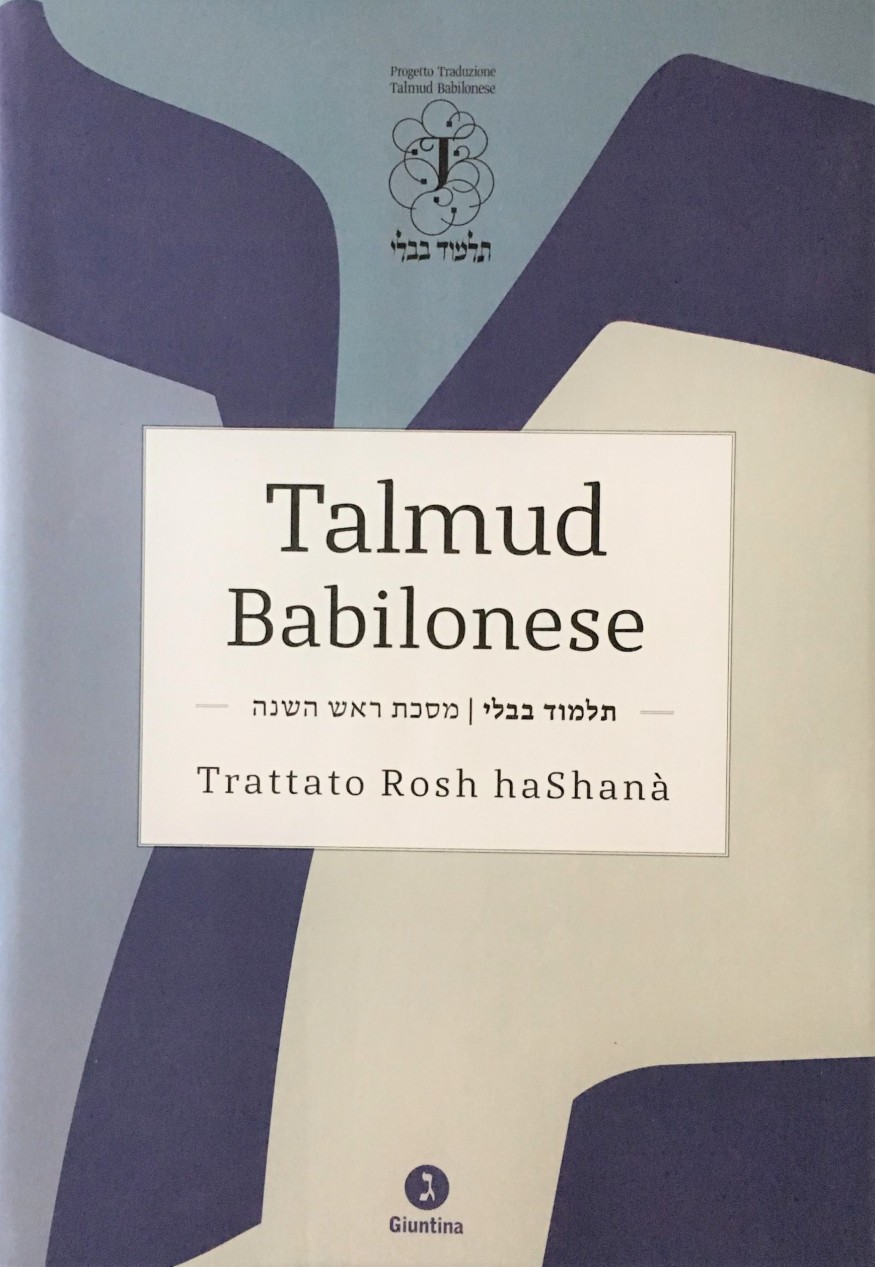
GB : En 2016, vous avez commencé à publier le Talmud de Babylone. Un exploit qui semble gigantesque pour un petit éditeur.
C’est colossal. Mais nous nous sommes occupés de l’impression, tandis que la traduction, l’édition et la révision sont gérées par le projet de traduction du Talmud de Babylone financé par l’État – et c’est un choix de grande valeur de la part de l’Italie, un choix de dialogue plus fort que n’importe quelle parole. Décider de publier en italien ce qui est l’œuvre fondamentale de la culture et de l’identité juives, plus encore peut-être que la Torah, est un geste de grande générosité. Du point de vue juif, la Torah écrite sans la Torah orale n’est pas compréhensible. Selon les maîtres, derrière chaque verset de la première se cache un verset de la seconde, la Mishnah, qui le complète et l’explique, et qui est ensuite discuté et commenté dans le Talmud. Ceux qui le souhaitent ont donc accès au texte en italien, même si la nécessité de s’adresser à un professeur pour en pénétrer les pages cryptiques demeure. Bien que cela ait déjà été fait dans d’autres langues, il s’agit d’un acte courageux, car, selon la tradition, la Torah orale ne doit pas être traduite. Notre édition est basée sur celle en hébreu avec ponctuation éditée par le rabbin Steinsaltz. C’est un grand honneur, mais aussi une grande charge, car la production est très coûteuse et prendra beaucoup de temps. En tout cas, c’est un privilège pour notre maison d’édition – qui entre dans le petit groupe de celles qui, dans le monde, ont affronté une telle entreprise – et pour moi une satisfaction personnelle. Je dois dire que les ventes sont très bonnes, même si, en procédant naturellement avec les volumes qui suivent le premier, elles ont tendance à baisser, signe que les lecteurs italiens intéressés par le sujet ont senti l’importance de l’opération culturelle et ont décidé de garder chez eux un livre qui contient l’une des grandes histoires millénaires de l’aventure humaine.
GB : À quoi ressemble le travail quotidien d’une maison d’édition comme la Giuntina ?
Nous avons une structure très légère. Nous sommes quatre, une jeune femme s’occupe du secrétariat et du travail administratif, nous avons un rédacteur en chef, une troisième personne s’occupe du graphisme et puis il y a moi. Cependant, nous avons de nombreux collaborateurs : traducteurs, agents, correcteurs d’épreuves. Pendant longtemps, j’ai organisé le festival de littérature juive à Rome, mais après dix ans, j’ai décidé d’arrêter parce que l’aspect littéraire était passé au second plan et que je voulais chercher de nouveaux stimuli. La Giuntina, c’est aussi la proximité et l’amitié de personnes qui collaborent avec leurs idées et leurs propositions, comprenant que derrière le travail de la maison d’édition, il n’y a pas que nous, mais aussi une histoire et un avenir qui peuvent être significatifs pour la présence culturelle juive en Italie.
Propos recueillis par Giorgio Berruto
Notes
| 1 | Note du traducteur : Date de la proclamation de Badoglio qui confirme l’armistice. |
| 2 | Mentre la città bruciava (Giuntina 2004), à l’intersection du journal intime et de la chronique, raconte la vie en Israël d’un jeune juif italien. La quête d’identité du protagoniste s’inscrit dans le contexte social dynamique et tendu des années de la seconde Intifada. |









