Entretien avec Daniel Mendelsohn – Épisode 2
Le style d’écriture de Daniel Mendelsohn est fait d’un savant mélange entre les récits personnels et l’évocation d’œuvres littéraires classiques ; entre l’intime et l’intellectuel. D’où vient, chez Daniel Mendelsohn, cet attrait pour la philologie ? En quoi cela a-t-il à voir avec son histoire familiale faite de tragédies et d’exils, avec le fait d’être juif, et d’être homosexuel ? Telles sont les questions que Daniel Mendelsohn a bien voulu explorer avec nous dans ce deuxième épisode de notre entretien.
> Lire l’épisode 1 de l’entretien : « À la recherche du ‘genre Mendelsohn’ »

Adrien Zirah : Il y a une phrase qui m’a intrigué dans votre dernier livre, Trois anneaux. Un des principaux personnages, et le premier sur lequel vous vous arrêtez, est Erich Auerbach, un philologue juif allemand, qui doit s’exiler en Turquie au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il écrit son grand œuvre Mimèsis en exil. Vous revenez plus particulièrement sur le premier chapitre de ce livre dans lequel Auerbach compare et oppose les deux styles narratifs qui sont à la base de la littérature occidentale, le style hébraïque, biblique, que vous qualifiez de « pessimiste », et le style grec, homérique, que vous qualifiez d’ « optimiste ». Alors qu’Auerbach oppose ces deux styles, vous vous demandez « si, au bout du compte, les styles pessimistes et optimistes ne seraient pas plutôt complémentaires qu’opposés, deux aspects du même phénomène complexe, chacun étant indispensable pour décrire ce phénomène, chacun indissociable de l’autre. (…) Dans cette lecture, c’est la manière hébraïque qui rend possible la manière grecque, l’une et l’autre n’étant pas tant des points aux deux extrémités d’une droite que les arcs d’un cercle continu ». Pourquoi est-ce que la manière hébraïque « rend possible » la manière grecque ? Faut-il le comprendre à un niveau seulement stylistique, ou plus largement culturel, historique, voire personnel pour ce qui vous concerne ?
Daniel Mendelsohn : Je faisais allusion à une conséquence de la thèse d’Auerbach. Ce dernier oppose le style narratif d’Homère à savoir la « composition circulaire » où un récit donné – appelons-le le « récit A » – s’interrompt pour incorporer un récit secondaire, le « récit B », qui permet d’expliquer un aspect du récit A. Puis le récit B peut lui-même s’interrompre pour intégrer un nouveau récit, le récit C, qui explique un aspect du récit B, et ainsi de suite. Cette série de « cercles » imbriqués est l’objet du chapitre d’ouverture d’Auerbach dans Mimesis, où il oppose cette composition circulaire – laquelle pourrait, potentiellement, s’étendre à l’infini pour ajouter toujours plus d’informations liées d’une manière ou d’une autre au récit originel, le récit A – au mode de composition biblique qu’illustre par exemple la Genèse. Pour Auerbach, qui s’intéresse aux stratégies narratives qui donnent à la littérature un aspect « réel » (le sous-titre de son livre est : « La représentation de la réalité dans la littérature occidentale »), le récit biblique, contrairement à la composition circulaire d’Homère, ne cherche pas à expliquer et à rendre compte de tous les aspects du récit – il est, à l’inverse, plein d’opacité, d’omissions. Pour lui, ce sont précisément ces lacunes qui rendent le récit plus « réel », parce qu’évidemment dans la vie réelle, on ne connaît pas précisément le détail de tous les éléments d’une histoire, ni même de notre propre histoire. Le point que je voulais souligner, qui découle d’une remarque d’Auerbach sur le style du récit biblique, c’est que ce sont précisément ces blancs, ces lacunes, le manque d’information dans un récit donné, qui engendrent l’interprétation. Le manque d’information, les incohérences, les discontinuités et les omissions stimulent le désir d’interprétation du lecteur. Et donc en ce sens, on peut dire que c’est le style hébraïque qui donne naissance à l’exégèse – au commentaire.

Concernant l’ « optimisme » et le « pessimisme » : ce sont mes propres caractérisations des styles narratifs opposés tels qu’analysés par Auerbach, le style grec et le style hébraïque. Je qualifie d’ « optimiste » la composition circulaire parce qu’on peut présumer qu’en créant toujours plus de cercles narratifs, de récits à l’intérieur d’autres récits, ad infinitum, on pourrait rendre compte de la Création dans sa totalité ; alors que le « style hébraïque », comme Auerbach le notait lui-même, reflète la nature du Divin : il y a des choses qu’on ne pourra jamais ni voir, ni savoir. C’est pour cette raison que je l’ai qualifié de style « pessimiste », parce qu’il suppose d’emblée que certaines choses ne peuvent être racontées. J’ajouterais que peu après la publication de Trois anneaux, j’ai reçu un mail très intéressant d’un lecteur, qui me demandait : « Pourquoi pensez-vous qu’être capable de tout raconter est « optimiste » ?! ». Je n’ai jamais réussi à chasser cette question de mon esprit. J’imagine que mon parti-pris en dit long sur ma propre orientation narrative.
A. Z. : Au-delà des aspects intellectuels, certains ont souligné que la philologie classique a pu être en Europe un enjeu d’intégration pour les Juifs, notamment à partir du XIXe siècle : il s’agissait de participer à la « grande culture » européenne sans renoncer à l’étude, et certains y ont donc vu une forme de substitut à l’étude juive. Est-ce que vous pensez qu’une question de cet ordre est également en jeu pour les philologues juifs américains, notamment à partir de la seconde moitié du XXe siècle, ou la question se pose-t-elle différemment ? Et si elle a bien été un enjeu d’intégration, pensez-vous que cette voie soit encore ouverte, encore pertinente, alors que les études classiques subissent d’importantes remises en cause ?
D.M. : Je ne peux pas l’affirmer avec certitude, car je ne connais pas dans le détail l’histoire de la philologie américaine ; mais je soupçonne que la situation ici en Amérique ait été assez différente, parce que tout le monde se place au départ à une certaine distance de la grande culture européenne [en français dans la conversation]. Il est possible qu’au XIXe siècle, la philologie classique ait été avant tout un moyen, pour n’importe qui en Amérique, de se réclamer du grand héritage culturel européen ; et ce n’est que dans un second temps, dans ce cadre, que la philologie a pu être un moyen pour les savants juifs de s’en réclamer également. Mais pour être franc, je soupçonne une situation culturelle générale assez différente ici, de telle sorte qu’il me semble difficile d’établir ce type de parallèles. Entre autres choses, les intellectuels et les universitaires n’ont pas du tout le même statut en Amérique que celui qu’ils ont pu avoir en Europe et au Royaume-Uni au cours des siècles. En tout cas, je pense qu’aucun Américain, dans la seconde moitié du XXe siècle, n’a considéré la philologie classique comme une manière d’acquérir un quelconque statut. Ce serait même plutôt le contraire. Ici, si vous étudiez l’Antiquité gréco-romaine, on vous regarde comme si vous étiez fou : « Qu’est-ce que vous allez bien pouvoir faire avec ça ? »
A.Z. : J’aimerais vous poser une question qui concerne plutôt le rapport chez vous entre identité juive et identité américaine. Je la poserai en passant par un élément qui m’a beaucoup frappé en vous lisant, qui est l’importance que vous accordez aux noms. Cela commence dès les premières pages de L’Étreinte fugitive : vous parlez des rues à New York et du fait que les Américains, ou les New-Yorkais en tout cas, n’aiment pas les noms de rue et préfèrent les numéros (5e Avenue, 65e Rue Ouest, etc.), parce que c’est plus efficace et plus rapide. On peut penser aussi à un élément sur lequel vous revenez souvent : le nom de votre grand-tante Ray, qui s’appelait auparavant Rachel, et le nom de votre famille maternelle Jäger, qui a perdu son tréma et son J lors de leur immigration aux États-Unis pour devenir Yaegers ou Yagers. Comme si au fond l’immigration aux États-Unis était vécue comme un moment de perte fondamentale d’identité, d’exil, et non comme cela a pu être vécu par certains Juifs européens comme une libération d’une Europe oppressive, avec l’idée enthousiaste d’une symbiose judéo-américaine.
D.M. : L’importance des noms est aussi, bien sûr, très proustienne. En guise d’aparté – parce qu’il s’agit d’un de mes thèmes favoris, à savoir l’espace qui s’ouvre entre les histoires que l’on aime raconter et la vérité des choses – permettez-moi de dire un mot sur cette question de la multiplicité des noms. Ma sœur est une généalogiste assez connue qui est très suivie ici aux États-Unis, notamment parce qu’elle se sert de Twitter pour dévoiler les histoires d’immigration des conseillers anti-immigration de Trump ! Un des principaux sujets qu’elle étudie est ce mythe, très répandu aux États-Unis, selon lequel lors de l’arrivée des immigrants et de leur enregistrement à Ellis Island, leurs noms auraient été modifiés par les agents de l’immigration, parce que les noms européens étaient trop compliqués et difficiles à prononcer ou à comprendre. Or, il s’avère que c’est un mythe complet. En réalité, ça ne s’est jamais produit – aucun nom n’a été changé par un agent de l’immigration. Le système américain envisageait que, après leur arrivée, les gens modifieraient leur propre nom, mais aucun nom n’a été changé par la bureaucratie.

Mais votre question m’a conduit à une intuition nouvelle à propos de L’Étreinte fugitive. Le fait d’être conscient que le nom était différent, qu’il était orthographié ou prononcé différemment, le fait de comprendre que sa prononciation américaine est différente de la manière dont il était prononcé autrefois en Europe, etc. – tout cela est très lié, dans L’Étreinte fugitive, à ce que je reconnais maintenant comme un récit des origines de la philologie. Que signifie ce problème d’orthographe ? Quel est le « vrai » nom ? Que dit l’inscription ? Pourquoi l’inscription sur le caveau familial est-elle différente en anglais et en hébreu ? Je perçois maintenant qu’il s’agit d’une sorte de récit des origines, qui m’importe pour les raisons que j’aborde dans L’Étreinte fugitive : d’une part du fait de son contenu – le drame de ma grand-tante, l’« épouse de la mort » décédée juste avant son mariage, etc. – et d’autre part parce que cette histoire raconte la manière dont j’ai pris goût à la philologie. Il y a un passage de L’Étreinte fugitive où je raconte que lorsque vous allez dans l’espace du cimetière où ma famille est enterrée, le nom de famille est orthographié différemment sur chaque pierre tombale : Jäger, Jager, Yager, Jaeger, etc. Quand j’étais enfant, je les regardais et me demandais pourquoi il y avait toutes ces orthographes différentes. Nous savons qu’il s’agit d’un problème de transcription : ils savaient, bien entendu, quel était leur nom, ils savaient que leur nom était « Jäger », mais si vous orthographiez « Jäger » correctement en allemand, un Américain va mal le prononcer : « Jager », avec un « J » dur. C’est un dilemme philologique. Si ces pierres tombales étaient vieilles de 3000 ans, j’écrirais un article à leur sujet dans le Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik[1].
Donc j’ajouterais que le « mystère » du nom de famille est également lié à ce dont nous avons parlé précédemment, à savoir le récit de recherche. Mes récits sont souvent déclenchés par un mystère ou une énigme qui doivent être résolus. Dans L’Étreinte fugitive, c’est le mystère de la pierre tombale de tante Ray – la différence entre ce que disent l’inscription en hébreu et l’inscription en anglais. Dans Les disparus, c’est l’étrange ressemblance physique entre oncle Shmiel et moi. Pourquoi est-ce que je ressemble à ce parent décédé ? Qui est-il ? Et comment est-il vraiment mort ?
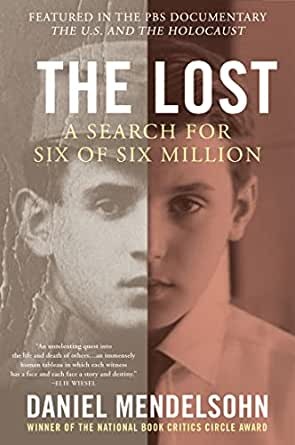
Autre chose : il me semble que la question des noms est une autre différence entre l’Europe et l’Amérique. Dans L’Étreinte fugitive tout comme dans Les disparus, j’évoque le fait que, dans la génération d’immigrants de mon grand-père, chacun avait deux noms : son nom américain, et son nom juif. Je prends l’exemple de la sœur de mon grand-père, tante Ray, celle qui est morte une semaine avant son mariage : elle prit le nom de Ray en arrivant en Amérique, mais son prénom de naissance était Ruchele, qui comme je l’ai indiqué précédemment était aussi le nom de sa nièce, la fille de Shmiel, qui a été tuée à Bolechów. Il y avait aussi la sœur malheureuse de mon grand-père, qui s’appelait Sosia à sa naissance mais que l’on connaissait comme tante Sylvia, parce que tout le monde devait avoir un nom américain, anglophone.
Donc cette idée d’une double identité, une identité européenne qui appartient au passé, puis le nouveau nom, américain, que vous preniez après avoir émigré, cette question de la double identité est saturée de motifs qui m’intéressent : le passé contre le présent, l’identité américaine contre l’identité européenne. L’idée que l’histoire du vrai soi est enterrée dans le passé, que vous devez prendre un nouveau nom pour être dans un nouveau pays, etc. c’est irrésistible. Et pour aller plus loin, je dirais que c’est également lié au côté gay, qui est aussi hanté par les doubles identités : l’idée que vous avez d’un côté un moi secret, et de l’autre un moi public qui est acceptable. Donc je pense que vous avez raison de souligner ce thème des noms, c’est un sujet parfait pour moi, étant donné ce qui me préoccupe à travers toutes mes identités, d’helléniste, de juif et d’homosexuel. Je pense que si on le souhaitait, on pourrait devenir très saussurien, et très derridien : le nom, c’est le signifiant, n’est-ce pas ? Et pour finir, je dirais en outre que tout cela – les rapport entre dénomination, identité et signification – trouve chez moi une résonnance en tant qu’helléniste. Je viens d’achever une nouvelle traduction de l’Odyssée, qui sera publiée l’année prochaine. Or, un terme crucial de l’Odyssée est sèma, un terme qui signifie littéralement le « signe » – d’ailleurs, c’est de là que vient le terme « sémiotique » –, mais qui veut aussi dire « tombe » ; il est même utilisé pour désigner le lit nuptial d’Ulysse et Pénélope, qui est un « signe » du mariage lui-même. Ça correspond parfaitement à ce qui m’intéresse. Dans L’Étreinte fugitive j’ai cette obsession de la tombe et du nom, et j’ajouterai qu’un élément clé du texte d’Une odyssée est le lit que mon père m’a construit quand j’étais enfant, qui, comme le lit qu’Ulysse a construit pour son mariage avec Pénélope, se caractérise par le secret qui entoure la façon dont il a été fabriqué (le lit dans l’Odyssée est fabriqué à partir d’un arbre encore enraciné ; mon père a bâti le mien à partir d’une porte). Donc ce sèma est – pardon pour le jeu de mots – polysémique, il est utilisé de bien des manières chez Homère, de même que dans mes écrits. Il est donc interprétable à l’infini. C’est un point que j’aborde dans Trois anneaux : chaque conclusion, chaque définition, chaque interprétation – et on revient ici à la question du commentaire – ne fait qu’ouvrir de nouvelles questions. Le sèma est toujours allusif. Il n’est jamais définitivement fixé. À chaque fois que vous pensez avoir l’interprétation parfaite, il s’avère qu’il y a de nouvelles choses à interpréter.
Déborah Bucchi : Ce double nom, cette double identité, pourrait faire songer à l’Hélène d’Euripide, où Hélène est partagée entre son apparence réelle et son double, son eidos et son eidôlon en grec, entre son corps réel et le concept de beauté pure qu’elle représente. La figure d’Hélène évoque la double identité qu’incarne plus largement la figure féminine dans la tragédie : les Suppliantes d’Eschyle ont, elles aussi, une double identité. Les filles de Danaos quittent en effet la terre d’Égypte pour Argos et relatent auprès du roi de la cité l’histoire de leur ancêtre Iô afin de justifier leur demande d’asile. Elles représentent ainsi leur arrivée comme un retour à la cité dont elles sont en réalité issues. À l’instar des Suppliantes, votre écriture refabrique un mythe pour dire la complexité des rapports créés par l’émigration, l’exil, la violence.
D.M. : Je commencerais par revenir sur cette idée des Suppliantes d’Eschyle. Il me semble, comme c’est le cas dans tous les drames de suppliants, que la pièce d’Eschyle pose une question essentielle sur l’identité, qui est liée à tout ce dont nous avons parlé, et en particulier à Trois anneaux, qui aborde explicitement la question de l’exil. C’est pourquoi les pièces sur les suppliants sont particulièrement intéressantes aujourd’hui. Les hellénistes, à juste titre – et je m’y inclus, puisque j’ai écrit un livre sur ce sujet[2] – se sont généralement concentrés sur les aspects politiques de ces tragédies grecques sur la supplication, dans lesquelles un groupe de personnes, en général des réfugiés, arrive sur une terre étrangère et demande expressément au roi de les protéger. Mais ce n’est pas une crise seulement pour les suppliants – « je suis impuissant et j’ai besoin d’aide » – mais aussi pour la personne qui est suppliée, car ces pièces sont construites de telle sorte que prendre la décision d’aider les suppliants, c’est prendre un risque politique chez soi – risquer une guerre avec celui qui persécute les suppliants et provoquer la colère de ses propres citoyens, qui ne veulent pas être impliqués. Aux États-Unis, il est devenu très populaire de monter ces pièces de suppliants, du fait de leur résonance politique évidente avec la crise actuelle des réfugiés.

Mais en ce qui me concerne, comme je m’intéresse aux questions d’identité, les tragédies posent une autre question iimportante, qui concerne l’inversion du statut et l’inversion de l’identité. La posture du suppliant, la posture de l’exil, peut être considérée comme une inversion complète de l’identité : vous qui étiez la famille royale en Égypte, n’êtes maintenant plus rien en Grèce : impuissants, sans défense ; vous qui étiez Erich Auerbach, le professeur distingué de philologie romane en Allemagne, êtes désormais un mendiant à Constantinople ; vous qui étiez si puissant et si important dans votre pays n’êtes plus rien dans celui-ci. Cette inversion a pour moi une résonance historique et biographique irrésistible, parce que c’est aussi le dilemme de l’immigrant. Elle est donc en lien avec mes écrits, et particulièrement avec L’Étreinte fugitive, ses récits à propos de ma famille immigrée et ses réflexions sur l’identité gay et le mouvement de gentrification des homosexuels au sein de quartiers exclusivement gays, que nous appelons d’ailleurs des « ghettos gays ».
Ce qui nous amène à une autre de mes grandes préoccupations : le récit. Car il n’y a que le récit qui puisse recréer l’identité perdue d’une famille d’immigrants. C’est pour cela que mon grand-père passait son temps à raconter des histoires sur le « vieux pays », car là-bas, vous étiez quelqu’un. Tout le monde savait qui vous étiez, vous aviez un statut, et même de l’argent, vous apparteniez à un certain contexte, social et politique ; et maintenant vous n’êtes plus que l’une des vingt-deux millions de personnes arrivées aux États-Unis, et il faut repartir de zéro ; c’est une histoire avec laquelle j’ai grandi. C’est intéressant pour moi parce que la crise d’identité des immigrants devient la source de la narration. L’identité d’origine a été perdue, et la seule manière de la recréer est de la réinventer sans cesse à travers la narration. Qui sommes-nous ? Nous ne sommes pas ces immigrés désespérés qui vivent à douze dans une chambre du Lower East Side de Manhattan. Non, nous étions la famille la plus respectée de Bolechów ! Ainsi la narration – et là on touche à ce que vous disiez à propos de Susan Sontag et du camp [voir à ce propos la première partie de l’entretien] – devient en effet une forme de résistance à la réalité des circonstances historiques. C’est ce que j’ai appris enfant, en écoutant mon grand-père.
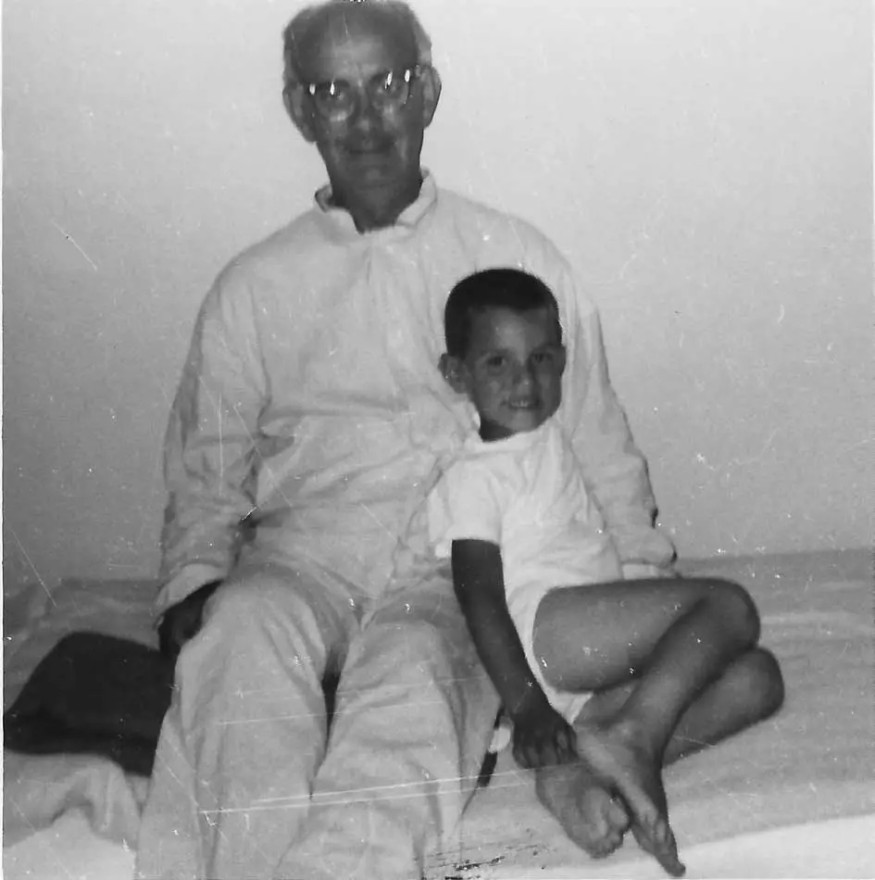
Cela me permet de mieux préciser un point que j’essayais de formuler plus tôt : la tension dans mes écrits est générée par la conscience que la réinvention du récit originel de l’identité est certes agréable, mais que la raison pour laquelle il est nécessaire, en premier lieu, de le réinventer, est liée aux souffrances ou aux horreurs du passé. Vous ne racontez ces histoires que parce que quelque chose d’épouvantable s’est produit, et que vous avez tout perdu. C’est en lien avec cette fascination pour la culture européenne, qui coexiste avec la conscience de l’Europe comme le lieu de l’anéantissement. Ce que vous soulignez, cette réinvention constante des modèles européens dans mes écrits, malgré la conscience que l’Europe est à la fois le problème et la solution, c’est cela, je crois, qui génère une grande tension dans mon travail. Je ne cesse de mettre en avant ces modèles : Bereishit, L’Odyssée, Euripide, Racine, Proust, etc. Mais je sais en même temps que ces modèles n’ont pas fonctionné pour ma famille, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui génère un malaise. J’ai l’impression de chercher sans cesse à réconcilier les deux faces de ce dilemme.
Ce malaise à propos de l’héritage culturel européen, cette perception que la « grandeur » est toujours teintée d’horreur, s’est manifesté récemment avec force chez les spécialistes de l’Antiquité, qui doivent lutter avec le fait qu’une grande partie de la civilisation antique est au fondement de la culture européenne, tout en étant marquée par des comportements et des institutions que nous trouvons aujourd’hui abominables – l’économie servile, la misogynie, le patriarcat, etc. J’étais heureux de lire récemment dans un forum de discussion quelqu’un qui disait : « Ce qu’il y a de bien avec Mendelsohn, c’est qu’il parle toujours des Anciens comme de modèles, tout en sachant combien leur culture était problématique ». Comment une société qui présente tant d’aspects répugnants, que l’on ne tolérerait jamais aujourd’hui, a-t-elle pu créer ces extraordinaires et si profonds instruments pour comprendre la vie humaine ? Et comment pouvons-nous accepter la validité de ces instruments et de ces réalisations sans accepter la validité d’autres éléments de cette culture ? C’est une question passionnante, que je cherche à approcher sous différents angles dans tout ce que j’écris. Vous avez évoqué cette sorte de « côté islamique » dans Trois anneaux. Je pense qu’il y a une plaisanterie secrète dans ce livre, qui est que la personne qui permet de tout résoudre est un musulman, Yousuf Kamil Pasha, le Turc ottoman du XIXe siècle qui a traduit Les aventures de Télémaque de Fénelon. C’est lui qui réunit tout, c’est le vrai traducteur de mon texte, de toutes les manières possibles, car c’est lui qui dans le passé relie Homère et Fénelon à Istanbul, et donc à Auerbach dans le présent. Et c’est lui qui, finalement, réconcilie cette série continue de tensions, de collisions et de migrations entre Orient et Occident qui traversent mon livre – les Juifs espagnols qui fuient à Istanbul, les Byzantins qui fuient Istanbul, et ainsi de suite. Il y a donc en réalité quatre anneaux dans mon livre : Auerbach, Fénelon, Sebald, et Kamil Pasha. Et c’est le non-européen, le musulman, qui relie tous les points à la fin. Il y a toujours, je crois, un aspect inattendu dont il faut tenir compte.
Déborah Bucchi et Adrien Zirah
Déborah Bucchi est agrégée de lettres classiques, doctorante au sein des centres de recherches ANHIMA et LIPO. Son travail porte sur les expériences antiques et contemporaines du divin au théâtre.
Adrien Zirah est agrégé de lettres classiques et doctorant en histoire ancienne à l’EHESS. Ses travaux portent sur les premières réflexions linguistiques dans l’Athènes classique.
>>> Episode 3 de l’entretien avec Daniel Mendelsohn : « Les États-Unis, l’Europe et les Juifs »










