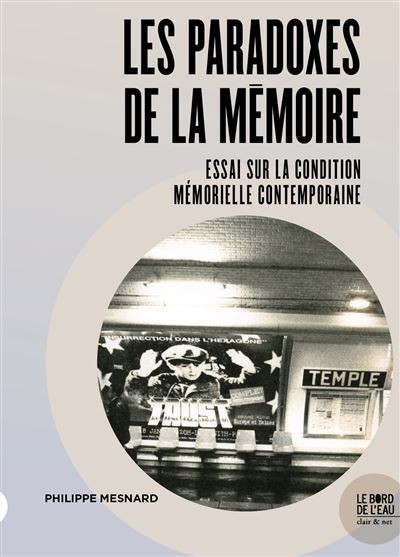La prestigieuse Pléiade a récemment fait paraître un volume : « L’Espèce humaine » et autres écrits des camps[1]. Philippe Mesnard interroge la nature du regroupement proposé, où Robert Antelme voisine avec Piotr Rawicz et Charlotte Delbo avec Elie Wiesel. Ce faisant, il insiste sur la façon dont la somme proposée — notamment parce qu’elle installe une utilisation générique et englobante des « camps » — ne parvient pas à mettre clairement en évidence la différence entre le système concentrationnaire et la politique d’extermination des Juifs.

On ne pouvait que se réjouir en apprenant la nouvelle de cette édition de témoignages concentrationnaires dans La Pléiade, pilier du champ éditorial français – une tradition en soi – qui offre des œuvres de référence accompagnées de commentaires savants dont font usage, avec les amateurs de littérature, les enseignants du secondaire comme du supérieur. Une telle publication engage ainsi une responsabilité au-delà du champ littéraire. En outre, qu’il s’agisse d’un volume rassemblant une sélection de textes d’auteurs différents – peu fréquent dans cette collection –, invite à s’interroger sur ce qui en a guidé le choix. Or, précisément, L’Espèce humaine et autres écrits des camps intrigue. D’emblée, il y a ce titre qui renvoie à L’Espèce humaine (1947) de Robert Antelme, et ces autres écrits regroupant L’Univers concentrationnaire (1946) de David Rousset, La Peinture à Dora (1946) de François Le Lionnais, Nuit et brouillard et De la mort à la vie (1955) de Jean Cayrol, La Nuit (1958) d’Elie Wiesel, Le Sang du ciel (1961) de Piotr Rawicz, la trilogie Auschwitz et après (1970-1971) de Charlotte Delbo et L’Écriture ou la vie (1994) de Jorge Semprun. Ainsi, la mise en avant du récit d’Antelme, d’un côté, cette sélection de textes parmi une littérature que l’on sait maintenant foisonnante, de l’autre, amènent à se demander comment sont présentées ces différentes parties, quel est leur cadre critique et si l’ensemble est cohérent. Les préface et introduction, respectivement, de Henri Scepi, spécialiste de la poésie du roman français des XIXe et XXe siècles, et de Dominique Moncond’huy, dix-septiémiste et responsable de la revue La Licorne qui a consacré son n° 51 à la littérature concentrationnaire, apportent-elles des réponses ou des pistes ?

Un titre, deux choix
Le titre, à n’en pas douter fait pour attirer l’attention, joue sur deux niveaux : l’espèce humaine en tant que telle – remise en question par la terreur nazie et toute terreur politique –, et il renvoie au titre éponyme d’Antelme, rescapé de Buchenwald. Le fait que soit indiqué, à la suite, qu’il y ait d’« autres écrits » met évidemment en avant le texte phare de Gallimard qui l’a republié en 1957 (à l’origine, Cayrol est au Seuil, Rousset aux éditions du Pavois puis chez Minuit comme Delbo et Wiesel, Minuit récemment racheté par Gallimard, éditeur de Rawicz et Semprun). Ces paramètres de politiques éditoriales ne sont pas anodins car tout laisse à penser que l’on a là le placement des produits de la Grande Maison ; Antelme y a d’ailleurs été l’objet d’un hommage sans équivalent en 1996. Il est vrai que, si l’on se dégage de son schéma d’interprétation hégéliano-marxiste quelque peu daté, L’Espèce humaine est une œuvre unique – Antelme a peu écrit à côté, et des textes courts – dont la valeur littéraire ne fait pas de doute, certes, mais pas moins que celle des œuvres de Cayrol, Delbo, Rawicz, Rousset, Semprun ou Wiesel présentes dans le volume. Alors, pourquoi les reléguer au rang de ces « autres écrits des camps » ? Pourquoi n’avoir pas, tout simplement, choisi pour titre : Écrits des camps nazis ? N’est-ce pas là leur faire injure et déclencher un débat qui n’a aucune raison d’avoir lieu ? On peut aussi s’étonner de l’absence de Germaine Tillon ou de Micheline Maurel, cette dernière étant seulement mentionnée par le détour de la préface de Mauriac à son récit.

Le deuxième choix, évoqué plus explicitement, est celui de la langue française. Le justifier semble simple. Ces auteurs, lit-on, ont « témoigné de l’expérience qui a été la leur […] dans une langue – le français – qu’ils ont reçue en héritage ou dont ils ont fait le choix » (page d’annonce du volume). L’argument est repris avec quelques variantes dans la préface et l’introduction. Là encore, on est surpris du raisonnement. Ce volume, avance Moncond’huy, « propose un parcours à travers la mémoire écrite des camps telle qu’elle s’est constituée en France, au fil des ans ; il permet donc aussi de percevoir comment l’analyse du phénomène concentrationnaire nazi et les réflexions qu’il a pu induire ont évolué – et ce, dans une perspective française et francophone, tant il est vrai que la réception de cette parole des rescapés s’est avérée liée au contexte spécifique [je souligne], notamment de chaque pays au lendemain de la guerre et dans les décennies qui suivirent. »
Ce faisant, une partie du texte de Moncond’huy développe une interprétation périodisante de la construction de la mémoire concentrationnaire désormais passée dans la vulgate où le procès Eichmann figure comme pivot de la prise de conscience du génocide des Juifs. On pourrait alors s’étonner qu’aucun des rescapés écrivains ici publiés – à l’exception peut-être de Wiesel – n’ait enregistré et signalé dans son œuvre ce moment dit charnière du début des années 1960. Si, par exemple, Delbo revient au témoignage de sa déportation, c’est en transitant par la guerre d’Algérie à laquelle elle consacre l’ouvrage décisif des Belles lettres (Minuit, 1961), après quoi elle publie Le Convoi du 24 janvier (1965), sur ses compagnes de déportation, et la trilogie Auschwitz et après.

Quant à la spécificité française et francophone déterminant le choix du corpus, l’argument étonne. Certes, chaque nation a son histoire et la langue qui lui est propre en est imprégnée. Toutefois, le manque de visibilité au sujet des déportés dits « raciaux » (les Juifs et les Tsiganes) et non politiques jusque dans les années 1970, puis la prise en compte croissante du génocide des Juifs s’inscrivent dans une évolution générale de la représentation des violences politiques et historiques qui a touché l’Europe tout entière. En cela, le facteur « français » n’est pas déterminant et il serait même révoqué par les auteurs publiés, malgré leur attachement à la France. D’autant que, aussi bien sur le marché du livre que sur le plan pédagogique, c’est de loin la traduction de Se Questo è un uomo (Si c’est un homme) qui reste l’œuvre phare jusqu’à avoir figuré dans les programmes de français des classes de Première il y a quelques années, bien devant les œuvres de cette pléiade.
Quel camp ?
Cela nous conduit en effet à un autre problème d’envergure soulevé par ses deux introductions. De quel « camp » parle-t-on ? Rien ne le dit a priori : et pourquoi pas le Goulag ? L’espèce humaine y était-elle mieux traitée derrière le discours stalinien de « rééducation » ? Même si cela ne concerne que le nazisme, subsiste un problème que les auteurs cherchent à résoudre, sans pouvoir s’en acquitter, entre système concentrationnaire et centres de mise à mort participant à la spécificité de la Shoah.
Car les mentions de l’« extermination » ou, par Moncond’huy, du « génocide des Juifs » ne suffisent pas à lever le malaise que crée, à chaque page et plusieurs fois par page, l’utilisation générique et particulièrement englobante des « camps ». Elle ne permet pas de faire comprendre que, à côté du système concentrationnaire à proprement parler, a fonctionné une politique criminelle spécifique visant à rayer les Juifs de la surface de la terre. Car ce n’est pas en entrant dans le camp ni même en montant dans le wagon que ces derniers étaient exclus de l’espèce humaine : ils l’avaient été depuis longtemps. Et cette exclusion radicale est un des paramètres qui a permis leur assassinat et la tentative aussi radicale de détruire leur culture. À quoi auront servi quelques décennies à essayer, sans minorer la violence concentrationnaire, de faire reconnaître et admettre la singularité du crime génocidaire contre les Juifs ? Que signifient les noms Bełżec, Chełmno, Treblinka, Sobibór, Majdanek, Birkenau… ? Ce sont des « centres de mise à mort » et certainement pas des « camps ». N’y a-t-il pas là une irresponsabilité pédagogique en ne soulignant pas nettement la distinction entre les deux types de structure, accompagnée d’une sorte de régression historiographique dont le dessein généraliste échappe, alors que tant de travaux ont mis en évidence la différence entre système concentrationnaire et politique d’extermination des Juifs ?

Mentionnant Elie Wiesel, il est fait référence à l’« arrivée à Auschwitz » qui était une « épreuve » (Scepi, p. XIX). L’expression confirme l’amalgame mentionné ci-dessus, exemplaire de l’ensemble de ce volume de La Pléiade. Bien que la brutalité de la descente du convoi pour être immergé dans l’univers concentrationnaire avec son rituel d’humiliations provoquât chez le déporté une indéniable rupture cognitive qui pouvait lui être fatale, ici, avec La Nuit, c’est de la sélection qu’il s’agit, non d’une « épreuve ». Peut-être faut-il alors rappeler que la sélection, réservée aux convois de Juifs, consistait à ne garder que ceux qui étaient suffisamment jeunes et valides pour travailler leur laissant quelques semaines ou mois de survie. Les autres, en moyenne 90 %, allaient à la chambre à gaz. À quoi s’ajoutent des erreurs, dont voici trois particulièrement grossières. On lit que Piotr Rawicz « choisit de donner forme de transposition romanesque à sa propre expérience de la déportation » (Scepi, XXVIII). Or Rawicz ne transcrit pas l’expérience de la déportation mais celle du ghetto et de la chasse généralisée aux Juifs en Europe de
l’est et, plus précisément, en Ukraine et en Pologne : à ce titre, Le Sang du ciel qui figure dans le recueil n’est pas un « écrit des camps ».
Il est par ailleurs nécessaire de signaler que, contrairement à ce qu’avance Montcond’huy, Primo Levi n’approfondit pas du tout ce qu’il nomme la « zone grise » à l’occasion d’un « dialogue à distance [sic] avec Jean Améry » (Montcond’huy, XLVI). Il n’y eut entre Levi et Améry qu’un dialogue imaginaire dans les années 1970 [3], mais surtout l’élaboration de la zone grise[4] date de bien avant. Dès la première version de Si c’est un homme, Levi a travaillé la question des formes de collaboration contraintes ou consenties et des questions morales qui les sous-tendaient. Dans les années 1960, sa réflexion a mûri grâce aux échanges qu’il a eus directement avec Herman Langbein. Puis, après la lecture révélatrice de La Nuit des Girondins de Jacques Presser, il s’est focalisé sur les problèmes que posent les dirigeants des ghettos et les Sonderkommandos, ce qu’il qualifie alors de « zone grise ».
Enfin, en réponse à la question : ‘qui témoigne ?’, il est regrettable de lire que « ce n’est jamais le déporté, celui qui était enfermé, qui subissait, “là-bas” » (XXXVIII). Car cela met gravement de côté les auteurs clandestins qui ont enterré, peu avant de périr, leurs manuscrits dont certains recèlent d’incontestables qualités littéraires, tels, entre autres, ceux de Zalmen Gradowski, Sonderkommando à Auschwitz-Birkenau, et de Katzenelson au camp de Vittel (en France). Là encore, ce fait juif n’a aucune existence dans l’argumentation sur laquelle repose l’édifice de cette Pléiade.
J’ai tracé un portrait bien négatif de ces deux introductions. Il est vrai qu’un tel sujet ne souffre pas les imprécisions. Relève-t-il plus de l’histoire que de la littérature ? Là est la difficulté des domaines testimoniaux et mémoriels : aucune discipline ne sait les cerner, tout en étant toutes requises pour les comprendre. On doute alors des compétences des responsables de cette édition savante à la diriger alors qu’il y aurait bien, en France, une dizaine d’universitaires et d’intellectuels qualifiés à cette tâche. Quant aux partis pris strictement littéraires – champ dont les deux auteurs critiques sont spécialistes –, ils permettent ici, enfin dirait-on, de poser des questions exigeantes. Mais qui soulignent plus encore par contraste les points défaillants sur lesquels je me suis attardé.

Bien que largement entendues, les questions liées aux nouvelles formes expérimentées en littérature ou à la façon dont les auteurs puisent dans la culture littéraire pour témoigner de leur expérience limite comptent parmi les aspects à porter au bénéfice de ces propos introductifs. Si l’on ne se demandera pas pourquoi dans un tel contexte Henri Scepi mentionne de si nombreuses fois Malraux tant l’œuvre et la pensée de ce dernier sont éloignées du sujet, en revanche, c’est avec intérêt que l’on découvre Dominique Montcond’huy, dont la fréquentation du corpus ne fait pas de doute, prendre position dans un débat qui a, il y a quelque temps, animé le landerneau des études testimoniales. Il se range ainsi du côté de ceux pour qui le témoignage n’est pas un genre : « Le flou même du statut de ces ouvrages les dessert d’une certaine manière : aucune catégorie générique claire ne les identifie, du moins d’un point de vue strictement littéraire » (XXXVIII). De même, plus loin, estime-t-il à bon escient que qualifier ces textes de documents « ne doit pas occulter leur dimension littéraire […] ni les rendre prisonniers d’une classification réductrice, étrangère aux intentions des auteurs. » C’est bien pourquoi d’avoir si légèrement usé de la catégorie généraliste et obsolète de « camp » apparaît totalement inapproprié dans une Pléiade qui aurait dû répondre aux nécessités et aux manques d’un temps qui, aujourd’hui, se complaît dans les amalgames.
Philippe Mesnard
Professeur de littérature comparée à l’Université Clermont Auvergne et membre de l’Institut Universitaire de France. Directeur de publication de la revue Mémoires en jeu. Il est notamment l’auteur de ‘Témoignage en résistance’, Paris, Seuil, 2007, de ‘Primo Levi. Le Passage du témoin’, Paris, Fayard, 2011 et de ‘Sonderkommando et Arbeitsjuden. Les travailleurs forcés de la mort’, Paris, Kimé, 2015
Notes
| 1 | »L’Espèce humaine » et autres écrits des camps. Édition publiée sous la direction de Dominique Moncond’huy avec la collaboration de Michèle Rosellini et Henri Scepi. Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Octobre 2021. Autour de L’Espèce humaine (1947) de Robert Antelme, le volume réunit L’Univers concentrationnaire (1946) de David Rousset, La Peinture à Dora (1946) de François Le Lionnais, Nuit et brouillard et De la mort à la vie (1955) de Jean Cayrol, La Nuit (1958) d’Elie Wiesel, Le Sang du ciel (1961) de Piotr Rawicz, la trilogie Auschwitz et après (1970-1971) de Charlotte Delbo et L’Écriture ou la vie (1994) de Jorge Semprun. |
| 2 | Inachevé et resté longtemps inédit, il est intitulé sous sa forme initiale German Concentration camp Factual Survey. La version qui parait sous le titre Memory of the Camps date de 1984 |
| 3 | Voir à ce propos la biographie de Jean Améry par Irène Heidelberger-Leonard (Actes Sud, 2008) |
| 4 | Cette bande aux contours mal définis qui, comme la décrit Primo Levi « sépare et relie à la fois les deux camps des maîtres et des esclaves » et dont la classe hybride des prisonniers fonctionnaires est « l’ossature et l’élément le plus inquiétant » |