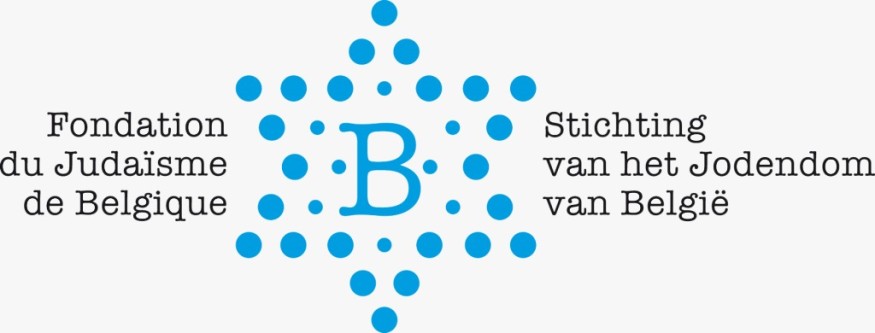Près de 2500 personnalités publiques, pour la plupart israéliennes et américaines (dont un très grand nombre d’universitaires), ont signé une lettre ouverte, The Elephant in the room, appelant à s’élever contre le « but ultime » de la réforme judiciaire portée par le gouvernement israélien actuel : le maintien du « régime d’apartheid ». Cette dernière qualification est contestable – et contestée même par certains des signataires de la pétition. Pourquoi néanmoins l’avoir signée ? Réponse de Sarah et Guy Stroumsa.
>>> A propos de la lettre ouverte The Elephant in the room, lire : « Apartheid : un éléphant peint en rouge ».
*
Honte patriotique
Nous remercions la rédaction de K. pour son invitation à élucider les raisons de notre signature de la récente pétition internationale « The Elephant in the Room » (plus de deux milles signatures jusqu’à présent), qui insiste sur la nécessité pour la lutte populaire impressionnante contre la prétendue réforme judiciaire et pour la démocratie en Israël de ne pas éluder l’injustice multiforme envers les Palestiniens.
« Démocratie et occupation ne peuvent coexister ! », « Égalité pour tous, du Jourdain à la mer [méditerranée] ! ». Dans les manifestations hebdomadaires du samedi soir, par exemple à Jérusalem, on voit bien certains manifestants brandir de telles pancartes (trilingues : en hébreu, arabe et anglais), mais ils restent minoritaires. Dans leur grande majorité, les organisateurs préfèrent ne pas aborder le problème de l’occupation, probablement afin de permettre à un éventail de positions politiques aussi large que possible de participer sans se sentir manipulés par « la gauche ».
Sans contester le bien-fondé tactique d’une telle attitude, il nous semble absurde d’espérer sortir le pays de l’ornière profonde dans laquelle les plans et les actions du gouvernement l’ont embourbé sans même mentionner la question de l’occupation, vieille de plus de cinq décennies. Nous savons depuis fort longtemps, et affirmons constamment, que l’occupation militaire d’un peuple ne peut que pourrir la santé d’une démocratie, même imparfaite – comme le sont, toujours, toutes les démocraties. La pétition en question insiste sur la violence journalière ainsi que sur ses éruptions dans les territoires occupés. Cette violence est multiforme tout autant que systémique. Elle est le fait à la fois des colons, usurpateurs de terres, et dont certains sont racistes, brutaux, et parfois pogromistes, et celle de l’armée. Cette dernière, dont le droit international exige qu’elle protège les populations civiles, ignore trop souvent la violence des colons, qui s’affiche fièrement ad maiorem Dei gloriam. Elle se comporte par ailleurs de façon abominable, obstruant des puits, détruisant des écoles improvisées construites avec l’aide de la communauté internationale, expulsant de leurs terres, sous des prétextes fallacieux, certaines des plus pauvres communautés de bédouins. Les soldats tirent vite, à balles réelles, faisant chaque semaine des victimes innocentes – souvent des mineurs. Trop souvent, c’est l’écœurement au quotidien que nous révèlent la presse et les médias israéliens, même s’ils restent souvent bien frileux.
La pétition parle d’apartheid (séparation, en afrikaans), un terme faisant référence directe au système légal en vigueur en Afrique du Sud de 1948 à 1991. Ce système exigeait la séparation des « races », à tous les niveaux. Blancs, Indiens, « coloured people » et noirs ne pouvaient contracter mariage, monter dans les mêmes autobus, utiliser les mêmes hôpitaux, se baigner sur les mêmes plages. Parler d’apartheid, bien sûr, implique couvrir d’opprobre. Depuis quelque temps, le terme est utilisé plus fréquemment, en Israël, pour parler du système complexe, fluide et parfois confus en place en Cisjordanie occupée. Le 6 septembre, dans une interview à la télévision israélienne, Tamir Pardo, ancien chef du Mossad, parle explicitement d’apartheid pour décrire la situation en Cisjordanie. Ce système, certes, ne ressemble guère au système légal de l’Afrique du Sud. Avant tout, il n’est aucunement fondé sur une théorie raciale. Pour ceux qui l’utilisent aujourd’hui en Israël, il fait surtout référence à la légitimation de l’inégalité et de l’injustice entre colons juifs et Palestiniens : vivant en contiguïté, sur le même territoire, ils dépendent de deux systèmes politiques, sociaux, et juridiques. Les premiers seuls sont citoyens : ils ont le droit de vote, ils bénéficient de la sécurité sociale israélienne, dépendent du réseau scolaire national et des tribunaux civils. Les seconds sont sous la juridiction des autorités (et des tribunaux) militaires.
Signer une pétition, comme manifester, c’est avant tout une expression symbolique. « Quand dire, c’est faire » [How to do Things with Words], selon l’intitulé du livre classique du philosophe John Austin, n’est pas toujours le cas. Signer, manifester, c’est souvent ne pas faire, permettant la libération à bon compte d’une mauvaise conscience. C’est parfois « pour sauver l’honneur » qu’on signe, qu’on manifeste. Quand on ne voit pas bien ce qu’on pourrait faire de vraiment utile, cela permet au moins d’affronter la honte. Avec « Démocratie ! », « Honte ! » est le slogan le plus commun des manifestations constantes à travers le pays, depuis plus de six mois. « Honte ! », c’est bien sur ce qui caractérise nos sentiments envers les actions du gouvernement. Cette honte, que nos ministres sont incapables de ressentir, c’est nous qu’elle éclabousse. A côté de la fierté patriotique existe ce que nous proposons d’appeler la honte patriotique. Nous faisons nôtre l’affirmation de Carlo Ginzburg, lui aussi signataire de cette pétition : « mon pays, c’est celui dont j’ai honte. »
En Israël, ce n’est pas les races que l’on s’emploie à distinguer, à garder séparées. L’affaire est à la fois plus complexe et plus insidieuse. Si Israël, qui se veut être un État à la fois juif et démocratique, peine à relier ces deux épithètes, c’est que la définition même de ce que c’est qu’un « État juif » n’est pas claire dans l’esprit des Israéliens – ou plutôt, elle ne signifie pas pour tous la même chose. Pour beaucoup des citoyens qui s’identifient comme orthodoxes (c’est-à-dire, en fait, orthopraxes), le seul sens possible de l’idée d’un état juif, ce n’est pas un État dont les citoyens, dans leur majorité, sont juifs, mais un État fidèle à la halakha, aux règles de la Torah, telles que la tradition rabbinique les interprète. Mutatis mutandis, il s’agit d’un parallèle à l’idée d’un État islamique, obéissant aux lois de la shari’a. Entre autres, les partis religieux demandent, de façon de plus en plus insistante, la séparation entre hommes et femmes dans l’espace public, dans les autobus, dans les spectacles. Ils réussissent parfois à interdire aux femmes de chanter en public. Par ailleurs, les élèves des écoles talmudiques (les yeshivot) sont libérés d’office (tout comme les Arabes) de leurs obligations militaires ; de plus, ils reçoivent des subventions déniées aux étudiants des universités. On voit donc comment l’idée de fragmentation de la société, de la séparation entre différentes strates de la population, va bien plus loin que les barrières érigées entre Juifs et Palestiniens.
Historiquement, le sionisme visait à la « normalisation » de la société juive, en rendant le peuple juif, dans son État national, semblable aux nations du monde. Une autre forme de sionisme, cependant, rêvant d’un retour chimérique à l’historia sacra biblique, entreprend de bâtir une société hébraïque mythique, repliée sur elle-même autour du Temple reconstruit. Dans la perspective d’un tel sionisme, l’État juif ne peut en aucun cas être une véritable démocratie, une société dont tous les citoyens, sans distinction d’identité ethnique, religieuse ou sexuelle sont égaux en droits et en devoirs. La Déclaration d’Indépendance affirmait sans ambages le caractère démocratique d’Israël, même si dans les faits, l’égalité entre Juifs et Arabes restait trop souvent illusoire – par exemple dans les budgets gouvernementaux. Or, depuis le vote, en 2018, de la « Loi fondamentale » définissant Israël comme « État juif », les voix affirmant que l’identité juive de l’État prime sur son caractère démocratique se font de plus en plus stridentes. Cette transformation a atteint son paroxysme avec la coalition gouvernementale actuelle, composée, avec le Likoud, de partis religieux affirmant tous la primauté juive d’Israël, et affichant leur rejet d’une égalité des droits pour tous les citoyens.
Ces inégalités planifiées entre Juifs et Arabes sont responsables pour une bonne part de la tragédie qui s’est engouffrée aujourd’hui dans toute la société arabe israélienne, soumise à la brutalité meurtrière des mafias qui la dominent, l’exploitent, et la martyrisent, et que la police n’a jamais réussi à maitriser, sans doute parce qu’elle n’a jamais reçu les moyens nécessaires pour s’acquitter d’une tâche d’une telle ampleur. Le 26 août à Jérusalem, des milliers de manifestants écoutent en silence, devant la résidence présidentielle, la longue liste des 157 victimes de meurtre depuis début janvier dans la communauté arabe, pour la plupart assassinés par les mafias – mais aussi victimes de féminicide. Ensuite, une chanteuse arabe appréciée, Mira Awad, prend la parole, avant qu’un clip vidéo décline, en arabe, en hébreu et en anglais, un poème émouvant de Mahmoud Darwish.
Jusqu’à présent, les citoyens arabes d’Israël (ou Palestiniens de nationalité israélienne), tout comme les problèmes liés aux Palestiniens, ont été peu présents dans le mouvement populaire d’indignation et de révolte. Un tel état des choses est-il en train de changer ? Peut-on percevoir le début d’une prise de conscience de l’interface entre les différents aspects de ce qu’on peut appeler l’apartheid à l’israélienne, cette fragmentation multiforme de la société ? Quoi qu’il en soit, si on veut espérer changer les choses, plutôt qu’avoir peur des mots, c’est des réalités qu’il faut avoir honte.
Sarah Stroumsa
Guy G. Stroumsa
Guy G. Stroumsa est professeur émérite de religion comparée à l’Université hébraïque de Jérusalem (chaire Martin Buber) et professeur émérite de l’étude des religions abrahamique à l’Université d’Oxford. Membre de l’Académie des sciences et des humanités d’Israël et titulaire d’un doctorat honorifique de l’Université de Zurich, il a reçu le prix Humboldt de la recherche, le prix Léopold-Lucas et le prix Rothschild. Il est Chevalier de l’Ordre du Mérite. Parmi ses nombreux livres : ‘The Idea of Semitic Monotheism: The Rise and Fall of a Scholarly Myth’ (Oxford, 2021) [L’idée du monothéisme sémitique]; ‘Religions d’Abraham. Histoires croisées, Genève’, Labor et Fides, 2017 ; ‘La Fin du sacrifice: Les mutations religieuses de l’Antiquité tardive’, Odile Jacob, 2005.
Sarah Stroumsa est professeur émérite à l’Université Hébraïque de Jérusalem, où elle a enseigné dans les départements de langue et littérature arabe et de philosophie juive. Elle a été Recteur de l’université. Elle est membre de l’Académie des Sciences et des Lettres d’Israël, de l’Académie de Berlin-Brandenburg, de l’Academia Europea, de l’American Philosophical Society, et membre associée de l’Académie du Royaume du Maroc. Elle a reçu le prix Humboldt et le prix Leopold Lucas. Elle est Présidente de la Society for Judeo Arabic Studies. Parmi ses publications, ‘Maimonides in his World: Portrait of a Mediterranean Thinker’ (Princeton 2010); ‘Andalus and Sefarad: On Philosophy and its History in Islamic Spain’ (Princeton 2019); et ‘Théologie et philosophie au temps des Almohades (XIIe siècle de l’Ère commune)’ (Rabat 2023).