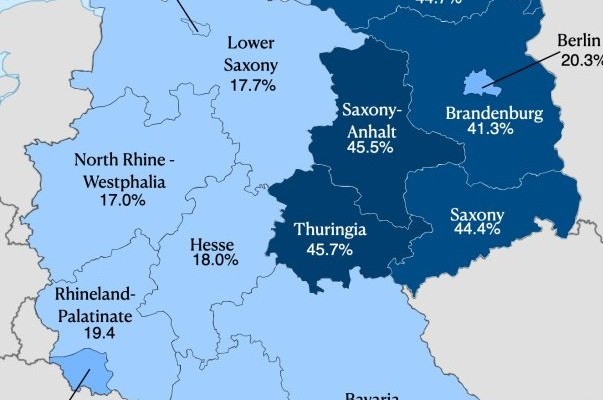« Vengez-nous ». A la supplique qui sourdait des Juifs assassinés et figurait partout après-guerre – sur les murs des synagogues en ruine ou sur des petits morceaux de papier laissés par ceux qui en firent leur dernière volonté avant de périr – Abba Kovner, poète et combattant voulut répondre. Il chercha à prolonger la lutte partisane contre l’État nazi par une action de vengeance de grande ampleur. Il fomenta des plans qui échouèrent ou ne furent pas mis à exécution. Le legs d’Abba Kovner est celui d’une impasse, selon Danny Trom : l’impasse d’une vengeance pensée comme nécessaire et irréalisable.

Et finalement
Nous avons tous été vaincu
Le mort. Et le vivant
Abba Kovner[1]
« Et la vengeance alors ? N’y avez-vous jamais songé ? » demande un lycéen confronté au récit de la Shoah, nous rapporte Marianne Rubinstein, l’auteure de Tout le monde n’a pas la chance d’être orphelin (Verticales, 2002) et de C’est maintenant du passé (Verticales, 2009). « J’ai eu du mal à répondre. » confesse-t-elle.
En effet, la question de savoir pourquoi il n’y eut pas de vengeance des juifs persiste. Et elle nous met dans l’embarras, et pourtant elle ressurgit sans cesse. Pourquoi ?
*
Hannah Arendt n’a pas toujours vu juste, mais sur un point elle a été clairvoyante. Alors que la seconde guerre mondiale faisait rage, elle en appela publiquement, fin 1941, dans la revue Aubau, à la création d’une armée juive[2]. Non pas qu’elle fut la seule à plaider en ce sens. L’idée d’une brigade juive était dans l’air, et une unité de volontaires, la Jewish Brigade Group of the British Army, forte de 5000 combattants essentiellement issus du yichouv, fut intégrée dans l’armée britannique. A sa modeste échelle, cette unité participa à la libération de l’Europe. Mais tel n’était pas ce que visait avant tout Arendt dans son appel. Elle visait la création d’une armée juive, avec un commandement juif et un drapeau juif, car à cette seule condition, insistait-elle, les juifs allaient figurer après-guerre du côté des vainqueurs. L’armée juive combattante était donc pour elle une manière de préempter l’avenir politique des juifs d’Europe.
Or, on le sait, il n’y eut pas d’armée juive. Entendons : les juifs d’Europe furent exterminés, non pas sans avoir quelques fois combattu, à titre individuels en tant que soldats dans les armées alliées, dans la Brigade juive sous commandement de la 8e armée britannique, dans les unités combattantes au sein des ghettos de l’Est assiégés, ou au sein d’unités de partisans dans les forêts de l’Est. Mais puisqu’à la fin de la guerre la diplomatie reprendra ses droits, qu’il s’agira alors de faire les comptes, Arendt anticipait qu’en l’absence d’une armée à eux, les juifs seraient politiquement absents de la scène européenne. Rétrospectivement, son analyse s’avère exacte : les juifs ont été vaincus. Ils ont subi une guerre d’extermination à laquelle ils ne purent répondre.
La clairvoyance d’Arendt ne s’éclaire qu’à la lumière de la guerre moderne que Clausewitz définissait comme un duel entre États, symétriquement disposés, qui mesurent leurs puissances respectives, chacune des parties engageant les ressources dont elle dispose et qu’elle est capable de mobiliser dans l’affrontement. Or, dans le cas des juifs, les nazis ont mené la guerre d’éradication contre une population civile, désarmée, une guerre très peu conventionnelle contre un ennemi qu’ils se représentaient comme omniprésent, comme le réseau d’une vaste conspiration. En réponse à cette agression, la guerre moderne eut effectivement exigé qu’un État juif, ou du moins une armée juive, affronte l’État nazi. Or, cet État n’existait pas. Et d’armée sans État, il ne peut exister ; cela s’appelle une milice.
A l’image du duel, la guerre moderne, rationnelle, se déclare, se déroule en un laps de temps déterminé, puis se termine. Elle admet la revanche, l’ouverture d’une nouvelle épreuve de force, mais elle exclut la vengeance. Car la guerre moderne est une modalité maîtrisée du rapport entre des États, qui, tel des « monstres froid » comme les nommait Nietzsche, sont dénués d’affects. La vengeance, quant à elle, se nourrit d’un affect archaïque auquel il était licite de donner libre cours dans le monde prémoderne. La vengeance y entretenait un état de guerre permanent. Dans le monde prémoderne, l’activité guerrière, cyclique, est continue, scandée par des trêves.

Étrangère en théorie à la guerre moderne, la volonté de vengeance et donc aussi l’anticipation de la vengeance d’autrui sont certes perçues comme une scorie, mais continuera cependant à imprégner les conflits. La dimension vengeresse était à l’évidence consubstantielle à la guerre d’extermination contre les juifs qui, précisément, sous cet angle, aussi méthodique fut-elle, n’était pas moderne : vengeance contre l’humiliation que les juifs avait supposément infligé à l’Allemagne depuis « le dictat de Versailles » ; anticipation, sur le front de l’Est, d’une vengeance juive à venir qui justifiait leur éradication[3]. Se pose alors la question : pourquoi, faute de guerre juive, n’y eut-il pas de vengeance juive ?
Afin de répondre à cette question, il convient de se situer non plus dans le moment de la guerre, mais dans celui de l’après-guerre.
*
L’après-guerre est ce moment où l’on tire les conclusions de la guerre, phase charnière de pacification qui passe par un règlement général des comptes entre États jadis belligérants. Remaniement des frontières (appelé en langage prémoderne « prise de terre ») et compensation (autrefois appelé « butin ») sont parmi les moyens habituels de ce règlement. De la première à la seconde guerre mondiale, afin de ne pas réitérer un Traité de Versailles jugé calamiteux pour tous, traité dont la nature punitive était reconnue, les Européens apprirent qu’un règlement équilibré, accepté par toutes les parties, solderait les comptes entre États, une fois pour toute. C’est précisément ce qu’anticipait Arendt : les juifs furent exclus du règlement politique de l’après-guerre. Le règlement accoucha, par étapes, d’une organisation politique nommée « Europe », de laquelle les juifs étaient absents. Les États jadis belligérants s’intégraient progressivement dans un tout qui les dépasse, un tout qui neutralise efficacement leurs inimitiés, alors que les juifs étaient tenus hors champ.
Les Alliés traiteront du cas des juifs, exceptionnel, dans l’arène judiciaire, quoique marginalement. Le procès de Nuremberg en fut le point d’orgue. La guerre nazie d’extermination fut reconfigurée en crime. Pour qu’il soit punissable, il fallait forger une nouvelle catégorie de crime, un crime à l’égard d’un collectif. Telle était la manière dont les juifs, absents de la scène politique internationale, furent réintégrés dans le règlement des comptes de l’après-guerre. Exterminés, ils devinrent un sujet juridique, réputé apte à faire valoir un droit, à réclamer une justice qui se hissait pour la première fois au plan international. Mais dans un tel cadre, la symétrisation du rapport ne pouvait être honorée : un collectif impolitique avait été éradiqué, indistinctement, presque dans sa totalité, alors que l’État qui en avait pris l’initiative et avait assuré son exécution avec l’appui de ses auxiliaires recrutés un peu partout en Europe, sera jugé comme un acteur politique, à travers ses quelques représentants.
Cette asymétrie, beaucoup l’éprouvèrent, dans la guerre. Le jeune Hans Jonas, l’ami de Hannah Arendt, réfugié en Palestine mandataire, fut de ceux qui s’engagèrent précocement dans la Brigade juive. Jonas confesse dans ses Souvenirs que, perché sur son char, traversant des villes allemandes en ruine, y compris sa cité natale, il éprouva un instant une « joie maligne »[4]. La jouissance au spectacle de la destruction de l’ennemi est assurément une vengeance rentrée. Et de cette jouissance passive à la vengeance active, il n’y a qu’un pas, nommé « passage à l’acte ». En prenant conscience, sur le terrain, de la nature inouïe de la scène criminelle encore chaude, la Brigade juive, avec son drapeau frappé de l’étoile de David, échappa alors partiellement au contrôle du commandement britannique. Les actes de vengeance sporadiques contre des prisonniers de guerre allemands, voire contre des civils, se multiplièrent, conduisant à son évacuation d’urgence hors de l’Allemagne occupée, en Belgique. La guerre, pour elle, était terminée.
*
De cette asymétrie irrésorbable, Abba Kovner, le fondateur et le chef de l’Organisation unitaire des partisans (en yiddish : Fareynikte partizaner Organisatzye), qui combattit dans le ghetto de Vilna, puis dans les forêts Baltes, avait une conscience aigüe. C’est précisément pourquoi il refusa de considérer que la guerre s’était terminée avec la chute du IIIe Reich. Il refusa obstinément de se situer dans l’après-guerre. Le règlement devra se faire, urgemment, immédiatement, dans une guerre que les juifs refusent de clôturer. La lutte partisane, non conventionnelle, contre l’État nazi, Kovner voulait la prolonger par une action de vengeance de grande ampleur. Il fallait solder les comptes dans la guerre, car aucun règlement ne le ferait dans l’après-guerre. Au crime de masse il fallait répondre promptement par une tuerie de masse, pour solde de tout compte.

Le projet de Abba Kovner et du commando juif de quelques 50 hommes et femmes, pour la plupart des sionistes et des communistes, qu’il réunit une première fois à Lublin à la toute fin de l’année 1944, échoua. La réalisation de l’opération Nakam, vengeance en hébreu, se déclinait en un « Plan A » — empoisonnement de l’eau potable de quatre métropoles allemandes — ou, à défaut, en un « Plan B » — empoisonner la nourriture de prisonniers SS —, plans complexes échafaudés à la hâte afin de profiter du chaos dans lequel l’Allemagne occupée est plongée. Kovner sollicita des appuis auprès de la Brigade juive, puis partit en Palestine pour plaider sa cause auprès des leader du yichouv, tandis que son commando étudiait les réseaux urbains de distribution d’eau en attendant la livraison du poison. En Palestine, Kovner se heurta au refus net des leader du yichouv dont l’appui logistique et technique lui était indispensable pour mener à bien sa mission. Finalement, seuls quelques milliers de prisonnier SS internés mangèrent du pain empoisonné, ce qui leur provoqua tout au plus des coliques… Kovner dû quitter l’Europe sans coup d’éclat. Malgré son charisme et ses compétences incontestables acquis dans la lutte clandestine, il resta esseulé.
« Vengez-nous » : cette supplique sourdait des juifs assassinés, elle figurait partout, écrite sur murs des synagogues en ruine, inscrite sur des petits morceaux de papier laissés par ceux qui en firent leur dernière volonté avant de périr. Elle résonnait aux oreilles des partisans qui écumèrent les quartiers juifs et villages à la recherche de survivants[5]. Qui, alors, l’accomplirait ? Et, surtout, qui assurerait qu’une vengeance, à la mesure de crime, prémunirait à l’avenir les juifs restants contre toute réitération d’un crime de la sorte ? A ces questions, que Kovner se formulait, il répondait : moi, le juif combattant. Un ouvrage a été consacré à ce héros tragique[6], dont la lecture atteste, peut-être malgré l’intention de l’auteure aux sympathies sionistes affirmées, que l’impossible vengeance colorie, encore aujourd’hui, notre actualité politique.
Pourquoi Dina Porat, qui admire tant le partisan Kovner, l’abandonne-t-elle dans l’après-guerre, suggérant que le héros dont elle se fait l’hagiographe, fut pris d’une passion mauvaise, voire d’une folie incontrôlable ? Kovner garde pourtant la tête froide, couche son diagnostic et son plan d’action par écrit, et conserve l’allégeance de son réseau. C’est que pour les leaders sionistes, Ben Gourion en tête, la guerre est finie. Les juifs ont effectivement subi la plus grande défaite qui soit, faute d’avoir été mis à l’abri dans l’État désormais en gestation. Alors, l’État des juifs, déjà imminent, pourra bientôt se présenter comme l’héritier des juifs assassinés. Il s’imposera comme l’acteur politique juif dans l’après-guerre, à l’exclusion de tout autre, ce qui suscitera plus tard des tensions entre la diplomatie israélienne et le Congrès juif mondial mené par Nahum Goldman qui allait se poser en concurrent lorsque l’État d’Israël devra composer avec le monde nouveau de l’après-guerre. Le traité de 1952 qui liera l’État d’Israël, ainsi qu’une organisation juive américaine ad hoc appelée Claims Conference, à la République fédérale d’Allemagne née en 1949, soldera définitivement les comptes, en monnaie et en produits manufacturés.
Que les juifs d’Europe aient été politiquement vaincus pouvait être admis, c’est même le cœur de la doctrine sioniste qui conduit à cette conclusion : désormais l’État des juifs, lui seul, hisse les Juifs sur la scène internationale. Le procès Eichmann de 1962, où Kovner d’ailleurs déposera, en sera dix ans plus tard l’attestation.
Poète hébraïsant et leader à Vilna du mouvement de jeunesse de la gauche sioniste aux penchants marxistes La jeune garde, Kovner décida in extremis de combattre sur le front européen plutôt que de partir en Palestine. Puis, contraint de renoncer à la mission vengeresse qu’il s’était donné, il quitta l’Europe. Il abandonna le front européen, sans que l’appel à la vengeance de son peuple assassiné ne soit exhaussé. A cette impossible vengeance, jamais il ne se résigna.
Certes, Kovner s’installe en 1946 dans un kibboutz, intègre la Haganah, puis Tsahal. Et son œuvre poétique grandissante sera célébrée dans sa nouvelle patrie, bien qu’elle ramène sans relâche ses lecteurs sur le front européen, celui où les juifs subirent la plus grande défaite qui soit. Car l’État d’Israël est né trop tard. Il manqua l’épreuve de la guerre moderne sur le front européen. Kovner rejoint donc le yichouv qui se muera en un État, État qui est pour lui, par définition, depuis sa naissance en 1948, un État de l’après-coup, un État né au moment où il était trop tard pour résorber l’asymétrie dans une guerre désormais close. Le public israélien consentit à lire Kovner, mais comme un témoin, et l’État d’Israël à célébrer les Partisans et Combattants des ghettos, mais pour les commémorer, les reléguer à un passé révolu.
*
Résumons, ce que l’épopée tragique de Kovner nous enseigne. Du sionisme, il est clair que nous héritons d’un État pour les juifs : mais quel est le legs de Abba Kovner ? Kovner nous lègue une impasse, celle d’une vengeance pensée comme nécessaire et irréalisable.
Notons que la vengeance des juifs, dans leur propre tradition et dans leur histoire tourmentée en Europe, est un acte qui échoie à Dieu. Ce report est inscrit dans les Écritures, motif que l’on retrouve abondamment dans la prose de ceux qui réchappèrent aux équipés meurtrières du temps des croisades médiévales. Le culot des Kovner consistait à vouloir se substituer à Lui. Mais la restauration d’une souveraineté juive, elle aussi, n’était-elle pas traditionnellement dépendante de la volonté divine, alors que l’État d’Israël procède d’une volonté humaine ?
Dieu avait suscité l’exil, Dieu avait suscité la persécution en exil, dit la tradition : il faut que le peuple juif endure, non pas sans se lamenter — là aussi les Écritures fournissent un réservoir abondant de formules — non pas sans quelquefois accuser Dieu. En 1945, Kovner était un sioniste et un vengeur, indissociablement. Coincé sur le front européen en attendant partir rejoindre le yichouv, il cumule, dans cette conjoncture précise, deux expressions de la politisation moderne des juifs : la restauration active sur la terre ; la vengeance par soi-même. Modernes, elles le sont parce qu’elles postulent toutes deux un degré d’autonomie du peuple que la tradition juive nie. Toutes deux bravent tendanciellement un interdit.
Dans sa facture est-européenne la plus résolue, celle d’ailleurs à laquelle Kovner lui-même adhérait, le sionisme aspire à résorber l’exil. Les vengeurs, quant à eux, aspirent à rectifier la condition exilique, définitivement, mais sans l’abolir, car pour Kovner la vengeance est le seul moyen d’assurer au reste des juifs d’Europe la sécurité. Les deux perspectives se contredisent. Les juifs rescapés, évacués d’Europe, sont désormais à l’abri dans un État, affirment les sionistes. Les juifs assureront leur existence en Europe, ajoutait Kovner, si et seulement ils se vengent d’abord. Cette contradiction patente, Kovner l’assume : la réalisation sioniste ne dispense pas d’endosser la seconde, la vengeance juive, sur le front européen. L’impuissance de Kovner scelle alors la défaite des juifs d’Europe, qui se répercute indéfiniment, jusqu’aujourd’hui, dès lors que les juifs, fut-ce un reste, s’y déclarent encore vivants.

Non pas qu’il nous faille regretter l’échec des Vengeurs. Mais leur épopée tragique nous invite à regarder en face la défaite anticipée par Arendt. Plus, elle nous oblige de considérer la défaite sans détourner les yeux, sans tourner le dos à Kovner. La paix européenne s’est payée d’un prix qu’il nous faut certes assumer, tout en gardant le front européen ouvert. Il nous faut déclarer les comptes inclôturables, à la manière de Kovner. Car la guerre d’extermination jadis menée contre les juifs d’Europe est, pour les juifs d’Europe, une guerre interminable. Elle l’est, au présent. Nous restons comme vissés sur ce front. Et c’est à cette condition, à cette condition seulement, que le chapitre de l’histoire des juifs d’Europe, auquel le projet sioniste voulait mettre un terme, restera, lui aussi, ouvert.
Danny Trom
Merci à Joann Sfar pour son dessin de Kovner.
Notes
| 1 | Kol ha-ahavot [Tous les amours], Tel Aviv, Sifriath Po’alim, 1965, p.178. |
| 2 | « Die jüdische Armee – der Beginn einer jüdische Politik ? », 14 nov. 1941. Article republié dans Hannah Arendt, The Jewish Writings, op. cit., p. 134-185. |
| 3 | Omer Bartov, L’Armée d’Hitler. La Wehrmacht, les nazis et la guerre, Paris, Hachette, « Pluriel », 1999. |
| 4 | Hans Jonas Souvenirs, d’après des entretiens avec Rachel Salamander, Paris, Payot & Rivages, 2004, p.161. Dans ce passage de ses mémoires, Jonas précise ainsi son sentiment : « Il y eut dans ma vie des années où, questionné sur ce qui avait été l’instant de bonheur le plus intense de mon existence j’aurais répondu : “cet instant-là – le spectacle des villes allemandes détruites, qu’on peut considérer comme la justice, le châtiment divin” » |
| 5 | Témoignages oraux de Vitka Kovner (l’épouse d’Abba Kovner), d’Arieh Diestel, et d’autres membres membres du commando de partisan de Kovner. Youtube. |
| 6 | Dina Porat, Le Juif qui savait. Wilno-Jérusalem. La figure légendaire d’Abba Kovner, Paris, Le Bord de l’Eau, 2017. |