Depuis de nombreuses années, le lien entre islam et politique s’est imposé au cœur de notre actualité européenne. Il s’est invité comme un problème, et nous avons toute la peine à en comprendre la logique. Quel est donc ce problème, dont il faut commencer par comprendre que, généré par l’islam, il n’en est pas moins notre problème à tous ? L’ouvrage d’Anoush Ganjipour — L’ambivalence politique de l’islam. Pasteur ou Léviathan, Paris, Seuil, 2021 — n’est pas une contribution parmi d’autres à cette interrogation, il se distingue par la profondeur et la radicalité de l’analyse interne, frontale, qu’il nous propose. Rencontre.

Introduction
Dans L’ambivalence politique de l’islam, Anoush Ganjipour se met dans les pas de Léo Strauss : si l’on veut classer les religions monothéistes, judaïsme et islam vont ensemble, ils sont centrés sur la loi, alors que le Christianisme s’organise autour de la foi. Plus précisément : l’islam prend acte du geste d’élargissement universel chrétien opéré sur le judaïsme, l’endosse, mais en opérant une marche arrière pour y ré-encastrer la loi. En simplifiant on dira que l’islam ne propose pas une loi pour un peuple, ni une foi pour l’humanité, mais une loi pour l’humanité. Mais en replongeant l’islam dans le bain de l’Antiquité tardive, Anoush Ganjipour fait ressortir la singularité du dispositif islamique avec une acuité inégalée.
L’islam, nous explique-t-il, doit être compris comme un langage théologico-politique persistant. Ce langage, qui possède une structure immuable, est dual. Il oscille en permanence entre deux pôles : la loi (la législation) et la foi (la guidance), le modèle monarchique (le commandeur qui a autorité sur un sujet collectif) et le modèle pastoral (le gouvernement individualisant du guide), un État et une communion universelle. Toutes les manifestations historiques de l’islam oscillent entre ces deux possibilités contradictoires. Entre la monarchie et le pastorat, l’islam ne choisit pas, mais les associe dans leur tension, ce qui génère des échanges, des communications, des interpolations, des contaminations réciproques entre les deux pôles. La cohérence de l’islam, selon Anoush Ganjipour, tient à ce qu’il reste lui-même dans une dynamique historique qui va de l’Antiquité tardive jusqu’aujourd’hui, jusque dans ses expressions les plus actuelles. Tel un balancier, il bascule d’un pôle à l’autre, sans jamais se stabiliser. Où alors se situe la politique de l’islam ? Anoush Ganjipour répond qu’elle git dans cette bipolarité inextricable entre deux forces théologico-politiques, dont elle ne sort pas : la Loi suppose l’État, mais la Loi subvertit l’État. Que Dieu soit puissant (ou grand) peut signifier que sa Loi doit s’imposer par la médiation du monarque (de l’État) mais cela peut aussi bien signifier que l’État monarchique islamique doit être abattu pour céder la place à une communauté guidée par l’amitié. Ce sont deux potentialités d’un seul et même langage, des expressions qu’autorise une même matrice. Plus que cela encore — et cela complexifie encore davantage la démonstration d’Anoush Ganjipour — l’une est toujours déjà dans l’autre, chaque force est aussitôt emportée dans le mouvement pendulaire qui va de l’une à l’autre, ce qui ne laisse aucune voie de sortie.
De là, on ne conclura pas que l’islam ne se laisse pas affecter par l’extérieur, et ne s’adapte pas aux contextes géopolitiques les plus divers. Mais il affronte ces épreuves en les reformulant et en les pliant à son langage propre. À ce point, Anoush Ganjipour s’interroge, et nous avec lui : qu’est-ce que ce ploiement implique, comment pèse-t-il sur la situation européenne d’aujourd’hui ? « Pourquoi la notion islamique de communauté fait justement obstacle à la communauté des individus autonomes qui est au fondement de la modernité ? » écrit-il à la page 276 de son livre. C’est à la circularité théologico-politique du langage de l’islam qu’il faut revenir pour poser ce problème avec sincérité et réalisme.
Dans l’entretien que l’auteur a accordé à K., l’interrogation cruciale devient celle-ci : Y a-t-il une issue moderne à ce dispositif théologico-politique, et si oui laquelle ? Car le travail de ce grammairien de la politique de l’islam a une double adresse : il concerne la communauté politique que tente de dessiner l’Europe, qui comprend désormais en elle un nombre significatif des locuteurs de l’islam ; et il s’adresse plus spécifiquement aux locuteurs de cette langue, afin qu’ils y trouvent un levier réflexif, et donc, suppose-t-on, un moyen d’apprendre à le moderniser par eux-mêmes, en puisant à leur propre source. — Danny Trom
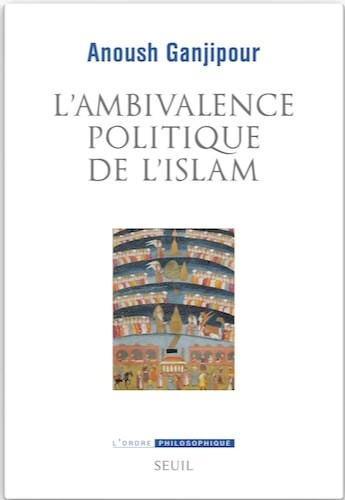
Dans votre livre, vous semblez faire de l’ambivalence une notion clef pour saisir le rapport de l’islam à la politique. Dans quel sens ce rapport est-il ambivalent ?
Anoush Ganjipour : Il faut partir de ce qui a été la problématique de départ de ce travail. Ce qui me préoccupait, c’était la difficulté majeure qu’on rencontre lorsqu’on essaie de comprendre le rapport de la tradition religieuse, théologique et même métaphysique de l’islam avec la politique. Cette difficulté tient au fait qu’on peut avoir deux lectures tout à fait cohérentes et fondées, mais contradictoires de l’ensemble de cette tradition. On peut la lire, dans son développement historique propre, comme une mise en retrait progressive de la vision politique du monde, ce qui coïncide avec la transformation rapide du gouvernement islamique primitif en une succession de règnes impériaux jusqu’à un certain point séculiers, avec en parallèle une série de gouvernements locaux sur la terre d’islam. Mais on peut aussi lire la même tradition en adoptant une autre grille de lecture : considérer que l’ensemble de la tradition islamique implique, dans presque tous ses recoins, les questions liées à la politique au sens terrestre du terme. On est donc face à un phénomène assez particulier car les mêmes sources, les mêmes penseurs, les mêmes corpus se prêtent à deux lectures : l’une politique, et l’autre anti-politique, voire apolitique.
Or, ce problème se complique encore davantage : on peut constater qu’à l’intérieur de la lecture politique de l’islam, ce même dédoublement interprétatif se reproduit. Ici aussi vous pouvez lire la tradition islamique comme fondamentalement axée sur l’idée d’un pouvoir théologico-politique hégémonique, hiérarchique et centralisé, ce qu’on appelle aujourd’hui de façon vague le califat. Mais vous pouvez également lire cette tradition en y voyant une sorte de théologie de libération où le religieux fournit un levier particulièrement efficace pour déstabiliser toute forme de soumission ou d’exercice hégémonique d’un pouvoir, y compris d’un pouvoir qui s’exerce au nom de l’islam.
L’ambivalence réside précisément ici. Car en réalité ces illusions d’optique sont inhérentes au rapport du théologique et du politique dans l’islam. Ce qui fait que le rapport de l’islam à la politique terrestre apparaît constamment comme un Kippbild, pour reprendre un mot allemand difficile à traduire, soit une « image ambiguë ».
Et c’est dans cette ambivalence que vous voyez le problème politique de l’islam ?
A.G. : Oui, j’y vois le problème dans le sens où cette ambigüité empêche que l’on applique les solutions de la modernité pour délier le politique du religieux à l’intérieur de la tradition islamique. On ne peut pas juste calquer l’idée de sécularisation sur elle. Le résultat de cette situation est une série de tentatives paradoxales : les uns pensent que le problème de l’islam est la sharia et qu’il faudrait refouler cet aspect normatif pour rendre l’islam compatible avec une politique séculière. Certains islamologues vont si loin dans cette voie qu’ils veulent inventer, au nom du shiisme, un islam spirituel sans Loi, qui ressemble plutôt à une sorte de christianisme alternatif sans Église et qui n’a à vrai dire jamais pu exister comme tel dans l’histoire. Un autre groupe parmi les islamologues ou penseurs arabes pense exactement le contraire. Ils renvoient à l’État shiite iranien en expliquant qu’un tel État au nom de l’islam n’a été possible qu’à cause du rapport spécifique que le shiisme entretient avec la sharia et la Loi divine. Autrement dit, ils considèrent que le problème ne vient pas de la sharia mais plutôt du fait que le shiisme a compromis la centralité de la sharia dans l’islam par une foi ésotérique et spirituelle. Ce quiproquo interprétatif devient cocasse mais aussi très intéressant lorsque certains parmi ce dernier groupe, comme par exemple Wael Hallaq, vont jusqu’à théoriser dans les universités américaines une conception de l’islam axé sur la sharia qui serait carrément selon eux un antidote à l’idée de l’État religieux et ils proposent un tel islam légaliste comme religion civile anti-étatique à même de réaliser, en Occident même, la promesse postmoderne d’une société autogouvernée et post-étatique.
Je ne crois pas du tout à une essence particulière qui distinguerait l’islam des autres religions monothéistes. Par contre, je crois que l’islam a agencé les éléments religieux qu’il avait à portée de main d’une façon spécifique pour arriver à une structuration théologico-politique qui lui est propre.
A l’intérieur du monde musulman, parmi les tenants de l’islam politique et ceux qui s’y opposent, nous rencontrons le même paradoxe. On dirait que tous tentent d’écarter les éléments qui gênent ou qu’ils considèrent comme non-authentiques pour donner un sens univoque au rapport de l’islam à la politique. Mais en vain, parce que, comme je viens de le dire, ce rapport reste ambigu et rend le tout ambivalent, que ce soit dans les discours théologique, juridique, métaphysique ou même mystique de l’islam.

Si on accepte votre schématisation, il faut croire que cette ambivalence est inhérente à l’islam et répandue partout dans sa tradition. Comment expliquez-vous cette omniprésence qui ne s’efface pas ? Ne tombe-t-on pas alors dans une sorte d’essentialisme ?
A.G. : Dans mon livre, j’explique longuement pourquoi je ne crois pas du tout à une essence particulière qui distinguerait l’islam et la tradition islamique des autres religions monothéistes ou traditions religieuses de l’Antiquité tardive. Par contre, je crois que l’islam, comme toute religion, a agencé les éléments religieux qu’il avait à portée de main d’une façon spécifique pour arriver à une structuration théologico-politique qui lui est propre. J’ai essayé de faire une sorte d’archéologie de cette structuration pour comprendre pourquoi elle génère l’ambivalence. Et la réponse à laquelle je suis parvenu, c’est que l’islam a intériorisé deux paradigmes d’autorité hétérogènes : d’une part le paradigme monarchique et, d’autre part, le paradigme pastoral qui est basé sur l’idée de la guidance. Le monothéisme, le gouvernement divin du monde, le rapport de Dieu aux hommes, la prophétie : la tradition islamique, dès sa genèse, a voulu penser et systématiser tout cela à la fois à partir du paradigme monarchique et du paradigme pastoral. C’est donc le télescopage des deux paradigmes qui a structuré le rapport théologico-politique de l’islam en une image ambigüe.
Concernant le rapport de la royauté à la prophétie, la figure de David joue un rôle clef dans toute la tradition islamique, y compris pour les théoriciens modernes de l’État islamique. Mais le David que décrit le Coran subit des modifications intéressantes par rapport à sa figure biblique.
Dans les sources juives, il existe aussi une certaine tension entre la monarchie et la prophétie. Le roi n’a aucun pouvoir sur la Loi révélée, et lorsqu’il sort du chemin droit, c’est le prophète, à partir de sa position propre, qui intervient pour jouer le rôle du contre-pouvoir. Est-ce que l’islam reprend quelque chose de ce schéma biblique ?
A.G. : Justement, il me semble que pour comprendre cette structuration particulière de l’islam, il faudrait partir des traditions qui ont été ses sources principales, c’est-à-dire le judaïsme, le christianisme, mais aussi le néoplatonisme et la pensée théologico-politique grecque tardive ou encore les religions iraniennes. Car cette tension se retrouve déjà à des degrés différents dans la plupart de ces traditions religieuses qui sont en pleine formation ou transformation pendant la longue période de l’Antiquité tardive. Je dirais que ce qui caractérise l’islam, c’est que la tension y atteint un niveau critique. Critique dans deux sens, puisque d’une part cette tension rend problématique le rapport de cette religion à la politique. Mais, d’autre part, elle est à l’origine de la dynamique interne de la pensée politique islamique dans son développement historique jusqu’à nos jours.
Pour revenir au cas du judaïsme, le dossier des emprunts de l’islam, surtout en ce qui concerne le rapport du religieux au politique, est très vaste. L’insistance actuelle sur la parenté du judaïsme et du christianisme, souvent dans le but d’isoler davantage l’islam et les musulmans, fait oublier un fait notoire que Leo Strauss rappelait déjà aux Occidentaux. S’il fallait tracer une ligne de partage entre les trois grands monothéismes, cette ligne mettrait le judaïsme et l’islam, qui sont des religions juridiques, d’un côté, et le christianisme, seul, de l’autre côté. Ceci dit, ce qui m’importait dans ce travail, c’était plutôt de voir selon quelle logique interne la tradition islamique choisit ces éléments empruntés au judaïsme et comment elle les redéfinit pour les réagencer dans une nouvelle structure.
Concernant le rapport de la royauté à la prophétie, la figure de David joue un rôle clef dans toute la tradition islamique, y compris pour les théoriciens modernes de l’État islamique. Mais le David que décrit le Coran subit des modifications fort intéressantes par rapport à sa figure biblique. Le David de l’islam est à la fois roi et prophète, il a même son propre livre sacré, et Dieu lui accorde la sagesse divine et ésotérique. Le discours coranique va encore plus loin en lui donnant littéralement le titre de Calife désigné par Dieu sur la terre. L’importance singulière de David vient de ce statut qui réunit plusieurs qualités ou fonctions a priori séparées. En réalité, David devient ainsi le modèle archétypal pour la figure de Mahomet qui est tout cela à la fois et, ensuite, pour l’idée du califat islamique sur la terre.
À propos de la relation généalogique de l’islam avec le judaïsme, revenons sur le passage de votre livre où vous nous décrivez les premiers face-à-face entre juifs et musulmans à Médine. Ce moment a été formateur pour la matrice politique islamique, parce que les juifs ne sont pas des individus mais forment déjà une communauté distincte dans la société tribale de l’Arabie ; ils forment une communauté religieuse mais sur la terre et non pas projetée simplement dans le royaume des cieux. Évidemment l’idée d’une loi divine qui s’applique dans la vie d’ici-bas et qui sert à une telle organisation communautaire est capitale. Comment l’islam s’inspire et se distingue de cette forme de la communauté religieuse et du lien communautaire ?
A.G. : Le texte que la tradition islamique considère comme son premier document politique nous éclaire sur cette relation. C’est une espèce de charte que Mahomet établit pour fonder son gouvernement à Médine lorsqu’il s’y installe avec le premier groupe de ses adeptes. Dans cette charte, deux communautés sont reconnues comme telles et par la même désignation d’umma. Cela signifie que les nouveaux convertis musulmans sont désormais une communauté au sens à la fois religieux et politique comme celle que forment déjà les tribus juives enracinées dans la région. Or il faut savoir ce que signifie le mot umma en arabe de l’époque. Il désigne un groupe d’individus qui est mené par un guide vers un but eschatologique qui est le salut. Et la Loi constitue l’instrument de cette guidance.
Donc c’est une relation qui ne se définit pas simplement dans le contexte idéologique de l’Antiquité tardive, mais qui s’inscrit d’abord dans l’organisation tribale de la société de l’Arabie de l’époque.
A.G. : Tout à fait. Ce rapport mimétique et en même temps différentiel avec la constitution théologico-politique de la communauté des juifs est le premier pas décisif qui va ensuite permettre à l’islam de passer du contexte socio-politique tribal de l’Arabie à la carte idéologique et doctrinale de l’Antiquité tardive pour façonner son identité religieuse comme un nouveau monothéisme. Et cette identité se construit à partir de la superposition de deux couches. Une première couche anthropologique qui est en effet propre à l’Arabie en tant que lieu de naissance de l’islam. Et une seconde couche qui est celle des systèmes religieux et politiques de l’Antiquité tardive.
L’islam s’efforce de se positionner dans l’espace entre le judaïsme et le christianisme en marquant bien ses frontières avec eux.
Effectivement, le même mot umma existe aussi dans la littérature rabbinique pour désigner des groupes constitués, avec leur propre loi ou leur gouvernement. Simplement, la umma par laquelle les juifs s’auto-désignent se distingue nettement de cette umma que les musulmans aspirent à former.
A.G. : Pour saisir la logique de la divergence, on doit se situer sur le plan de la carte doctrinale de l’Antiquité tardive. Et là, l’orientation générale de l’islam devient assez claire. Pour s’ériger en système religieux le plus complet et le plus efficace par rapport à ses rivaux, l’islam s’efforce de se positionner dans l’espace entre le judaïsme et le christianisme en marquant bien ses frontières avec eux. En l’occurrence, l’exemple de la umma est bien instructif. Car pour cerner le sens que la tradition islamique veut lui donner, il faudrait la comparer à la fois avec les communautés au sens juif et chrétien du terme. C’est-à-dire, d’une part, avec une communauté unie par l’élection et l’alliance divines mais concrètes et, d’autre part, avec une communauté dont Paul définit le mode d’unité lorsqu’il annonce que « nous, chrétiens, sommes membres du corps du Christ ». Par rapport à ces deux communautés, le Coran décrit la umma d’Abraham, qui représente le modèle archétypal de la umma islamique, dans un énoncé lapidaire et a priori indéchiffrable en affirmant qu’« Abraham fut une umma » (16 : 120). Les penseurs musulmans, selon des époques ou des tendances différentes, ont essayé de régler le problème en s’appuyant sur la polysémie du mot umma ou en l’interprétant dans un sens métaphorique ou métonymique. Ainsi, certains avancent que l’énoncé signifie qu’Abraham était père ou guide de sa umma, ou qu’il résumait en sa personne les vertus de sa communauté bien guidée. Mais quelques autres, souvent shiites, insistent sur le sens littéral de l’énoncé en affirmant qu’Abraham et sa umma ne font qu’un, comme l’union du guide et de celui qui est guidé dans la guidance idéale. L’ambivalence de cette définition de la umma islamique est une illustration parfaite de ce que j’appelle l’ambivalence politique de l’islam.

Cette guidance, en quoi consiste-elle exactement pour constituer une fonction théologico-politique distincte par rapport au statut du prophète ou par rapport à la Loi ? Surtout lorsqu’on pense à la communauté juive qui, depuis la fin de l’époque des prophètes, se guide à partir de la Loi et de son interprétation.
A.G. : Dans le contexte de l’Antiquité tardive, puis dans l’islam, la guidance se définit par un rapport personnel et sans intermédiaire avec le guide qu’il faut suivre pour être sauvé. Dans ce sens, c’est un gouvernement personnel selon le modèle pastoral. Le guide n’est pas un roi, mais un pasteur qui gouverne individuellement chaque membre de sa communauté et prend soin de lui comme de sa brebis. Chez les juifs, comme plus tard chez les musulmans légalistes, l’idée hégémonique est qu’après la fin de la prophétie, la Loi révélée est à elle seule la guidance pour chacun et, in fine, pour la communauté. En même temps, dans le Coran, ce qui est reproché aux juifs est justement qu’ils se contentent de leur Loi au lieu d’accepter que la guidance de Mahomet prenne le relais des prophètes d’Israël.
Donc, de nouveau, il s’agit de se différencier du modèle adopté par les juifs. Mais ce rapport de la Loi et de la guidance devient lui-même une source de tension interne à l’islam et va contribuer à l’ambivalence. D’où d’ailleurs le rapport compliqué de l’islam avec le messianisme car la guidance du Messie est censée permettre la suspension, voire l’annulation de la Loi. Or, historiquement, on constate que, d’une part, le messianisme s’impose dès le début comme une composante indispensable dans la structure théologico-politique de l’islam. Alors que, d’autre part, c’est une composante qui ne cesse d’être problématique, y compris pour le shiisme qui veut faire de l’islam une religion principalement messianique.
Il y a une attitude qui consiste à d’abord séparer le sunnisme et le shiisme pour les traiter comme s’il s’agissait de deux religions complètement différentes, et non pas comme deux courants à l’intérieur de la même religion.
Une question vient forcément à l’esprit. On se demande si la manière dont vous décrivez la question politique de l’islam n’est pas prédéterminée par la vision shiite.
A.G. : Naturellement, pas plus que tout autre chercheur, je n’arriverais sans doute à me détacher complètement de mon arrière-plan culturel qui, en l’occurrence, est marqué par le shiisme et plus généralement par l’islam iranien qui inclut aussi plusieurs tendances intellectuelles ou courants mystiques du sunnisme. Ceci dit, je me suis efforcé de faire la démarche à rebours. A propos de la question politique de l’islam, il y a une attitude, répandue beaucoup plus en Occident que dans le monde musulman même, qui consiste à d’abord séparer le sunnisme et le shiisme pour les traiter comme s’il s’agissait de deux religions complètement différentes dans deux mondes isolés l’un de l’autre, et non pas comme deux courants à l’intérieur de la même religion. Cette vision des choses est tout sauf historique. Il faut se rendre compte que le schisme shiite n’est pas une solution alternative qui, à un moment plutôt tardif de l’histoire de l’islam, se formulerait pour régler une fois pour toutes une crise théologico-politique, comme c’était la prétention de la Réforme protestante pour le christianisme. Au contraire, le clivage entre les deux courants sunnite et shiite se produit dès le début de l’histoire de l’islam et il est coextensif à cette histoire. Cela signifie qu’on devrait considérer ce clivage à la fois comme un phénomène historique qui exprime la crise structurante de l’islam et comme une tentative permanente pour la résoudre. Par exemple, la question de la Loi se repose sans cesse dans l’histoire des différentes branches shiites et fait perdurer une crise à l’intérieure du shiisme. Et de l’autre côté, l’islam sunnite ne parvient jamais dans son histoire à exclure totalement la question messianique malgré son incompatibilité avec l’accent légaliste fort du sunnisme qui veut refuser toute guidance religieuse hors la sharia. A chaque fois que l’islam sunnite veut formuler une théorie de pouvoir politique, la question messianique ou millénariste rejaillit d’une certaine manière, et cela depuis la première dynastie califale jusqu’à l’idéologie ottomane et ensuite jusqu’à la pensée de la possibilité du gouvernement islamique chez les musulmans modernes.
Et lorsqu’on regarde l’histoire intellectuelle de l’islam, la pensée théologico-politique se développe et évolue des deux côtés à travers un réseau d’influences mutuelles, de relais et de répliques autour des questions et des réponses qui se formulent de façon symétrique. Aucun penseur musulman ne pense en dehors de ce réseau, qu’il le veuille ou non. C’est justement en suivant ce réseau que j’ai essayé de rendre compte du devenir historique de la pensée politique islamique dans une continuité qui arrive jusqu’à l’époque moderne. Sinon, en séparant les penseurs musulmans ou leurs thèses au nom de leur appartenance au sunnisme ou au shiisme, on perd de vue cette continuité circulaire. On perdrait même de vue la logique qui est derrière leur divergence.
Prendre le texte du Coran et s’indigner de sa violence qui nous rappelle les actes de Daesh est une absurdité qui n’aide en rien à la compréhension du problème.
On se demande en quoi ce cheminement généalogique que votre livre propose pour la pensée politique islamique pourrait aider à penser la situation actuelle des musulmans confrontés à la politique moderne qui est basée sur la forme d’État-nation laïcisé.
A.G. : Mon projet dans ce livre n’était pas de proposer une solution à ce problème. Je voulais faire d’abord un pas en arrière pour introduire la dimension historique de la pensée politique islamique dans le débat. Il me fallait comprendre dans un premier temps comment cette pensée politique, à partir d’une dynamique interne, a connu une série de transformations historiques pour arriver jusqu’à nous. Prendre le texte du Coran et s’indigner de sa violence qui nous rappelle les actes de Daesh est une absurdité qui n’aide en rien à la compréhension du problème. Pas plus que l’islamologue français qui commente de manière abstraite un philosophe shiite du 17e siècle pour expliquer que si ce philosophe a pu inspirer la théorie contemporaine de l’État shiite, c’est parce qu’il a été mal lu par Khomeyni. Raisonner ainsi, c’est nier l’historicité de la lecture de Khomeyni ou de ses contemporains. Pour déconstruire théoriquement l’État islamique iranien, ce qui me paraissait beaucoup plus important, c’était de comprendre d’abord comment et selon quelle logique historique interne à la tradition islamique une telle lecture de la philosophie shiite par Khomeyni est devenue possible.
Cette approche nous conduit à considérer des phénomènes contemporains comme l’État shiite, les Frères musulmans ou d’autres formes d’islam politique non pas de façon unilatérale mais selon leur double facette : d’une part comme les symptômes d’une crise interne de la tradition islamique et, d’autre part, comme les produits d’une dynamique interne à partir de laquelle cette tradition s’est constamment remaniée pour répondre aux nouvelles circonstances historiques selon les exigences ou possibilités de sa propre structure. Le fait qu’elle n’évolue pas dans le sens que nous souhaitons ne signifie pas qu’elle ne se transforme pas historiquement.
Pourquoi les transformations historiques de la pensée politique islamique n’ont-elles pas abouti à son auto-adaptation aux conditions de vie modernes, mais ont poussé cette tradition plutôt dans le sens contraire et vers une confrontation ?
A.G. : C’était très exactement ma question directrice. On se demande pourquoi la tradition islamique a réagi de cette façon critique. Dans les analyses hâtives, deux choses évidentes sont souvent oubliées. Que chacun des deux discours politiques, moderne et islamique, ont leur histoire. Et qu’en même temps, ils ont des origines qui se croisent. S’il n’y avait rien de commun ou d’analogue entre les deux discours, leur rencontre ne pourrait pas prendre la forme d’une confrontation à ce point critique pour les deux. Surtout, si on se rappelle que cette rencontre a d’abord eu lieu sous le poids hégémonique du discours moderne et de l’idéologie du progrès dans un Orient vaincu, on doit se demander pourquoi le résultat n’a pas été la liquidation de la pensée politique islamique dans un processus de sécularisation. Mon archéologie historique de la tradition islamique est mise au service d’un objectif : créer un espace comparatif qui permette de comprendre par quels moyens ou mécanismes les deux discours politiques moderne et islamique se problématisent mutuellement.
C’est à partir de la dynamique historique moderne et en dialogue avec le discours politique européen que la conception de la umma et toute la pensée politique islamique se transforment.
On a parfois l’impression que certaines incompatibilités sont structurales. La nouvelle condition de vie des musulmans dans l’espace européen ou plus généralement occidental exige un mode de vie communautaire par définition minoritaire. C’est-à-dire une communauté qui, indépendamment de son nombre, se situe au même niveau que les autres communautés religieuses et sous un État laïc. Or la umma islamique s’inscrit dans une perspective universaliste, elle a la vocation de s’imposer à terme comme majoritaire. Comment les musulmans d’Occident pourraient-ils régler cette contradiction dans leur double appartenance collective ?
A.G. : Je répondrais d’abord qu’historiquement la tradition islamique n’est pas étrangère à la condition minoritaire. A cause du schisme advenu très tôt, la minorité sunnite sous les pouvoirs shiites et, de façon beaucoup plus durable et massive, les minorités shiites sous les pouvoirs sunnites ont eu une expérience de communauté minoritaire et d’ailleurs sévèrement persécutées. Cela a produit un impact sur le discours théologique et juridique. La notion de taqiya ou la dissimulation confessionnelle dans l’espace public, dont aujourd’hui on accuse quelque fois les Français musulmans, était à l’origine un ajustement théologique que la tradition islamique, surtout dans son versant shiite, avait développé pour organiser une vie minoritaire. Puis, à l’époque prémoderne, lorsque les changements de frontières ou les invasions mettent les populations musulmanes en situation minoritaire sous un pouvoir chrétien, les écoles juridiques sunnites n’ont pas eu de mal à trouver des solutions qui permettent à la communauté musulmane de passer au mode minoritaire. C’est ce qui est arrivé par exemple après les Croisades ou lors de l’invasion russe au Caucase ou en Asie centrale.
À ceci près que cette minorité se définit encore à partir d’une communauté majoritaire qui existe ailleurs sur la terre, c’est-à-dire la umma de tous les musulmans. Elle ne se voit pas comme une communauté minoritaire, mais comme un fragment temporairement séparé d’une communauté majoritaire.
A.G. : Là encore on revient aux transformations historiques de la pensée politique islamique. Car cette notion actuelle de la umma est elle-même largement une reconstruction qui nous renvoie au 19e siècle et au début du 20e siècle lorsque les penseurs musulmans rencontrent les sciences sociales et politiques modernes et entrent activement en dialogue avec le discours de la modernité. C’est un moment tout à fait décisif dont l’intensité et la richesse intellectuelle ne sont toujours pas mesurées. J’exagère à peine en disant que l’islam se réinvente à travers ce moment qui va grosso modo de la seconde moitié du 19e siècle à la seconde guerre mondiale. Et c’est là que la umma se transforme chez les penseurs musulmans en une espèce de méta-nation au sens moderne du terme. Avant, la umma est une communauté dans un sens plutôt existentiel. Dans l’imaginaire d’un musulman, elle ne recouvre jamais l’ensemble des populations dites musulmanes qui sont de facto éparpillées sur le globe. La umma comme entité politique terrestre et territoriale qui unifie l’Inde musulman, l’Iran, les populations arabes autour du Golfe persique, le Maghreb et aussi les parties turques de l’Empire ottoman, c’est un concept reconstruit qui s’inscrit dans le discours du nationalisme moderne et veut être une réplique islamique à ce discours. Le fait que cette reconstruction conceptuelle coïncide avec le développement du sionisme durant la même période n’est pas un hasard. C’est à partir de la même dynamique historique moderne et en dialogue avec le même discours politique européen que la conception de umma et toute la pensée politique islamique se transforment.
Là où la chose se complique du côté musulman c’est qu’à travers la même dynamique, on assiste à la naissance des nationalismes modernes arabes, turcs, iraniens, pakistanais etc. Alors que les premiers penseurs modernes de l’islam voulaient précisément refouler cette fragmentation par leur concept de umma. Aujourd’hui, la question de la communauté musulmane en tant que minorité en Occident est à mon avis secondaire au regard du binationalisme de ses membres.

Voulez-vous dire que les musulmans ne sont pas seulement des musulmans, mais ils sont d’abord membres d’État-nations modernes qui, eux, sont musulmans ?
A.G. : Je veux dire que l’islam, avec son potentiel politique, intervient comme un médiateur pour déterminer l’identité binationale de ceux qui sont Européens, mais s’identifient comme appartenant à la fois à un autre État-nation qui a sa propre culture, ses propres antagonismes politiques ou économiques, son histoire qui peut être marquée par le colonialisme ou pas, etc. C’est pourquoi en ce qui me concerne, je préfère chercher des nouvelles formes possibles de subjectivité diasporique. Car ce sont ces nouvelles formes qui réformeraient de l’intérieur la communauté des musulmans en France ou ailleurs en Occident.
Il n’y a pas de doute que les musulmans et les juifs sont en Occident les deux minorités les plus proches du point de vue culturel.
Cela nous amène au dernier point que nous voulions aborder avec vous. Dans un article récemment publié sur AOC, vous plaidiez pour la participation active des musulmans européens à la pensée moderne en vous référant au cas des juifs d’Europe. En quoi les deux cas vous paraissent comparables ?
A.G. : Pour moi, il n’y a pas de doute que les musulmans et les juifs sont en Occident les deux minorités les plus proches du point de vue culturel. Cette proximité renvoie à une série d’affinités structurales entre les deux religions, mais aussi à une histoire culturelle commune en Orient. Avec ces affinités et cette histoire, il y aurait une symétrie analogique entre les places que juifs et musulmans occupent dans l’espace occidental et ici en France. Par contre, une différence importante les sépare à l’intérieur de cet espace : c’est l’inscription beaucoup plus ancienne des juifs dans l’histoire de l’Occident moderne et le rôle qu’ils ont joué dans le développement du discours moderne, y compris pour le développement de sa conscience autocritique. Cette contribution a été possible à partir de la construction d’une figure hybride de juifs, depuis Mendelssohn, Marx ou Durkheim jusqu’à Levinas, Derrida et même quelqu’un de radicalement critique vis-à-vis de l’Europe moderne comme Scholem. Figures hybrides, parce que tous avaient un pied à l’intérieur de l’Europe et un pied plus ou moins dans le judaïsme. Et c’est en effet cette position hybride qui leur a donné une position singulière pour contribuer au développement critique de la modernité. Je vois là, dans l’invention de cette figure hybride, un geste à imiter du côté musulman. Bien entendu, le résultat ne sera pas le même, mais c’est cette qualité singulière de la contribution, cette fois du côté islamique, qui me paraît si importante à reproduire.

Cet échange mimétique dont je parle a eu lieu une fois dans le sens inverse au 19e siècle et par les premiers islamologues juifs européens, les gens comme Abraham Geiger, Gustav Weil et de façon plus exemplaire Ignace Goldziher. La culture musulmane n’était pas pour eux simplement un sujet d’orientalisme. La situation différente de cette culture, le fait qu’elle s’était développée sans persécution et puis sans être écrasée par les Lumières en faisait pour ces juifs un modèle à imiter. Mais une imitation à l’intérieur de la modernité européenne et pour construire une identité à la fois juive et moderne. C’est exactement ce geste qui me paraît imitable dans l’autre sens.
Mais les conditions historiques ont bien changé ; cette figure hybride juive s’est tendanciellement effacée en Europe.
A.G. : Bien entendu, la situation historique est tout à fait différente. La première chose qui a changé radicalement, c’est que le binationalisme dont je parlais est la nouvelle condition qui affecte maintenant aussi bien les musulmans que les juifs en Occident. Je ne néglige pas les modalités forcément différentes de ce binationalisme des deux côtés. Pourtant, ce qui me paraît plus important à souligner, c’est que cette situation inouïe pousse en même temps les deux côtés juifs et musulmans à l’élaboration des nouvelles formes de subjectivité diasporique.
La situation des juifs ne se caractérise pas par un binationalisme ! La diaspora juive s’inscrit dans un dispositif nommé Galouth qui a permis aux juifs d’appartenir pleinement aux nations modernes tout en demeurant un collectif spécifique, cela sans contradiction.
A.G. : J’entends bien. Evidemment, du côté musulman, la diaspora ne se définit pas par référence exilique à une terre sainte. Mais, il y a aussi un fait nouveau du côté juif qui me semble affecter profondément la condition exilique. A partir du moment où, avec la création d’Israël, un État-nation au sens moderne du terme vient se superposer à l’idée de terre sainte, je crois que quelque chose change au niveau même de la signification de la Galouth pour les juifs. D’une part, un État qui se dit d’abord l’État des juifs et ensuite l’« État juif » a de facto tendance à considérer tout individu juif comme son citoyen virtuel. Et d’autre part, l’invective antisémite qui vient mettre en question l’existence diasporique du juif français, allemand etc. se formule suite à ce changement comme : « tu es juif, alors rentre chez toi ». J’ai l’impression que ces deux aspects de la nouvelle condition exilique ne laissent plus aucun juif indifférent. Quoique sous cette forme singulière, le binationalisme devient alors un défi pour sa subjectivité diasporique, même malgré lui. Cela peut être le cas d’un français israélite convaincu comme Raymond Aron qui est l’un des premiers à sentir ce changement subjectif dès la guerre des Six Jours, jusqu’à la situation contradictoire, situation tragique et à la fois un peu comique, dans laquelle Eric Zemmour se retrouve aujourd’hui lorsque les antisémites lui demandent de « rentrer chez lui ! »
Le fait que cette injure antisémite sorte de la bouche d’un autre français qui est comme Zemmour mais d’origine arabo-musulmane résume à mon avis la complexité du rapport entre l’existence diasporique des juifs et des musulmans ici en Europe. Même si c’est sous des formes différentes, leur marquage binational les met dans des positions similaires et en même temps rend leur relation problématique. Dans cette situation nouvelle, je vois un défi partagé des deux côtés, mais qui est aussi une occasion pour communiquer autour de cet effort commun. Évidemment, on ne peut pas se cacher que le grand obstacle devant cette communication d’expérience diasporique ou cet effort commun est le conflit israélo-palestinien et le sentiment d’injustice qu’il génère.
Mais le fait qu’aujourd’hui en 2021 le vieux discours antisémite du 19e siècle soit repris littéralement par des publicistes ou même des responsables politiques pour être appliqués cette fois aux musulmans a une signification objective et claire. Lorsqu’on voit les musulmans soupçonnés de dissimuler leurs croyances « véritables » sous les apparences de citoyens normaux, comment ne pas penser aux mêmes chefs d’accusation brandis contre les marranes dans des temps qu’on croyait révolus ? Ceci devrait rappeler aux musulmans et aux juifs que leurs sorts sont indissociables ici en Europe et je dirais même, que cela devrait leur rappeler leur fraternité culturelle qu’ils ont tendances à oublier. L’optimisme n’est pas mon fort, mais plus j’y réfléchis plus je suis convaincu que cette nouvelle subjectivité diasporique juive et musulmane aurait même un rôle à jouer pour arriver à une nouvelle entente et une paix véritable entre juifs et musulmans en Orient.
Anoush Ganjipour
Propos recueillis par Danny Trom
Philosophe, spécialiste de la pensée islamique, Anoush Ganjipour est chargé de recherches au CNRS. Ses travaux portent sur la pensée politique et la pensée poétique dans la tradition islamique. De 2013 à 2019, il a dirigé un programme de recherche consacré à la philosophie comparée au Collège International de Philosophie. Avant ‘L’ambivalence politique de l’Islam’ (Seuil), il a publié de nombreux articles ainsi que deux ouvrages, ‘Le réel et la fiction. Essais de poétique comparée’ (Hermann, 2014) et ‘Politique de l’exil, Giorgio Agamben et l’usage de la métaphysique’ (Lignes, 2019).










